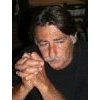Récapituler pour ne pas capituler
Bombardé du matin au soir par des médias dociles, par une classe politique sans envergure, ni volonté particulière d’affronter quoi que ce soit et encore moins les mécanismes fondamentaux qui régissent l’économie mondiale, le citoyen est systématiquement jeté vers des problématiques et des choix qui n’ont comme but que d’obstruer son entendement, son libre arbitre et, en fin de compte, son statut de citoyen.
Il est temps, six ans après la crise des subprimes et le crash financier de faire le point, d’identifier les nouvelles stratégies qui en découlèrent et qui formatent désormais notre monde. Il est temps aussi de décrire exactement, mais simplement, les mécanismes de cette « crise permanente », de lui donner un vrai sens politique et d’énumérer tous les sujets choisis pour faire écran, pour désorienter et perturber à l‘extrême l’entendement.

La « crise permanente » et ses objectifs
La crise des subprimes n’est pas tombée du ciel. Elle est la conséquence de deux éléments fondamentaux qui régissaient la finance. La première, incontestablement, réside dans le fait qu’il y avait une déconnection évidente entre l’économie réelle et le fonctionnement intrinsèque de la finance et des centres boursiers. Les indices, dématérialisés, ne représentaient plus que des courbes et des calculs mathématiques. Les variables ne sont plus que des jeux informatiques automatisées et gérées par des jeunes diplômés qui n’ont aucune idée du monde réel et encore moins de la vie réelle. Dans ce tandem exécutant, l’analyse des effets n’avait aucun contact avec l’éthique, la notion du bien et du mal, et encore moins de la macro-économie, c’est-à-dire de l’anticipation. Il s’agissait, tout simplement, de garantir des gains au jour le jour, puis d’heure en heure, et enfin de minute en minute. L’impréparation de l’élément humain dans sa relation avec l’ordinateur, le fait qu’il soit à l’affut des bonnes ou des mauvaises courbes tendancielles ont précipité cette machine infernale dans la débâcle justement parce que l’analyse du monde réel et des variables non informatisées, mais pourtant essentielles, ont fait défaut. Le « pourquoi » d’une action, ses fondements philosophiques, sociologiques ou simplement historiques ayant quasiment disparu de l’apprentissage au sein des filières suivies par les futurs opérateurs, au profit du formatage d’esprits vifs et pragmatiques, n’est pas étranger à ce désert de la pensée et de la disparition quasi totale des hiérarchies, du sens et des proportions. Sans aller jusqu’à Aristote ou Platon, force est de constater (et ici je parle d’expérience, du vécu) que les pères de la pensée contemporaine, même quand ils sont intimement liés au fait économique comme Tocqueville, Keynes, Polanyi, Arendt, etc., sont pour les opérateurs financiers terra incognita.
Au-dessus des opérateurs et autres killers « intégrés » à leurs machines, démunis aussi bien de pensée anticipatrice que de regard politique, agit la superstructure financière ayant, elle, un regard sur le monde et un projet : faire de la dette et des produits financiers qui en découlent des outils se soustrayant des règles et des lois ; affaiblir le plus possible le rôle des Etats ; renforcer une symbiose entre le monde politique et celui de la finance sous leur « hégémonie éclairée ». Cette hiérarchie, imbue de certitudes inébranlables (et largement explicitées) sur le bien fondé d’une économie tributaire du marché s’auto-extrait du monde réel, de ses règles et de ses lois, mais pas seulement. Cette élite financière autoproclamée, ses porte-parole politiques et ceux la presse qu’elle contrôle majoritairement, essaient de remplacer la pensée politique et l’analyse critique par un manichéisme binaire quasi religieux entre le bien et le mal, le bien étant ce qu’ils font et ce qu’ils exigent et le mal étant tout ce qui n’intègre pas leur vision des choses ou essaie tout simplement de souligner les lacunes et les contradictions de leur projet. Ainsi, toute contestation devient « dangereuse » (d’où la phrase du candidat Hollande we are not dangerous) par ce que elle est « révolutionnaire » et/ou « irresponsable », et/ou « naïve », et/ou « réactionnaire », et/ou « populiste », « archaïque », etc.
En plein crash, Paulson, alors secrétaire au Trésor américain et ancien patron d’un géant financier à la dérive déclarait : je ne croyais pas que ce qui arrive pourrait arriver, mais, je dois l’avouer, c’est arrivé. Il parlait de l’effondrement des plus grandes institutions financières comme d’un phénomène surnaturel, une sorte de déluge biblique pour lequel chercher les causes n’aurait aucun sens.
La crise des subprimes et la chute des géants de la finance aurait pu, si elle n’était restée qu’une crise financière, remettre en cause la manière dont les opérateurs et leurs patrons géraient la rente. Mais, la symbiose précitée - si bien définie par le mot anglais incorporated -, joua à fond. Les Etats, phagocytés à leur plus haut niveau par l’élite financière décidèrent de « sauver » les grandes institutions financières et de faire payer la note à leurs propres populations. Pour ce faire, ils utilisèrent le concept de l’urgence : on sauve maintenant, on chercha le pourquoi (et les responsabilités qui en découlent) après. Or, cet après n’est jamais arrivé. Trois ans après la débâcle, l’exécutif américain était incapable de chiffrer les sommes octroyées au secteur financier. Pour cause (et à titre d’exemple) : durant les six premiers mois de la crise le secrétaire au Trésor avait envoyé des chèques en blanc aux institutions en difficulté leur demandant d’y inscrire le montant qu’elles pensaient nécessaire pour s’en sortir. Encore aujourd’hui, personne ne connaît le montant exact des sommes distribuées entre 2007 et fin 2008. Ce qu’on sait par contre, c’est qu’entre la réunion du G20 sensée lutter contre les offshore et la déclaration du président Sarkozy comme quoi « les paradis fiscaux, c’est fini », trente mille milliards d’argent sale ont « intégré » le système financier très souvent dans le cadre du marché obligataire. Celui qui, justement, sera largement utilisé pour « répondre » aux dettes souveraines. A la même époque (2009), la dette globale grecque fraîchement « découverte », ne dépassait pas les cent quatre-vingt milliards.
La contradiction principale ou le non sens systémique
Hannah Arendt disait, en se référant aux impasses de la société moderne, que la notion de progrès est désormais liée aux capacités de destruction et non de production. En termes de macro-économie, c’est exactement ce qui se passe : tandis que tout le monde parle de « croissance », en fait, la concentration financière détruit l’économie réelle : elle détruit l’emploi, la production, détruit les investissements productifs, les services de l’Etat. Elle détruit en conséquence le tissu social, le « vivre ensemble » et empêche les investissements à long terme, c’est-à-dire toute prospection anticipative. Prenant en considération que la demande est saturée au sein des espaces dits « développés » (Europe, Etats-Unis, Japon), le marché déduit et impose aux Etats que le système mis en place sur la base d’un contrat social péniblement élaboré depuis la révolution industrielle est l’obstacle principal. A regarder de près la courbe des investissements depuis la fin des années 1980, il est facile d’en déduire que le « marché » s’implique de manière inversement proportionnelle par rapport aux acquis de la société civile, aux retards historiques de l’Etat de droit et à l’aplanissement des inégalités : la Chine et l’Inde, le Brésil, les Etats-Unis et le Japon, et enfin l’Europe. Cela indique indiscutablement quelles sont les préférences du marché. L’idéal c’est un pouvoir fort et hyper autoritaire brimant toute velléité de justice sociale, une séparation programmée entre des secteurs performants entourés d’une population vivant dans le dénuement le plus total, des espaces où le droit du travail et son prix sont flexibles à souhait etc… Ces « préférences » prennent ainsi l’allure d’un modèle à suivre et surtout un cahier de charges obligatoire à mettre en place… en urgence. Ainsi, le capitalisme « moderne » envoie un signal fort : le fordisme, qui lui-même n’est que la suite logique des mécanismes capitalistes britanniques qui firent entrer les esclaves dans le monde merveilleux de la consommation, est irrémédiablement périmé. On n’attend plus des ouvriers de devenir des consommateurs, on fait tout pour paupériser les classes moyennes, la croissance est un leurre, la peur de perdre ses acquis le moteur principal, qui contribue justement à les perdre les uns après les autres, transformant toute contestation en guerre d’arrière-garde. Plus aucun investissement au sein des pays de l’Etat de droit n’est comparable aux bénéfices que procurent les dettes, et les pays « endettés » sont ceux qui les premiers accepteront ce modèle, abandonnant en …urgence les acquis sociaux des cent dernières années. Le remboursement de la dette est un leurre supplémentaire. Transformer la Grèce, puis l’Espagne ou l’Italie en Chine ou en Inde est bien plus intéressant pour le marché que les dividendes de quelques centaines de milliards d’euros. Voilà sans doute pourquoi le marché ne semble pas particulièrement inquiet des indicateurs calamiteux de l’économie formelle : que le commerce se meurt, que le chômage atteigne des taux comparables à ceux de l’Inde (non comptabilisés, la notion même de chômage étant inexistant), que le PIB recule de plusieurs unités chaque année, et le modèle désiré basé sur la destruction est de plus en plus proche de l’idéal.
Pour revenir aux proportions : entre 2007 et 2009, près de quarante-deux mille milliards sont partis en fumée. S’ils avaient été investis dans l’économie réelle, pour des infrastructures à long terme, la modernisation des Etats et la recherche, ils auraient alors augmenté le PIB européen de 2,8 à 3,2. C’est-à-dire que la fameuse crise de la dette n’aurait pas existé. Le marché lui même, c’est-à-dire la rente se serait enrichie de manière raisonnable ce qui aurait à son tour rendu compétitifs de manière pérenne les investissements au sein de l’économie réelle. Mais, bien entendu, là n’était pas l’objectif.
Celui-ci serait plutôt de ghettoïser à grande échelle les « populations inutiles », les marginaliser au possible, les nier en tant que variante de la demande et de rendre leur environnement anxiogène, dangereux, traversé de peurs et de craintes les paralysant, leur offrant en contre-partie des raisons futiles mais « clivantes » de s’insurger et de s’opposer les uns aux autres. Si dans son ouvrage Parias urbains, Ghetto, banlieues, Loïc Wacquant avait bien décrit un processus de gestion spatiale d’une marginalité sociale, il était loin de penser qu’il deviendrait bientôt un projet politique œcuménique et que la Grèce en deviendrait le premier laboratoire-paradigme.
Guerres asymétriques, immigrations, nationalismes, identités, terrorisme…
Tandis que de manière systématique se met en place une gestion des hommes et de l’économie qui ne supporte aucune critique, qui se considère comme « unique solution » et balaie à l’aide de qualificatifs déplaisants toute alternative, la société civile est travaillée, bombardée même, par des débats dits de société portant sur des « valeurs », le mot lui-même, galvaudé à souhait, ayant perdu son sens, ne gardant à la longue que celui que lui donne le marché : une fluctuation attirante ou répulsive que l’on découvre ou que l’on oublie à souhait et selon les circonstances.
Comme l’exprimait à merveille le poète alexandrin Costantin Kavafy, les notables de la Cité espèrent les barbares, qui, « après tout, étaient une solution ». On les invente donc, on les crée de toute pièce, on les pointe du doigt, on les oublie puis on les exhibe à nouveau. Ce sont des personnages de théâtre d’une scène mondiale, que l’on pare de costumes sortis d’une garde-robe du moyen âge : On force le trait en insistant sur le côté irrationnel et ubuesque de leur personnage : fous de dieu, fous des armes, barons de la drogue, rois des quartiers, princes des cités, justiciers farfelus et rocambolesques, sensés symboliser le contraire de ce que croit être notre société post moderne : ils sont intolérants, bornés, anti - démocrates, nazillons fanatiques, bouffons professionnels, irréductibles nationalistes de l’entre-deux-guerres, émirs tout droit sortis des croisades, roitelets du pétrole ou vachers analphabètes de la pampa. Le rôle de ces caricatures ? Faire diversion, multiplier les conflits et les enjeux, noyer sous cette pluie de menaces d’un autre âge la seule qui agit vraiment globalement comme un rouleau compresseur, la seule qui mérite notre indignation et notre colère, la seule qui vaille la peine que l’on se mobilise et que l’on résiste.
Cependant, s’indigner ne rime pas avec une répétition à l’infini du - certes réconfortant -, vous voyez, chers concitoyens combien j’ai raison. S’indigner ce n’est plus chercher les uns après les autres des exemples disparates et souvent scandaleux soulignant l’injustice, la violence des applications de cette politique, le non sens systémique de ce hold up contre l’humanité. Quoi de plus logique dans cet illogisme global que la gestion des mines en Grèce ? Quoi de plus évident que les déclarations du monde politique allemand concernant les élections en Italie ? Quoi de plus banal que les apophtegmes européens - quasi quotidiens - sur la sortie de la crise ?
26 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON