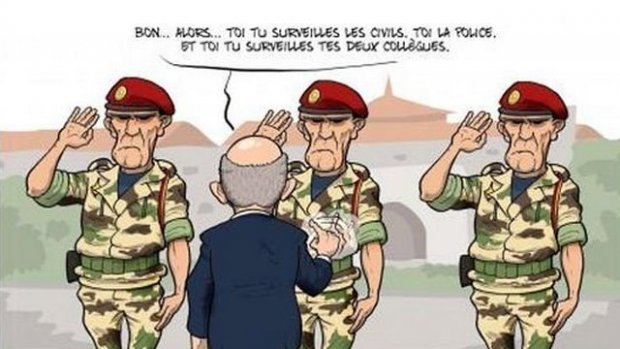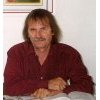Selon Charles de Gaulle, sans l’appui d’une guerre, la dictature est impossible
Rejoignons, le 21 décembre 1946, le général Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne), c’est-à-dire à l’endroit d'où se décide la politique militaire de la France en Indochine. Il se confie à son officier d’ordonnance, Claude Guy :
« Il est heureux qu’on en soit arrivé là. Il est heureux que le Viêt-nam ait engagé le fer. Dorénavant, d’Argenlieu est le maître. Il est heureux que nous ayons maintenant la possibilité d’agir et de régler la question. Je dois dire que le réflexe de conservation s’est produit favorablement : depuis six mois, l’opinion a fait des progrès. D’Argenlieu, je le répète, a maintenant les mains libres. » (Claude Guy, page 194)
D’Argenlieu, voilà l’homme de la situation… Par opposition au général Leclerc qui s’était trouvé placé sous son autorité par Charles de Gaulle au temps où celui-ci était président du Gouvernement provisoire. Or, Leclerc avait prôné le respect des accords signés avec Hô Chi Minh le 6 mars 1946, ce qui le mettait en porte-à-faux avec le chouchou du Général, bien décidé, lui, à obtenir des Vietnamiens qu’ils entrent dans une vraie guerre contre la France.
Tenu informé de l’attitude trop peu guerrière de Leclerc, l’homme de Colombey décide, dans une lettre du 26 avril 1946, de lui rappeler qui est le chef :
« Sachez bien que j’ai moi-même, en son temps, pesé les conditions de la mission confiée à l’amiral d’Argenlieu et de celle qui vous a été confiée à vous-même. Je l’ai fait en tenant compte de beaucoup de facteurs divers. Je vous demande aujourd’hui d’y penser avec un peu de confiance en mon jugement et en mes sentiments. » (général Jean Compagnon, page 568)
Excédé, Leclerc obtiendra de quitter son commandement en Indochine le 19 juillet 1946. Il sera remplacé par le général Valluy dont, dès le 20 juin 1946, l’amiral d’Argenlieu, en visite à Colombey-les-Deux-Églises, avait proposé la désignation à Charles de Gaulle qui lui avait répondu : "D’accord pour Valluy" (Thierry d’Argenlieu, page 293)
Puis, de retour dans la capitale de la Cochinchine, Saïgon, d’Argenlieu écrit le 27 juillet 1946 à De Gaulle qu’il s’inquiète sérieusement de la mollesse du Gouvernement français :
« Je dis sérieusement puisque vraiment notre position est assez forte pour nous permettre de réaliser les desseins de la France sur le pays tout entier et au besoin de les imposer. Cela pourrait en trois mois se faire aisément pour l’essentiel en agissant avec constance, force et suavité. » (Philippe Devillers, page 201)
Le 20 novembre, à Haiphong, une jonque chinoise de contrebande est saisie par les soldats français qui interviennent en violation des accords du 6 mars et font redouter la mise en place d’un blocus de la République vietnamienne. Les Vietnamiens s’interposent ; des coups de feu sont échangés. Toutefois, un accord est rapidement conclu sur place. Jean Sainteny, commissaire de la République, nous rapporte la suite des événements survenus dans la capitale de la Cochinchine :
« Saïgon, jugeant que la mesure est comble, donne ordre le 22 au commandant d’armes français de Haiphong de se rendre maître de la ville et d’y rétablir l’ordre. L’opération, menée avec l’appui de l’artillerie est poussée vigoureusement. La ville de Haiphong est bientôt aux mains des Français, mais la population la déserte et fuit vers la campagne. Les victimes sont nombreuses, impossibles à dénombrer exactement. On a avancé un chiffre avoisinant 6.000. » (Jean Sainteny, pages 215-216)
Il s’agit d’un acte de guerre auquel la population indochinoise ne peut pas ne pas répliquer. D’où cette note qui figure à la page 505 de l’ouvrage de Claude Guy :
« L’insurrection du 19 décembre fait au moins 300 victimes civiles dans la région d’Hanoï. Aussitôt le ministre de la France d’outre-mer, Marius Moutet, part pour Saïgon. »
Or, cette note renvoie à ce que nous avons précédemment entendu dire de la bouche de De Gaulle :
« Il est heureux qu’on en soit arrivé là » et « D’Argenlieu, je le répète, a maintenant les mains libres. »
Effectivement : c’est la guerre. La vraie.
Quel intérêt pour la carrière politique d’un De Gaulle qui trépigne tout à coup ?
C’est ce que nous allons apprendre de la bouche de madame Yvonne de Gaulle qui s’entretient, le 3 avril 1948, à Colombey, avec l’officier d’ordonnance de son époux :
« Et puis, il faut voir les choses comme elles sont : lui, il est fait pour la guerre. D’autre part, s’il n’est pas le patron, ça ne marchera jamais bien. Or, quelles que soient les conditions de son retour au pouvoir, il ne sera pas le patron. Sauf, naturellement, s’il y a la guerre. » (Claude Guy, page 424)
Et Charles, de confirmer :
« Il faut voir les choses en face : en temps de guerre, Churchill et Roosevelt, comme Staline, exerçaient une dictature. Sans celle-ci, nous eussions perdu la guerre. De même, depuis mai 1945, les démocraties ne pouvaient s’en tirer ‒ confrontés avec une dictature ‒ que par l’adoption d’un système autoritaire, c’est-à-dire, pratiquement, en renonçant à la démocratie… En temps de guerre ‒ nous n’avons pas cessé d’être en temps de guerre ‒ les démocraties sont vouées à l’effondrement. S’il arrivait que je doive reprendre les rênes, ne vous faites pas d’illusions, la situation serait bien décourageante. Il y faudrait une atmosphère, il y faudrait une vague d’opinion. Or, en France, il n’y a plus de courant… » (page 428)
Aux yeux de Charles de Gaulle, la guerre d’Indochine était donc bien trop petite… Elle ne suffirait peut-être pas. Mais il a sa petite idée...
53 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON