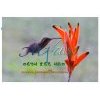Suicides dans le territoire dans le Parc Amazonien de Guyane
Alors que le Parc Amazonien de Guyane (PAG) vient de changer le président à la tête de son conseil d'administration (CA), on reparle surtout de l'échec de l'éradication de l'orpaillage clandestin dans son zonage, dans la foulée une motion a même été prise dans ce sens, et de l'incompréhension de certains maires sur le choix des orientations de la charte du PAG.
Est-ce pour ses raisons que la direction du CA a été confiée à la représentation d'un triumvirat associatif, sans une représentation d'élu local ?
Désaffection ou manque d'intérêt, de responsabilité, ou absence de vision globale ?
Stratégie de l'Etat ?

Quoiqu'il en soit, pas un mot sur les conditions de vie dégradées des villageois du Maroni et de l'Oyapock.
Le suicide dimanche de cette jeune amérindienne de Trois Sauts, France Guyane, nous revient comme un boomerang à la figure pour nous rappeler l'évidence d'un autre échec du PAG, passé souvent sous silence malgré les colmatages médiatiques, celui des orientations non adapté à la réalité de vie de ces citoyens français vivant selon un mode ancestral de droit coutumier.
Présenter juste ses sincères condoléances ne suffit plus. Il faut désormais des réactions sincères.
La France a toujours refusé de reconnaître ces modes vie en rejettant systématiquement de signer la ratification de la convention 169 de l'OIT (Organisation Internalisation du Travail), reconnaissant ainsi le droit des peuples indigènes et tribaux.
Comment répondre aux aspirations quotidiennes de ces personnes, à la notion de bien-être, quand c'est une vision occidentale, sans concession, qui leur est imposée ?
Comment répondre aux besoins essentiels de ces peuples quand c'est une attitude occidentale de la préservation et du développement durable qui prime sur les connaissances ancestrales ?
Depuis les nouvelles lois de 2006, le PAG est devenu certe un outil de développement durable qui allie la conservation et le développement, mais il ne reste pas moins un établissement publique d'Etat qui instaure ses propres orientations, applique son propre mode de fonctionnement parfois au détriment de l'enjeu local et des populations résidantes.
L'Etat, à l'époque de la création du PAG, en choisissant, lui même, le président et en nommant de droit le directeur, avec la complicité de certains élus locaux, mettait dès le départ l'établissement dans une situation bancale. On ne peut pas en effet exclure la démocratie représentative pour manœuvrer à sa manière, selon ses propres règles et des intérêts non justifiés par les acteurs locaux.
La concertation n'a pas été à la hauteur des attentes pourtant elle est nécessaire car elle organise la participation des parties prenantes à l'élaboration des décisions et d'une stratégie commune pour un développement durable des territoires. C'est une démarche volontaire et sincère.
Peut-on parler de Repubique bananière ou de l'Etat dans l'Etat ?
Chacun pourra en juger mais en se rendant sur la territoires du parc on comprend aisément les frustrations de la population. L'outil est devenu une contrainte car les concepteurs n'ont pas su l'adapter pour une utilisation dans un milieu spécifique et les animateurs qui auraient dû être les habitants semblent être perdus dans la projection de soi.
Le matériel n'a pas su s'adapter à l'immatériel.
Le PAG est un outil particulier dans nos politiques de la préservation et de la valorisation de notre patrimoine car il appelle aussi au positionnement prospectif et circonstencié des élus guyanais pour une meilleure appréhension de ce patrimoine naturel sans oublier la place de l'humain dans ce processus. Il est au centre des préoccupations car il est très vulnérable mais aussi un prédateur féroce.
Le territoire du Parc national de Guyane a été habité, a été traversé en long et en large, a été cultivé depuis des millénaires par les premiers habitants de ce territoire : Les peuples Autochtones du plateau des Guyanes.
Ils n'ont pas attendu la création d'un outil de conservation pour faire de la préservation et la valorisation de la biodiversité leur mode de vie.
Je le rappelle encore un fois, ils sont la valeurs ajoutés de ces territoires, leurs connaissances n'ont pas d'égale sur la planète. Ils ont toujours su tirer profit de la nature et respecter son esprit.
Ils nous ont transmis tous leurs savoirs-faires, leur mode de vie. Ils sont d'une richesse inestimable, et pourtant... Nous causons chaque jours un peu plus leur perte, voire leur disparition complète.
Aujourd'hui ces Nations amérindiennes, à travers la non prise en considération de leur mal-être, sont méprisées, sacrifiées à l'autel de cette société de consommation, créatrice d'une multitude de besoins non satisfaits rendant à chacun ce sentiment de pauvreté et de dépendance.
Pauvreté intellectuelle, matérielle , une vie sans issue, une mésestime de soi, une fatalité.
Si, actuellement, l'orpaillage clandestin semble cristalliser la conscience de la société civile, d'élus, d'associations environnementales et j'en passe, d'aucuns ne mettent en avant les suicides de ces populations.
Par le passé j'ai tenté de sensibiliser au plus haut niveau de l'Etat français en 2011, Mr le président de la République et des élus locaux , à travers des entretiens divers ou courrier, voire ce blog, j'ai même eu droit à une Réponse cinglante du président de Région, pourtant à ce jour aucune réponse probante n'a été apportée pour enrayer voire éradiquer le phénomène.
Je reste toujours disponible et à disposition de tous pour apporter ma modeste contribution avec mon petit réseau, sans couleur politique, juste guyanais autochtone.
L'efficacité des réponses se trouve sur le terrain et avec ceux qui ont déjà travaillé sur ces cas dans le monde, les réponses ne sont pas que matérielles, elles résident aussi dans notre propre culture, l'identité de ce territoire et de son histoire.
L'efficience de la réponse doit être collective et engageant les collectivités territoriales, notamment la Région au côté de l'Etat qui semble complètement dépassé. Il faut reprendre la main avec les véritables experts.
Ou sont passé les psychologues ? Les emplois promis ? La pérennisation des différents programmes et de leur financement ?
Pourtant les chiffres sont parlants et laissent pantois." Si le taux de prévalence du suicide sur la haut Maroni était le même qu'en métropole , il y a aurait 300.000 suicides par an, soit autant d'habitants en Guyane." note Rachel Merlet, coordinatrice d'ADER (FG du 27 novembre 2013).
"Allo !!! Non mais allo quoi !!!"comme disent les jeunes d'aujourd'hui.
On parle de budget incertain pour la poursuite du programme contre les suicides mené par l'association Ader sur le haut Maroni. Quid d'un programme sur l'Oyapock ?
Il faut créer une cellule ad-hoc avec des moyens adéquats pour lutter efficacement contre ce fléau des suicides des jeunes amérindiens de Guyane, car il a y aussi des suicides sur le littoral dont on ne parle encore moins.
On ne peut plus accepter, aux siècle d'aujourd'hui, cette aberration face à tant de détresse d'une population entière. On sait trouver des moyens pour la sécurité politique, financière et militaire de la France dans le monde mais on reste sans réponse pour la sécurité des peuples premiers sur le territoire national. On ne peut plus cacher cette misère sous les tapis.
" On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux" Le petite prince -Antoine de Saint Exupery.
Cette grandeur du cœur semble si éloignée.
Le turn-over de services de l'Etat en Guyane, des préfets, des politiques changeantes au gré des gouvernements successifs, au petit jeu calculateur de nos édiles locaux ne sont pas d'ordre à rassurer les Guyanais sur leur avenir et de celui du territoire que nous empruntons à nos enfants.
Laisser mourir la jeunesse guyanaise dans cette violence, sans réagir, c'est nous renfermer sur nous mêmes pour laisser place à l'indifference au détriment de notre humanité et de notre propre identité guyanaise.
D'accord pour hurler contre l'orpaillage clandestins et ses conséquences mais mobilisons nous aussi pour crier notre rage contre l'immobilisme face aux suicides des jeunes amérindiens de Guyane.
Lors de sa prochaine venue en Guyane le président de la république à l'obligation de nous apporter des réponses claires, précises et efficaces.
S'Il vous plait Monsieur le Président, nous souffrons !
"Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction " Terre des hommes- toujours Saint Exupéry
4 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON