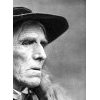Sur FR3, « le capitalisme doit-il être moralisé ? »
Mercredi sur FR3 l’émission "Ce soir ou jamais" était consacrée à la crise avec comme thème « le capitalisme doit-il être moralisé ». Les invités : Jean-Marie MESSIER, Homme d’affaires, il vient de publier : « Le jour où le ciel nous est tombé sur la tête », Ignacio RAMONET, écrivain et journaliste, il vient de publier Le Krach parfait, Crise du siècle et refondation de l’avenir), Philippe Manière, Economiste, ancien journaliste, il a notamment travaillé au Quotidien de Paris, au Point et à l’Expansion, sa dernière publication à l’Institut Montaigne : « Comment « bien » payer les dirigeants d’entreprises ? », Morad EL HATTAB, Conseiller en stratégie financière et écrivain, son dernier ouvrage : La Finance mondiale : Tout va exploser, Les Cycles financiers spéculatifs : un modèle économique instable.
Toujours excellente cette émission même si elle est trop courte, car le présentateur se fait un animateur discret laissant le plus de temps possible aux intervenants.
J’ai suivi avec attention la définition du capitalisme donnée par messieurs Messier et Manière qui colle parfaitement aux temps, car ils le caractérisent. par la notion entrepreneuriale : celui qui crée de la valeur, celui qui crée la richesse est l’entrepreneur parce qu’il prend des risques. Un peu court dans l’essentiel et de préciser ce qu’il est courant de dire, le capitalisme et un système amoral (sans morale) et qui privilégie l’appât du gain comme dans tous les systèmes. Dans ces trois mots entrepreneur, système, amoral tout est dit.
Un peu loin de la définition de notre guide Mr le président Sarkozy : Il considère que le capitalisme et l’effort, le travail et l’esprit d’entreprise. J’ignore qui le lui a soufflé, mais s’il en est l’auteur il y a de quoi en avoir le souffle coupé.
J’ai déjà eu l’occasion d’écrire un article sur le capitalisme Silence politique sur la « socialisation » du capitalisme du 15 janvier 09, en bref :
La nécessité de vivre fait accepter les concepts et les contraintes qui nous soumettent à leur exercice. Il en est ainsi pour le capitalisme, son concept ne fut pas inventé par un quelconque penseur mais est le produit d’une association de comportements, dans lequel il faut inclure tout aussi bien la transformation des relations salariales en 1804 « le louage de sa force de travail » que l’abandon de la production manufacturière vers une production industrielle pour poursuivre la recherche de l’enrichissement qui s’opérait au travers des anciens privilèges.
Le salariat est apparu dès que les liens féodaux ont été suffisamment lâches pour permettre à des hommes de disposer librement de leur force de travail. Bien que cette liberté soit plus formelle que réelle, car ne disposer que de la force de ses bras pour subsister et assurer ses lendemains, borne nécessairement cette liberté.
Je ne vais donc pas reprendre le déroulé de l’article précédent et commenter les trois termes, entrepreneur, système, amoral.
L’entrepreneur : celui qui crée donc la richesse et la valeur, que diable ne reste t-il pas tout seul pour en profiter plutôt que d’aller se compliquer la vie avec l’aide des autres qui toujours lui réclament une part de la richesse qu’il s’approprie. Car si la constitution dit qu’elle préserve la propriété privé, elle ne dit pas qu’un homme qui travaille chez un autre devient sa propriété et que l’effort qu’il consent pour son propre compte au service d’un autre pour l’aider dans son entreprise appartient de fait à ce dernier parce qu’il a eu l’audace d’entreprendre et de l’échanger par la refonte d’un lien moyennâgeux.
S’il a pu entreprendre c’est par défaut des autres. C’est-à-dire que si tous pouvaient entreprendre il ne serait plus possible de trouver un tiers pour donner la main à un autre, à moins que plusieurs sur un même projet consentent de réunir leurs efforts pour se répartir les tâches, et échanger leurs produits contre d’autres et ainsi créer un marché de toutes choses.
Si aujourd’hui la sélection héréditaire ou financière sélectionnent ceux qui ont l’opportunité d’entreprendre cela n’en fait pas des créateurs privilégiés de richesse ni de valeur, ni ne fait le capitalisme. Le phénomène le plus important est l’organisation sociale qui s’est constituée autour de la monnaie depuis des siècles qui peut donner cours à l’expression de tous les « atavismes » en plus de facilité les échanges Si sa circulation a facilité le développement économique, sa rareté est en même temps un frein au développement, à cause des « atavismes » humains.
La monnaie n’en demeure pas moins une valeur relative fictive réglementée qui n’a de valeur que celle que nous lui accordons.
Imaginez-vous dans un désert, et devoir choisir entre un verre d’eau ou un compte bancaire opulent. Nul doute que c’est votre raison biologique qui l’emporterait sur votre envie de posséder un compte opulent, et vous choisiriez le verre d’eau. Car c’est bien notre existence qui est une valeur fondamentale, et non pas une ligne d’écriture sur un compte, qui sans lui dénier son utilité, n’est pas une fin en soi.
Si dans la même situation un tiers vous proposait le verre d’eau pour le prix de votre capital vous l’achèteriez. Si un autre tiers vous offrait seulement ce verre d’eau vous le prendriez.
Les deux cas donnent un résultat identique pour l’assoiffé. Pourtant, dans le premier cas, la valeur de votre compte à un cours imaginaire un million de litres d’eau, n’en vaut plus que celui d’un verre. Dans le deuxième cas vous êtes bénéficiaire de tout. Dans le premier cas vous êtes sauvé mais ruiné, dans l’autre, sauvé également et propriétaire d’un capital qui ne représente rien parce qu’il n’a pas été désiré.
L’exemple est réducteur et exclusif des autres types de situations possibles, mais indique ceci : Que l’éducation sociale de l’un et de l’autre n’engendre pas la même échelle de valeur pour l’ensemble des éléments qui composent la situation. D’autres appellent cela « la loi du marché », et ramènent de ce fait nos relations sociales à un seul échange commercial dénudé de l’humanisme que notre espèce a su définir en théories et qu’elle a tant de mal à réaliser.
Ainsi un entrepreneur seul n’a aucune valeur et ne crée aucune richesse, si ce qu’il met en place n’est pas désiré et partagé par les autres, et l’on ne peut pas gommer la vie d’autrui au bénéfice d’un concept narcissique qui ramène un long processus d’organisation « subsistantiviste[1] » à la plus stricte expression d’égocentrisme, comme la justification d’une impossibilité à concevoir d’autres types de relations économiques.
Le système c’est la structure, elle repose sur toutes les théorisations dogmatisés par des axiomes ou modélisés par une mathématisation, sa fonction est de formater à leurs mesures, qui reposent sur une réalité observable, qui se fossilise et rejette toute évolution si elle ne lui est pas imposé par son imperfection (les effets pervers) à détenir une quelconque vérité. Mais bien évidemment il en ressort des événements que nous apprécions diversement suivant notre propre condition sociale conduite par le « subsistantivisme ».
L’emploi du mot système est un raccourcie devant la difficulté de pouvoir expliquer simplement son organisation complexe à éléments variables, et de cacher l’éventuelle ignorance à en comprendre ou maitriser sa totale unité. La particularité d’un axiome est de définir une notion invérifiable (comme celle d’Adam Smith) que la mathématisation enferme dans des mesures que l’on a développées pour réaliser la véracité d’un axiome invérifiable.
Ex : l’axiome du libéralisme lockéen : « Les droits naturels sont ceux qui appartiennent à l’homme en raison de son existence : de cette nature sont tous les droits intellectuels ou droit de l’esprit, comme aussi tous les droit d’agir comme individu, pour sa propre satisfaction et pour son bonheur, en tant qu’il ne blesse pas les droits naturels d’autrui ». Cette notion de loi naturelle est un axiome, une évidence, facilement compréhensible jusqu’à « son bonheur », car ensuite, à partir de « en tant qu’il ne blesse les droits naturels d’autrui », c’est notre « nature culturelle » (le fait social) qui va fixer les règles, particulièrement celles qui vont consister à apprécier à partir de quand les droits des uns blessent les droits des autres. Plus simplement cet axiome peut se résumer ainsi : « chaque animal humain parce qu’il EST, tient les moyens de vivre devant un autre », et comme chacun peut le comprendre, ce n’est pas parce que nous avons défini qu’est naturel ce qui est naturel (l’appât du gain), que cela suffit aujourd’hui à expliquer les choses, car par des modèles mathématisés l’on peut inverser la pensée axiomatique d’où il est extrait.
Ce qui me fait souvent dire que beaucoup de libéraux capitalistes oublient, « tant qu’il ne blesse pas les droits naturels d’autrui » pour dire :si je les blesse ce n’est pas moi mais le système qui m’y contraint. Ce qui donne toute son évidence au fait qu’un entrepreneur qui s’approprie par le système (ses codifications) le travail d’un autre grâce à sa puissance économique blesse les droits naturels d’autrui en l’en dépossédant, et qui plus est, parfum du temps ou propagande se glorifie d’être seul créateur de richesse, ou modèle à suivre ?
Marx l’a dit avant moi et le rappeler n’est pas un archaïsme.
L’amoralité (sans notion de bien ou mal) : il y aurait donc un lieu où l’on peut sans remord être très légalement le plus salaud de la terre pourvu que ce soit au nom du système. Il y aurait donc des êtres humains dans ce cas, car les dirigeants ou exécutants sont bien humains, ils ont un nom le plus souvent une famille des amis, ils ont été élevés aux senteurs de leur culture, leur cerveau n’est pas donc vide ou rempli des seuls atavismes innés.
Quand Jean –Marie Albertini (un économiste) rappelle que le capitalisme n’a besoin que du vice des hommes, c’est déjà reconnaitre qu’il est régressif et non amoral. C’est admettre jouer sur ce que les hommes ont relégué comme comportements asociaux derrière des totems et des tabous, voire des religions ou des axiomes., c’est les faire resurgir en se disculpant sur la théorisation mathématique, et puis de faire les grands étonnés devant la toile immense de malversations instaurées comme règle en non dit .
Lorsque l’on a instauré l’avidité comme règle absolue de tous comportements économiques et que l’on se justifie par l’absence normal de « moralité » du système pour ne pas le refonder, c’est seulement dire que nous ne voulons pas avoir à porter de jugement sur nos comportements. C’est le dénie des relations humaines qui sont fondées sur l’échange. Si Ago publie mon article sur ce sujet ce sera plus évident.
Ceux qui pensent, aveuglée par les flamboyants ignorants qui peuplent nos médias (mais il y en a qui ont de la culture et de tout bord) que c’est l’entrepreneur qui est la pièce maitresse du puzzle, lisaient donc le manifeste des soixante publié dans « l’opinion nationale » du 17 février 1864.
C’est trop long à rapporter, mais en substance « On a répété à satiété il n’y a plus de classe ; depuis 1789 tous les Français sont égaux devant la loi. Mais nous, qui n’avons d’autre propriété que nos bras, nous qui subissons tous les jours les conditions légitimes ou arbitraires du Capital, nous qui vivons sous des lois exceptionnelles, telles que la loi sur les coalitions et l’article 1781, qui porte atteinte à nos intérêts en même temps qu’à notre dignité, il nous est bien difficile de croire en cette affirmation. »
Le décret d’Allarde (1791) supprime les corporations, introduisant un changement radical dans l’économie et l’organisation du travail. Les corporations étaient des regroupements de personnes exerçant le même métier. Cette structure née au Moyen-Âge permettait à un corps de métiers d’exercer un monopole par secteur, souvent par ville, et d’avoir un certain poids politique. Mais elle subissait depuis le début du siècle la concurrence avec un modèle industriel capitaliste reposant sur la libre concurrence. Renforcée par la loi Le Chapelier, ce décret permet ainsi de modifier l’économie ainsi que le statut de l’employé. Mais la loi Le Chapelier sera aussi l’occasion d’interdire le droit de grève.
Comme quoi les paradigmes sont cycliques eux aussi.
[1] Dans l’espèce humaine, les besoins ne sont satisfaits que grâce à une coopération entre individu. Il n’existe pas d’individu isolé, d’homme sauvage. L’économie est l’organisation commune qui permet la satisfaction des besoins. Dans les débats entre anthropologues, cette conception de l’économie est généralement désignée comme « subsistantiviste » (histoire des mœurs II vol 1, p 441). Note de l’auteur. Sur cette base l’on peut donc concevoir que l’économie dites libérale qui se symbolise par la loi du marché, n’est que l’aboutissement momentané d’un long processus d’une organisation « substantiviste » qui veut s’ériger en vérité absolue des relations de l’homme et de l’économie qu’il a ordonnée, et sa justification par l’égocentrisme comme socle incontournable produit de l’inné, n’est qu’un choix culturel délibéré.
26 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON