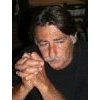Syrie ou l’essoufflement des empires

Comment on en est arrivé là ? On se demande concernant la Syrie. Ce pays est la micrographie, on pourrait même dire la caricature, des tensions, contradictions, blocages et impasses géopolitiques de tous les pays intéressés, et au-delà.
Comme une goutte d’eau qui, tombant dans une marre, produit des cercles parallèles, de plus en plus invisibles, le conflit syrien, en relation bien sûr avec ce que vit le proche et moyen orient, génère toute une série de blocages mais aussi des contestations et de mouvements telluriques dans ce qui était l’armature géopolitique globale. Pour bien saisir la situation, il est nécessaire d’esquisser, très brièvement, les différents décors qui se sont succédés, les uns après les autres depuis la fin de la guerre froide concernant les « modèles d’intervention ».
Au niveau mondial, la fin de la guerre froide a donné naissance au dogme oh combien erroné d’un monde unipolaire, très vite contesté : cherchant à tirer profit du déséquilibre issu de l’effondrement de l’Union Soviétique, les pays occidentaux ont essayé de refaçonner le monde. Les guerres yougoslaves, dont la responsabilité géopolitique incombe en tout premier lieu à l’Allemagne de par la reconnaissance précoce de certaines composantes de ce pays ont démontré l’inadaptation des structures super étatiques (ONU) mais aussi leur nécessité, leur « label » pour mener des guerres dites « justes ». Elles ont aussi démontré que, sur le terrain la coordination de composantes diverses que les Américains utilisaient comme cache-sexe, après les désaccords européens et onusiens sur l’Iraq posaient des graves problèmes aussi bien au niveau opérationnel qu’à celui de la gestion multiple de l’occupation du sol (Afghanistan). Auparavant, les guerres africaines (Ruanda, RDC, Libéria, République du Congo, etc.) avaient mortellement blessé le concept du « mandat », c’est à dire d’une action militaire sous couvert d’une décision de la communauté internationale imposée et/ou la précédée par le pays intéressé (Grande Bretagne, France). En effet, la dite mondialisation a eu au moins le mérite de contester les espaces de « chasse gardée » lesquels, jusque là, constituaient une évidence pour les grandes puissances. Américains, Français, Anglais ne peuvent plus intervenir « comme il leur plaisait ». Les USA ne déstabilisent plus comme dans les années soixante en Amérique Latine, la France et la Grande Bretagne en Afrique ne sont plus aussi aisément faiseurs de rois. Pour le dire autrement : attaquer le Venezuela et son pétrole c’est s’attaquer aux intérêts brésiliens, chinois et russes.
Depuis la longue guerre en Iraq jusqu’à la guerre éclair en Côte d’Ivoire deux constantes s’imposent : quel que soit le terrain d’intervention et quelle que soit sa durée, le problèmes spécifiques mis en avant pour y aller ne sont pas résolus, et c’est un euphémisme. A tel point qu’en Iraq, en Afghanistan, en Somalie, tout dernièrement en Libye, la première question et objectif, - après avoir y crée le chaos -, c’est ceux du désengagement. En d’autres termes, comment s’en aller. Même au Mali les objectifs (et ce n’était pas que du discours) restait un départ, le plus rapidement possible, et donc un simple retour au status antes, celui justement qui avait crée le problème « nécessitant » l’intervention française. A la veille d’une intervention - comme c’est le cas aujourd’hui en Syrie -, le premier problème tactique à résoudre est donc « comment ne pas s’enliser ». Le chaos libyen créé après les frappes franco-anglaises et américaines sous couvert onusien semble aujourd’hui le modèle. Dit autrement la guerre prend le chemin de la finance : l’anticipation se perd dans les limbes et la dictature de l’instant. Une combinaison liant le « après moi le déluge » libyen avec le « sauve qui peut » afghan.
Comme pour la crise financière, les résultats espérés non seulement ne sont pas atteints mais s’alourdissent de nouvelles contradictions et de nouveaux blocages. Aujourd’hui par exemple, l’Iran, ennemi ultime des Etats-Unis, est par les faits en Afghanistan mais surtout en Iraq leur meilleur allié. Tout comme le Pakistan et l’Arabie saoudite qui sont à la genèse du fondamentalisme générant des Al Quaida à la pelle.
L’essoufflement des empires occidentaux et la mondialisation financière ont crée une nouvelle réalité géopolitique à laquelle on s’attaque – encore - par des mécanismes et des moyens issus de la guerre froide et même de l’ère coloniale. Tandis que la réalité de l’environnement (mondial), pour citer Sun Tzé, nécéssite prioritairement de savoir qui on est avant de décider où on va.
Cette réalité fait la part belle aux puissances régionales (Brésil, Iran, Turquie) mais aussi aux empires renouvelés (Russie, Chine) et qui, entre autres, exhibent leur savoir-faire concernant les crises à leur périphérie (Caucase, Asie centrale, Tibet, Sin-Kiang, Mer de Chine, etc.).
Par contre, et faute de connaître et encore moins contrôler un monde où leur leadership chancelle, les occidentaux s’appuient sur des contre-vérités et des effets émotionnels pour - au moins - avoir l’adhésion momentanée de leurs populations. L’image de Colin Powell et de son flacon se dédoublant avec celle de John Kerry montrant une fillette morte aux bras de son père. Qu’il soit britannique, français ou américain (les trois seules forces occidentales réellement capables d’interventions militaires autonomes), le dirigeant occidental, obsédé par le concept de guerre juste, seul capable d’emporter l’adhésion (limitée dans le temps), de ses concitoyens se prend ainsi dans son propre jeu. Or la réalité n’est pas influencée par l’émotionnel mais par des rapports de force, des intérêts bien compris et des constantes régionales. Dans le cas de la Syrie cette réalité est complexe. (Et on expose ici uniquement les aspects de la diversité géopolitique et non pas de l’éclatement interne) Israël, par exemple, a tout à perdre avec la chute de Bachar el - Assad mais tout à gagner d’un affaiblissement de l’Iran qui le soutient et du Hezbollah, acteur en Syrie et soutenu par l’Iran. La Turquie, par ses barrages anatoliens tient les vannes qui peuvent transformer en désert ou en jardins fleuris la quasi-totalité de l’espace agricole syrien. Mais elle craint aussi l’émergence d’un Etat kurde et celui de l’entité autonome en Iraq lui suffit amplement comme problème. Chypre possède sur son sol une base aérienne britannique mais, après avoir porté un coup bas aux sociétés offshore russes à son corps défendant ne veux pas aggraver ses relations avec la Russie. Tout comme la Grèce et la base américaine de Souda en Crète.
La Russie et la Chine, qui ne s’embarrassent pas du concept de guerre juste quand elles interviennent à leurs marches (ou supposées l’être) savent rappeler aux alliances atlantiques qu’ils ont été largement abusés en Libye et que cela ne se reproduira plus. Faites ce que vous voulez insinuent-ils mais cela se fera aux dépends de vos propres concepts (guerre juste adossée par la communauté internationale). En d’autres termes : si vous voulez vous enfoncer encore plus, libre à vous.
14 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON