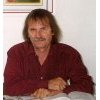Thomas Piketty : quand l’arithmétique des taux de croissance s’affole toute seule
Même s’il finira par admettre dès la page suivante que "la précision de telles estimations est évidemment illusoire", Thomas Piketty n’aura pas hésité à nous indiquer à la page 127 de son "Capital au XXIe siècle" que…

« D’après les meilleures estimations disponibles, le taux de croissance du PIB mondial a été en moyenne de 1,6 % par an entre 1700 et 2012, dont 0,8 % par an au titre de la croissance de la population, et 0,8 % par an au titre de la croissance de la production par habitant. »
Le plus important est sans doute que tout ceci puisse se ranger dans des équations simples, voire simplistes, car, en fait, Thomas Piketty insiste au même endroit sur ceci que "les connaissances dont nous disposons" "sur l’évolution de la production par habitant sont quasi nulles". En bonne logique, cela revient à dire : nous n’avons rien vu, mais, sans rien voir, nous avons tout enregistré jusqu’au dernier détail qui est ainsi, lui aussi, dans la boîte… Tenant le tout, nous tenons le détail… Ensuite la réflexion peut divaguer à son aise, du détail au tout et du tout au détail.
Ici, Thomas Piketty s’en donne à cœur joie…
« Par exemple, un taux de croissance de 1 % par an correspond à une progression de 35 % au bout de trente ans, une multiplication par près de trois au bout de cent ans, par vingt au bout de trois cents ans, et par plus de vingt mille au bout de mille ans. » (Idem, page 129.)
Pourquoi écrire cela ? Mais tout simplement, comme l’indique le début du paragraphe d’où est tirée cette citation :
« Afin que chacun puisse se familiariser avec les effets explosifs de la loi de la croissance cumulée […]. » (Idem, page 129.)
Croissance cumulée, intérêts composés…, nous voici donc dans la plus grande spéculation possible, c’est-à-dire dans l’effet de miroir (speculum) le plus ravageur. Bien mal parti, qui s’y fie.
Douteux que Thomas Piketty lui-même soit à ce point naïf… Et pourtant, c’est ce genre de "machin" qu’il n’hésite pas à produire au sein de la discipline qui est la sienne, l’économie, discipline crédible pour autant qu’elle ne se dissocierait pas de la production réelle, c’est-à-dire du travail humain…
Le délire ou le tour de passe-passe sont, en tout cas, ici :
« La loi de la "croissance cumulée" [car ce serait rien moins qu’une loi] est identique dans son principe à la loi dite des "rendements cumulés" [encore une loi], selon laquelle un taux de rendement annuel de quelques pourcents, cumulé sur plusieurs décennies, conduit mécaniquement à une progression très forte du capital initial - à condition toutefois que le rendement soit constamment réinvesti, ou tout du moins que la part qui est consommée par le détenteur du capital ne soit pas trop forte, par comparaison notamment au taux de croissance de la société considérée. » (Idem, page 131.)
"Mécaniquement", c’est bien l’adverbe qui tue… Alors qu’il faudrait dire : arithmétiquement, et rien de plus. Ainsi, écrivant ce qu’il écrit ici, Thomas Piketty ne fait encore et toujours que de l’arithmétique.
Dans la production réelle, il n’y a pas que le jeu du chiffre avec le chiffre : il y a des bras, des jambes, des cerveaux, un temps mesuré, un espace organisé, et tout cela résiste à la facilité de la valse des nombres…
…sur laquelle Thomas Piketty prétend asseoir la réflexion qu’il nous offre ici :
« La thèse centrale de ce livre est précisément qu’un écart en apparence limité entre le taux de rendement du capital et le taux de croissance peut produire à long terme des effets extrêmement puissants et déstabilisants sur la structure et la dynamique des inégalités dans une société donnée. » (Idem, page 131.)
Or, selon lui - et c’est ce que nous indique la suite immédiate de cette phrase -, en ce qui concerne "la structure et la dynamique des inégalités", c’est bien le délire "spéculaire" qui doit l’emporter, puisque :
« Tout découle d’une certaine façon de la loi de la croissance et du rendement cumulés [une loi en deux, ou deux lois en une : argument d’autorité totalement incontournable], et il est donc utile de se familiariser dès à présent avec ces notions. » (Idem, page 131.)
…c’est-à-dire avec l’arbitraire.
Et voilà à quoi s’amusent ces économistes qui ne sont, pour l’essentiel, que des comptables qui ont été mangés par la spirale de leurs petits calculs de répartition du profit capitaliste en système démocratique parce que méritocratique.
Après quelques pages consacrées aux "étapes de la croissance démographique" depuis l’an zéro, c’est-à-dire à ce qu’on pourrait hâtivement appeler la production des humains, Thomas Piketty en arrive à "La croissance, source d’égalisation des destins", puisque…
« En tout état de cause, l’objectif de ce livre n’est pas de faire des prévisions démographiques, mais bien plutôt de prendre acte de ces différentes possibilités et d’en analyser les implications pour l’évolution de la répartition des richesses. » (Idem, page 141.)
"Inégalité", affaire de "répartition" : ce vocabulaire-là n’est évidemment pas là par hasard… Il appelle l’humanité à une égalisation aussi bien qu’à une inégalisation, au sein d’un système parfaitement homogène dans lequel il ne convient pas d’opposer celles et ceux qui possèdent les moyens de production et d’échange à celles et ceux qui doivent travailler pour vivre et faire vivre leur famille.
Or, il paraît que la croissance démographique…
« […] a également des implications importantes pour la structure des inégalités ». (Idem, page 141.)
Prenons l’affaire par le bon bout qui ne peut être, chez Thomas Piketty, que celui de la répartition des parts du gâteau, jusques et y compris à l’intérieur des familles, et dans la transition patrimoniale entre les parents et les enfants. Voyons ce que cela donne (et c’est la suite immédiate de la phrase que je viens tout juste de citer) :
« Toutes autres choses égales par ailleurs, une croissance démographique forte tend en effet à avoir un rôle égalisateur, car elle diminue l’importance des patrimoines issus du passé, et donc de l’héritage : chaque génération doit en quelque sorte se construire par elle-même. » (Idem, page 141.)
…pour s’organiser dans le cadre d’une nouvelle répartition du gâteau à l’intérieur de la nouvelle génération sur le fondement de ce qu’elle a elle-même reçu.
Thomas Piketty nous offre alors cet "exemple extrême" d’un "monde où chacun aurait dix enfants" :
« Dans une telle société, le poids global de l’héritage se trouve fortement réduit, et il est dans la plupart des cas plus réaliste de miser sur son travail ou sur sa propre épargne. » (Idem, page 141.)
Ensuite, Thomas Piketty nous propose un tout petit saut du côté de la production, mais c’est tout juste pour nous reparler du système "gâteau" de la répartition :
« Par exemple, dans un monde où la production par habitant serait multipliée par dix à chaque génération, alors mieux vaut compter sur le revenu et l’épargne issus de son propre travail : les revenus des générations précédentes sont tellement faibles par comparaison aux revenus actuels que les patrimoines accumulés par les parents ou grands-parents ne représentent pas grand-chose. » (Idem, page 142.)
De façon générale, croissance de la population et croissance de la production apparaissent comme les deux conditions nécessaires à une meilleure répartition du gâteau et donc à un affaiblissement des inégalités… Sinon…
« Inversement, la stagnation de la population - et plus encore sa diminution - accroît le poids du capital accumulé par les générations précédentes. Il en va de même de la stagnation économique. » (Idem, page 142.)
L’analyse marxiste de la production - et de l’exploitation dont celle-ci est l’occasion - peut tranquillement passer à la trappe. L’étude apaisée de la courbe des inégalités induites par le seul jeu de la répartition d’un gâteau en croissance et d’une population, en croissance elle aussi, devrait suffire à donner aux instances économiques et politiques dirigeantes les instruments d’une bonne gestion de la démocratie méritocratique.
À condition cependant de ne pas se tromper sur la vérité même de certains "mérites". Ici, Thomas Piketty souligne l’une de ses principales préoccupations, peut-être la plus significative :
« Il faut toutefois se méfier de cette idée un peu convenue selon laquelle la croissance moderne agirait comme un incomparable révélateur des talents et des aptitudes individuels. » (Idem, page 143.)
Il paraît que cette question le touche de près. Il ne sera pas sans importance de définir sur quel point d’appui il se fonde pour lui donner une vraie place dans l’ensemble de l’économie méritocratique :
« Dans les années 2000-2010, on entend parfois exprimer cette même idée, selon laquelle la nouvelle économie de l’information permettrait aux plus talentueux de démultiplier leur productivité. » (Idem, page 144.)
C’est donc un élément interne à la production qui entre en jeu dans la réflexion de Thomas Piketty, à l’occasion de l’évaluation des "talents" : la hausse induite de la productivité. Conséquemment, il met en question les éventuelles situations indues, sans encore nous dire ce qu’il convient d’entendre sous cette formule de la démultiplication de la "productivité" des "plus talentueux" :
« Force est de constater que cet argument est souvent utilisé pour justifier des inégalités extrêmes et pour défendre la situation des gagnants, sans grande considération pour les perdants, ni d’ailleurs pour les faits, et sans véritablement chercher à vérifier si ce principe bien commode permet ou non d’expliquer les évolutions observées. Nous y reviendrons. » (Idem, page 144.)
Ce qui sera un réel plaisir pour nous.
Michel J. Cuny
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON