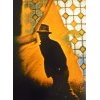Victimologie : « coupable mais pas responsable... »
Cette phrase lourde de conséquences devenue désormais célèbre à la suite de l'affaire du sang contaminé prononcée par Laurent Fabius illustre tout le paradoxe de la victimologie, discipline qui postule : « quelle que soit la victime, elle a toujours une part de responsabilité dans ce qui lui arrive. » La victimologie proche parente de la criminologie à ne pas confondre avec l'accidentologie (étude des accidents dans les transports de personnes) vise à établir le lien qui relie la victime à la chaîne du délit et à son auteur. Établir le profil de la victime et les circonstances de survenance restent une étape fondamentale de la découverte des motifs possibles ayant poussé l'auteur à la prendre pour victime.
 Notre système judiciaire repose sur l'infraction (fait interdit par la loi) et la sanction liée au délit. Du point de vue sociétal, l'application de la peine est prévue par les textes de loi, encore faut-il que l'auteur du délit soit identifié, interpellé et condamné. La sanction prononcée, la justice et la société ne devraient plus avoir besoin de s'occuper du condamné ni de sa victime, l'application de la peine étant censée effacer l'infraction, rétablir le droit et réparer le préjudice (encore faut-il que l'auteur soit solvable et comment réparer un préjudice psychologique). En France, la justice jugeant le délit et le délinquant, il convient donc à déterminer quelle a été la part de responsabilité de la victime à travers son comportement. La victimologie (discipline proche du profiling) recherche quelle a été la participation intentionnelle ou non (négligence, immaturité, etc.) de la victime dans l'acte délictueux. On doit le terme de victimologie à Mendelsohn Benjamin (1947) qui trouvait anormal que la société s’occupe du délinquant à travers les aspects criminologiques et judiciaires : prévention - jugement - exécution de la peine - contact avec la famille - mesures de rééducation - assistance à la sortie et post pénale, et peu de la victime.
Notre système judiciaire repose sur l'infraction (fait interdit par la loi) et la sanction liée au délit. Du point de vue sociétal, l'application de la peine est prévue par les textes de loi, encore faut-il que l'auteur du délit soit identifié, interpellé et condamné. La sanction prononcée, la justice et la société ne devraient plus avoir besoin de s'occuper du condamné ni de sa victime, l'application de la peine étant censée effacer l'infraction, rétablir le droit et réparer le préjudice (encore faut-il que l'auteur soit solvable et comment réparer un préjudice psychologique). En France, la justice jugeant le délit et le délinquant, il convient donc à déterminer quelle a été la part de responsabilité de la victime à travers son comportement. La victimologie (discipline proche du profiling) recherche quelle a été la participation intentionnelle ou non (négligence, immaturité, etc.) de la victime dans l'acte délictueux. On doit le terme de victimologie à Mendelsohn Benjamin (1947) qui trouvait anormal que la société s’occupe du délinquant à travers les aspects criminologiques et judiciaires : prévention - jugement - exécution de la peine - contact avec la famille - mesures de rééducation - assistance à la sortie et post pénale, et peu de la victime.
La victimologie se propose d'étudier les traits et les comportements, ainsi que ses caractéristiques : biologique, psychologique, morale, sociale, culturelle, relationnelle, de la victime et qui ont pu jouer un rôle dans la genèse du délit ou servir de déclencheur (provocation, port ostentatoire de bijoux, etc.). N'est-il pas logique ou satisfaisant intellectuellement parlant que la victime qui a créé le risque ait une part de responsabilité dans sa mésaventure ? En découvrant ce qui a pu la désigner à son agresseur (particularité physique, vestimentaire, personnalité extravertie, goût du risque, endroit isolé, risque moindre pour l'agresseur, familier des lieux, panne de véhicule, absence de transport, etc.) et pourquoi ce dernier a-t-il porté son intérêt sur elle et pas une autre, peut permettre de conduire à l'auteur du délit. Comme pour la typologie délictuelle étudiée par les criminologues, les victimologues ont dressé une typologie allant jusqu'à parler de victime : potentielle - récidiviste - voire de victime née...
Voici la pré-classification établie par Benjamin Mendelsohn :
-
Victime totalement innocente : l’enfant victime.
-
Victime moins coupable que l'agresseur : victime par ignorance, par imprudence (la femme qui laisse sa fenêtre ouverte une journée d'été).
-
Victime aussi coupable que le délinquant : victime volontaire (roulette russe) - suicide par adhésion ( secte du temple solaire) - euthanasie - amour désespéré, époux qui ne désire plus vivre à la mort de l’autre - duel, rixe.
-
Victime plus responsable que le délinquant : provocation au délit.
-
Victime coupable : cas de légitime défense - victime qui simule un délit (escroquerie) - victime imaginaire (paranoïaque, mythomane, sénilité, immaturité).
Mendelsohn va aussi émettre l’idée qu’une victime présente une cause biologique, psychologique, sociale, en lien avec sa vulnérabilité ou rattachée à son passé et dresser une liste de victimes potentielles (1969) dans laquelle il distingue : la victime d’un accident de travail - celle d'un l’accident de la circulation - l’enfant victime devenu délinquant - la victime de génocide - et la victime de chantage. En 1974, ses travaux prennent une nouvelle orientation, il cherche à réduire la victimisation (certaines professions exposent à plus de risques de victimisation que d'autres) afin : d'éviter la re-victimisation après une expérience de victime - reconnaître l'échec de la prévention puisqu'elle n’a pu empêcher l’acte de se reproduire. Il va en 1979 attribuer les causes de victimisation à cinq facteurs dits fondamentaux : Naturel : catastrophes naturelles - Société : pauvreté, surpopulation, dépopulation, manque d’éducation, prostitution - Transports : l’augmentation de la vitesse et des capacités transportées qui ne cessent d'entraîner une augmentation toujours plus importante du nombre des victimes - Criminalité : vol, agression, drogue - La victime elle même qui devient la cause du dommage.
D’autres chercheurs allaient publier leurs travaux sur le sujet. Pour Ezzat Abdel Fattah, il s’agit de mieux comprendre le phénomène criminel pour déboucher sur des mesures préventives adaptées. Pour lui : « le comportement humain ne peut être isolé de la situation qui l’a déclenchée. » S'il y voit le rattachement de la victime au criminel, il n'oppose pas le criminel coupable à la victime innocente. Il s’attache à la personnalité de la victime à travers ses traits biologiques, psychologiques, moraux, sociaux, culturels, ses relations avec le délinquant et sa contribution dans la survenance de l’acte final en mettant en exergue la « responsabilité » de la victime (imprudence, manque de précaution, etc.).
Pour nombre de victimologues, les agissements du criminel ne dépendent pas uniquement de ses penchants, inclinations, affects, ni de ses pulsions, ils parlent de victime :
-
Indifférenciée : victime du hasard (Elle était au mauvais endroit au mauvais moment).
-
Latente : prédisposition inconsciente à jouer le rôle de victime.
-
Par étalage : suscitant l’envie.
-
Par imprudence : incitation à être l’objet du délit (clé sur la porte).
-
Par esprit de lucre : espérance d’un profit illicite.
-
Par provocation : incitation de l'agresseur au passage à l'acte.
Quand bien même serait-on disposé à accepter cette catégorisation des victimes, ce dernier point reste peu recevable à l'égard d'enfants n'ayant pas le pouvoir de discernement.
Au rôle ou scénario « joué » par la victime, il convient de prendre en compte les facteurs situationnels susceptibles de venir déclencher le comportement criminel que Ellenberg ramène à trois types fondamentaux :
-
Le criminel victime : avant le passage à l’acte il a lui même été victime.
-
La victime latente : qui présente des prédispositions à devenir victime en exerçant une attraction sur le criminel.
-
Relation spécifique : victime-criminel, comportement névrotique, le couple pathologique.
Selon Paul Séparovic, le but de la victimologie doit viser à : développer des mesures destinées à réduire le nombre de victimes - atténuer les effets de la victimisation - favoriser la solidarité. On se rapproche là de l'attitude de soutien post-attentat. La victime qui souffre de : symptômes physiques, psychiques, moraux, problèmes financiers doit être présente à l'instruction, au procès, bénéficier des mêmes droits (présence d'un défenseur, respect de la procédure) et bénéficier d'un soutien psychologique. Bien que cet auteur établisse deux catégories de victimologie, la victimologie pénale liée à la criminologie et victimologie générale qui couvre plusieurs secteurs, il en revient cependant aux facteurs : Biologiques :
a) âge : faiblesse physique, psychologique, adolescent à la recherche de valeurs ;
b) sexe : les femmes sont majoritairement victimes ;
c) état physique : handicap, ébriété, addiction.
Facteurs sociaux :
a) Métiers à risques : policier, prostitué, chauffeur de taxi, expatriés.
b) Délinquants : victimes de leur façon de vivre.
c) Mode de vie : mauvaises fréquentations, lieu à risques.
d) Condition socio-économique : pauvreté, exclusion.
e) Isolement : personne éloignée (étudiant, vieillard).
Facteurs psychologiques :
a) Négligence, imprudence.
b) Cupidité, vénalité, avarice.
c) Confiance aveugle (relation familiale, amicale).
d) Méfiance pathologique qui attire les délinquants.
e) Instabilité amoureuse : homosexualité, fréquentations à risques.
f) Discrimination : professionnelle, sociale, religieuse.
Certaines victimes présentent une forte probabilité d'être à nouveau victime (victimisation multiple), risque d’autant plus accru que la personne présente toujours l’indice ou le coefficient de vulnérabilité qui avait pu être à l'origine de sa première exposition délictuelle, on parle alors de surexposition. Il a été souvent constaté que le délit se produit assez souvent là où la victime pensait être en sécurité : famille - cohabitation - voisinage - relations professionnelles, amicales (75 % des crimes se produisent entre gens du même milieu, il y a donc une certaine similitude ou proximité entre auteurs et victimes).
Si la victime tend de plus en plus à être prise en compte et reconnue comme telle, cela nécessite cependant la présence de certaines barrières. Il existe aussi les fausses victimes, une jeune femme s'est faite hospitalisée le 13 novembre et a déclaré avoir été blessée au Bataclan en s'échappant par une fenêtre dans le but d'extorquer 10 000 euros au Fonds de garantie des victimes de terrorisme. D'autres victimes vont brandir la menace d'une procédure à l'encontre d'un soi-disant auteur d'infraction (chantage). L'inculpé peut lui aussi avoir subi des dommages lors de la commission de son méfait et engager une action en responsabilité contre la victime ou contre un tiers. Et pour cause, la justice est rendue sur le droit et non sur le bien ou le mal. Lors d'une riposte en légitime défense par exemple, l'agresseur peut se retourner contre l'auteur de la riposte si celui-ci l'a abandonné gisant sur le sol sans lui porter secours. D'agresseur il est devenu victime.
Lors d'une l'action au pénal ou au civil portée par la victime devant le tribunal, l'inculpé peut se reconduire demandeur sur cette action, il était donc normal que la législation soit en mesure de déjouer ce tempérament procédurier abusif de la partie civile grâce à la notion de responsabilité civile délictuelle (article 91 du CPP). Les criminologues sont allés bien plus loin, puisque l'État a pour mission d'assurer l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens, il peut avoir une part de responsabilité pour avoir manqué à sa mission et n'avoir pu empêcher le délit. C'est particulièrement vrai dans les affaires de terrorisme dans lesquelles l'indemnisation des victimes reste à charge de l'État. Le tribunal administratif de Nîmes a estimé à un tiers la part de responsabilité de l'État à l'égard de la famille d'Abdel Chennouf, ce militaire assassiné le 15 mars 2015 par Mohamed Merah.
Quelles sont les parts de responsabilité dans le drame du 14 juillet à Nice ? Les parents qui avaient voulu faire plaisir à leurs enfants en se rendant à une fête alors que les services de renseignement avaient envisagé de possibles attentats ? Le loueur de véhicule pour fourniture de moyen et qui n'aurait pas signalé le camion non restitué à la date convenue du 13 ? La cousine qui a fait venir son cousin de Tunisie pour l'épouser ? L'État responsable d'avoir permis son séjour ? Le type de gouvernance ? La justice ? Les divers organismes sociaux véritables incitateurs au maintien sur le sol ? Le préfet pour le manque de moyens mis en œuvre ? La ville pour non respect de l'interdiction de circulation des PL ? Le géniteur de l'assassin ? Les électeurs, etc. ? Les interrogations sont nombreuses et les réponses apportées le seront un peu moins. La chaîne est longue et la réflexion ouverte.
19 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON