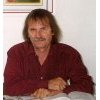Vladimir Poutine et le KGB : une histoire d’amour qui supplée aux anciennes carences du Parti communiste d’Union soviétique
Tout en nous penchant sur la biographie de Vladimir Poutine telle qu’elle peut nous être connue en Occident, nous allons essayer de comprendre d’où vient, à cet homme-là, la manifeste clarté de vue dans les affaires internationales qui a fini par modifier complètement la perception que le monde peut avoir, de la Russie, après une quinzaine d’années d’exercice du pouvoir par ce personnage d’abord plus ou moins énigmatique..

Il est certain que Vladimir Poutine dispose d’un appui très solide dans la confiance qu’il fait à ce qui était désigné, lorsqu’il était plus jeune, par les trois lettres : K, G, B. En français, ce dernier acronyme pourrait être rendu par : Comité pour la Sécurité de l’État.
Successeur du MVD (ministère des Affaires intérieures) qui avait, lui-même pris la suite du NKVD (Commissariat du peuple aux Affaires intérieures), le KGB avait été créé le 13 mars 1954, c’est-à-dire un an presque jour pour jour après la mort de Joseph Staline (5 mars 1953).
Si crimes de ce dernier il y a eu, l’exécuteur en aura été le prédécesseur resté célèbre du KGB : le NKVD. Sur le point de savoir ce que Vladimir Poutine pense lui-même du « petit père des peuples » et du sang qu’il pourrait avoir fait couler de façon plus ou moins torrentielle, nous pouvons tout d’abord nous en remettre au témoignage de l’un de ses ex-collègues dans l’organisme auquel il a longtemps appartenu, un certain Oussolzev. C’est Frédéric Pons qui s’en fait l’écho dans la biographie de Vladimir Poutine déjà citée :
« En petit groupe, ses vues politiques étonnaient pourtant ses amis : « Il doutait des exactions du KGB sous Staline, mais il était visiblement choqué par les abus de la justice en Union soviétique et disait sa sympathie pour les critiques du Kremlin, des gens comme Sakharov. » » (Pons, page 71)
Il y a déjà là quelque chose qui aurait tendance à nous laisser sans voix… En effet, loin de devoir incriminer le NKVD, Vladimir Poutine sait, mieux que beaucoup d’autres sans doute, ce qu’il y a eu d’abnégation, de courage et de don de soi chez ceux qui ont fait leur devoir de citoyen soviétique en son sein ou dans ce qui se rattachait directement à ses activités. C’est Masha Gessen qui nous le rappelle dans l’ouvrage, Poutine – L’homme sans visage (Fayard, 2012), qu’elle n’a manifestement pas écrit pour tresser des couronnes ni à sa famille ni à lui :
« Pendant la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Poutine père avait été affecté dans les troupes dites subversives, de petits détachements chargés d’intervenir derrière les lignes ennemies. Ces soldats étaient placés sous les ordres directs du NKVD – nom que portait alors la police secrète soviétique – et étaient largement issus de ses rangs. On leur confiait des missions suicide : ils ne furent pas plus de 15 % à survivre aux six premiers mois de la guerre. » (page 63)
Evoquant plus particulièrement ce que Vladimir Poutine ne doit guère cessé de porter en lui depuis toujours, Frédéric Pons précise pour nous :
« Affecté à une unité de sabotage du NKVD sur les arrières ennemis, son père se trouve un jour engagé dans une opération en Estonie. Dénoncé par des villageois, traqué par les Allemands, il aura la vie sauve en plongeant dans un étang. Sous l’eau, il respire par un roseau coupé, le temps que ses poursuivants et leurs chiens passent. » (« Poutine », etc., page 41)
Ainsi y a-t-il eu encore, au-delà de la venue au monde du petit Vladimir…
« ce combat pendant le siège de Leningrad où son père fut sérieusement blessé en défendant une portion de terrain indispensable pour la liaison entre les lignes de défense soviétiques. Ce corridor fut préservé au prix de milliers de morts russes. » (page 41)
Vivant, Vladimir Poutine ne devait plus jamais pouvoir séparer son père de ce temps de gloire qui était aussi celui où l’URSS perdait 27 millions de ses habitants pour avoir voulu hisser le drapeau des travailleurs des villes et des champs très haut dans le ciel de l’humanité. Cet homme-là, comme tant d’autres, avait été définitivement estropié :
« Il boita le reste de sa vie. » (page 41)
Au lendemain de ces années effroyables qu’ils devaient aux atermoiements criminels des prétendues démocraties occidentales mises en présence dès janvier 1933 d’Adolf Hitler et de l’ignoble nazisme, les futurs parents de Vladimir durent, comme toute la population soviétique, s’atteler à la reconstruction du pays, et dans des conditions longtemps plus ou moins effroyables tant les destructions avaient été massives, tout particulièrement chez eux, à Leningrad, où la famine organisée par l’envahisseur allemand avait entraîné la mort de plus de 600.000 personnes, s’il faut retenir les chiffres fournis à l’occasion du procès de Nuremberg :
« Ils reprirent leur emploi : pour lui, ouvrier métallurgiste dans la célèbre usine Egorov, sur Moskovsky Prospekt (la route de Moscou), où Lénine annonça en 1917 les objectifs de la révolution ; pour elle, concierge, livreuse, nettoyeuse dans un laboratoire. » (page 42)
Si Vladimir Poutine a bien reçu la leçon d’un certain héroïsme, il semble que, pour ce qui le concernait plus personnellement, il en ait plutôt retenu la perspective dans une dimension autre que celle de la problématique strictement intérieure à l’URSS. Quand, autour de lui, tout se délita à la suite de la chute du mur de Berlin, il choisit de ne se formaliser vraiment que d’une certaine part du désastre collectif :
« Pour être honnête, j’ai seulement regretté que l’Union soviétique perde sa position en Europe, bien qu’intellectuellement je savais que cela ne pouvait pas durer. » (page 72)
Sans doute y a-t-il de multiples raisons à cet absence d’un vrai regard sur la situation intérieure du pays des Soviets. Mais il en est une qu’il ne faudrait surtout pas omettre de signaler : que pensait-on du parti communiste d’Union soviétique en un temps où Vladimir était déjà un jeune homme ? Et plus particulièrement, qu’en pensait-on lorsque l’on arrivait dans la proximité de ce KGB venu succéder au NKVD du temps de papa ?… C’est qu’il y avait un passage obligé pour enfin atteindre ce corps d’élite : il fallait auparavant être devenu membre du parti communiste… d’un parti dont la mauvaise réputation sonnait haut et fort chez les « kagébistes », ainsi que nous le rappelle Frédéric Pons, tout en citant Vladimir Poutine lui-même :
« […] lui qui n’avait jamais été membre du Parti communiste doit prendre sa carte. C’est la règle pour tous les membres des services de renseignement et de sécurité. Ce qui ne les empêche pas de ne jamais recruter des gens ayant été des permanents du Parti : « Ils n’étaient bons à rien, fainéants et carriéristes, avec un ego surdéveloppé. » » (page 60)
La phrase est suffisamment brutale pour qu’il ne nous soit plus possible d’en oublier l’écho avant longtemps… Et sans doute y a-t-il une vérité profonde dans ce que nous indique Masha Gessen :
« Comme d’autres membres de sa génération, Poutine remplaça la foi dans le communisme, qui ne paraissait plus ni plausible ni même possible, par la foi dans les institutions. Sa loyauté allait au KGB et à l’empire que celui-ci servait et protégeait : l’URSS. » (L’homme sans visage, etc., page 147)
Alors, oui, il faut en convenir : c’est bien le KGB qui, à travers Vladimir Poutine, a sauvé de la ruine totale cette Russie qui se présente, d’abord et avant tout, comme un vestige de l’URSS abandonnée en 1953, malgré lui, par Joseph Staline, à un parti communiste incapable de se ressourcer auprès de sa jeunesse ouvrière…
Sans doute le vérifierons-nous assez rapidement.
NB : Pour entrer davantage dans la réflexion conduite ici, et l’étendre à des questions bien plus vastes, je recommande que l’on s’inscrive dans le groupe « Les Amis de Michel J. Cuny » sur Facebook.
21 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON