Peur et soumission politique
La peur est peut-être, parfois et dans certains cas, le « commencement de la sagesse », mais dans son usage politique, elle contribue à asservir.
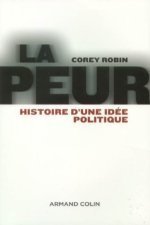
Dans un livre récent, Histoire d’une idée politique (Fear : History of a Political Idea), le politologue américain, Corey Robin, entreprend une analyse très
particulière de son pays, qui, présenté souvent comme modèle de libéralisme
politique, est devenu à ses yeux un système de répression, où la peur, comme
sous le maccarthysme, est devenue instrumentalisée aux dépens de certaines
libertés individuelles, en stérilisant le débat politique. Son analyse veut
s’appliquer à l’ensemble des démocraties où la peur est utilisée comme un moyen
au service d’une politique
répressive.
"La peur est, dit
l’auteur, un instrument au service d’une élite au pouvoir ou d’insurgés en
marche, instrument créé et façonné par des responsables (ou des activistes) qui
espèrent en tirer un bénéfice politique, soit parce qu’elle peut les aider à
atteindre un objectif politique déterminé, soit parce qu’elle reflète ou donne
du poids à leurs croyances morales ou politiques, quand ce n’est pas pour ces
deux raisons réunies."
Selon Martin Scheinin, rapporteur spécial de l’ONU contre le terrorisme : "... Il est clair que de
nombreux gouvernements utilisent le concept de terrorisme pour soutenir des
intérêts politiques par la voie de la stigmatisation de leurs opposants, et ce phénomène
prend bien des formes. L’une d’elles consiste à tirer profit d’actes de
terrorisme isolés ou individuels en les attribuant à des groupes, des
organisations, des mouvements politiques, des groupes ethniques, alors
catalogués comme terroristes sans le moindre fondement. Dans d’autres cas, un
gouvernement tente tout simplement de neutraliser ses opposants en les traitant
de terroristes sans qu’ils ne se soient jamais livrés à un acte de terrorisme...
Les États peuvent s’impliquer dans des actes de terrorisme ou se livrer en
coulisses au terrorisme en recrutant ou en finançant des groupes terroristes
qui réalisent des attaques terroristes..."
On reconnaîtra derrière ces
propos des allusions claires à des pratiques d’Etat, telles que l’utilisation
de groupes extrémistes dans l’Italie des années 70, l’usage qu’a fait la CIA de
certains groupes islamistes, à usage externe (Afghanistan)... Créer la peur,
l’utiliser, l’amplifier, afin d’en tirer un bénéfice politique et/ou
économique est une vieille pratique dont on trouve déjà des exemples dans
l’Antiquité. Par exemple, Marcus Licinus Grassus, en 70 avant JC, profita de la
révolte des esclaves menée par Spartacus pour pouvoir provoquer la terreur dans
le cœur de Rome, dont Spartacus avait déjà battu la garnison lors d’une
bataille. Il profita de cette action pour se faire déclarer prêteur puis consul
et devenir, sous le Triumvirat, un des fossoyeurs de la République romaine, au
profit d’un césarisme puissant, de plus en plus divinisé. On connaît aussi,
plus proches de nous, les méthodes que les nazis ont pratiquées pour engendrer
une peur sociale utile au régime : "Ils ont arrangé des affrontements,
allumé des feux, causé autant de problèmes qu’ils le pouvaient, pendant
qu’Hitler faisait des discours promettant qu’il pouvait arrêter la vague de
terrorisme et de criminalité si on lui accordait des pouvoirs uniques. Ensuite,
le Reichstag (le parlement allemand à Berlin) fut brûlé dans une attaque
terroriste planifiée." Aux Etats-Unis, on se souvient de l’affaire du Maine,
celle de Pearl Harbour ou celle de l’USS Maddox, dans le déclenchement de la
guerre du Vietnam sous Johnson.
Machiavel avait bien vu
l’importance politique de la gestion de la peur. "Maintenir les hommes
dans la peur, c’est les maintenir sous un grand pouvoir. Le pouvoir suprême
ici-bas est le pouvoir politique. Il n’est donc pas étonnant que les techniciens
du pouvoir aient cherché à justifier l’usage de la peur. Une pratique
machiavélique de la politique n’a aucun mal à justifier la valeur et l’emploi
de la peur. Machiavel enseigne que le prince doit être craint, mais cependant
ne pas être haï. S’il est haï, il retourne le peuple contre lui, s’il est
seulement craint, il maintient son autorité et son pouvoir. Aussi est-il de ce
point de vue de bonne politique de maintenir la peur, sans pour autant qu’elle
se transforme en haine. Un peuple maintenu dans la peur reste « tranquille ». Il
n’ose plus s’opposer au pouvoir.
Un peuple qui se met à haïr son souverain cherchera à le renverser et il suivra
ceux qui le conduiront à la révolte. Tous les tyrans que l’humanité a pu
engendrer le savaient. Il existe une habileté calculée, rusée, "machiavélique" à manipuler l’insécurité et utiliser la peur pour
assurer la légitimité du pouvoir. Machiavel dans Le Prince, n’en
fait pas cependant un système, pour lui c’est surtout une question
d’opportunisme politique, de tactique. Il est en tout préférable d’user de la
loi".
Un autre auteur américain, Jonathan
Simon, enseignant à Berkeley, analyse dans Governing through Crime
l’usage politique de la peur engendrée par l’instrumentalisation de la délinquance
interne. "La ’guerre contre le crime’ est devenue un thème
consensuel sur la scène publique américaine depuis une quarantaine d’années.
Mais elle répond moins à une demande sociale spontanée qu’à une construction
idéologique et politique conjointe des démocrates et des républicains".
Selon lui, "la législation encourage systématiquement la vengeance et la haine
ritualisée plutôt que la prévention de la criminalité et la réduction de la
peur. Les juges sont plus que chez nous sous l’influence des passions publiques. ’La
politique sécuritaire est forcément plus idéologique, plus centrée sur la peur
et l’émotion, et fait plus appel à l’imaginaire.’ L’auteur cite le cas de
la Californie, où aujourd’hui, ’le réseau des prisons est un mammouth qui consomme
bien plus de ressources que l’enseignement supérieur et qui domine de loin les
dépenses publiques (plus précisément la part du budget dont l’État dispose
librement). Malgré ces dépenses, les prisons californiennes, bâties pour n’être
rien de plus que des hangars humains, sont devenues des lieux insalubres et
surpeuplés dans lesquels des prisonniers meurent chaque semaine de maladies
habituellement sans gravité, mais qui ne sont pas traitées’".
Son livre présente, selon
S.Body-Gendrot, "une société américaine cimentée par le ’gouvernement
par la peur’ ". Le crime est un thème unificateur, et tous les groupes sociaux
reconnaissent leurs peurs propres dans le discours sur les menaces qui planent
sur les personnes et les biens. En même temps, le choix de l’entre soi, de
s’enfermer soi-même et de laisser les autres dehors, produit la croissante fragmentation
de la société américaine. Les formes de protection sont autant de ségrégations,
et font que chaque sphère produit ses propres normes, ses codes, ses règles,
ses symboles, ses histoires, comme c’est le cas pour les résidences fermées,
les gangs ou les entreprises. Si l’on suit cette opinion, ce n’est plus le
crime qui sépare les insiders des outsiders. Fermer hermétiquement les
frontières, aggraver les peines de prison ne fonctionne pas. Les meurtres se
multiplient dans des zones interdites ? Tant pis. Ce qu’il faut réprimer, c’est
le passage des frontières, l’intrusion dans une sphère à laquelle on
n’appartient pas. On peut aussi faire allusion à ces nouvelles cités
fermées et surveillées, où de plus en plus de retraités aisés surtout
choisissent de terminer leurs jours, loin des menaces internes qu’ils
fantasment plus qu’ils ne connaissent, des citadelles de fin de vie en quelque
sorte, de tristes Fort Chabrol où la présence d’enfants, trop bruyants, n’est
même plus acceptée.
Le 11-Septembre a réveillé
des peurs latentes et en a suscité de nouvelles. Selon Serge Rouleau, du Québec libre, "... Les
événements tragiques du 11-Septembre 2001 ont fourni aux politiciens du monde
entier une occasion inespérée d’assurer la pérennité du mode de gouvernance par
la peur. Pour s’assurer que le message serait bien compris par le monde entier,
George W. Bush qualifia le geste des terroristes d’’acte de
guerre’. Le terrorisme est une source inépuisable de dangers potentiels.
Les actes terroristes sont spectaculaires et créent un fort sentiment
d’insécurité dans les populations. La plupart des gens sont convaincus que les
gouvernements sont les seuls organismes susceptibles de protéger les
populations et de prévenir les actes terroristes. Depuis 2001, la guerre au
terrorisme est devenue le véhicule privilégié pour maintenir les populations en
état de soumission.
Les politiciens ont toujours su que la peur est le meilleur moyen de convaincre
les populations réticentes à accorder leur soutien inconditionnel au
gouvernement. Que ce soit pour détourner l’attention de la population, pour
justifier plus de taxes ou pour faire accepter une législation impopulaire, les
politiciens peuvent toujours compter sur un événement dramatique réel ou
annoncé."
On a vu avec quelle facilité
la loi Patriot Act a
été votée en octobre 2001, pratiquement sans discussion. "Pas du tout à un
paradoxe près, le gouvernement américain avait choisi ’liberté immuable’
comme nom de code pour son opération en Afghanistan, la réponse du berger à la
bergère après le 11-Septembre. Or, les premières victimes de l’onde de choc du
11-Septembre ont justement été les libertés
individuelles." Noami
Wolf a analysé la peur qui ronge la société américaine et qui empêche
parfois les plus courageux et les plus lucides de s’exprimer et de se
manifester publiquement. Une chape de plomb pèse sur les esprits et les médias,
même si les revers en Irak commencent à libérer davantage la parole. Ce développement
de la peur donne aussi lieu à une industrie de
plus en plus florissante.
Chez nous, le mythe de
l’insécurité se porte bien et le fantasme des "classes dangereuses", qui
fleurissait au XIXe siècle, tend à reprendre de la vigueur, sous une autre
forme, notamment celle des banlieues présumées en quasi-état de guerre
civile... La crise et la montée des inégalités aidant, avec son cortège de
chômage, de précarité, de régression salariale, de remise en question du droit
du travail, les peurs sont exacerbées et détournées de leurs causes pour
constituer des moyens de pression psychologique qui échappent à la conscience
claire des individus. L’insécurité,
souvent confondue avec diverses formes d’incivilité, est montée en épingle. La
peur, ou plutôt l’angoisse sociale diffuse et entretenue, est devenue un moyen
de gestion courante des affaires humaines, pour favoriser la résignation (there
is no alternative), endiguer les mécontentements... La précarité, dont personne
ne se sent plus tout à fait exclu, engendre une peur latente du lendemain, qui
ne favorise pas l’ouverture d’esprit, la compréhension des problèmes du présent,
la disponibilité à l’action revendicatrice et militante. La volonté tend à être
neutralisée. Les individus sont prédisposés au repli sur la sphère privée
et y sont incités par des distractions diverses et une consommation qui fait
oublier... Le sentiment de peur diffuse infantilise.
Un homme qui n’a pas peur est libre... trop libre, incontrôlable.
------Le sage a dit : « Ne crains personne. Ne te crains pas toi-même ».
93 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 lus-de-
lus-de-

