Répliques à l’Université
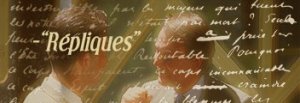
Samedi dernier, l’émission Répliques sur France Culture était consacrée aux « malaise(s) dans l’Université ». Alain Finkielkraut et ses deux invités, Olivier Beaud et Jean-Robert Pitte, deux universitaires très impliqués dans les conflits actuels nous permettaient de mieux saisir les dysfonctionnements internes au système universitaire et la nécessité d’un changement en profondeur. A l’écoute de l’émission, il m’a semblé qu’une voix manquait toujours dans ces débats : celle des étudiants eux-mêmes. Ce sont les premiers impliqués, et les premières victimes de ce système incompétent. De vieux souvenirs personnels ont alors rejailli, et je n’ai pu m’empêcher d’écrire à M. Finkielkraut pour en témoigner. Ceci fait, j’ai pensé qu’il était dommage que cette lettre ne soit lue que par - peut-être - une personne. Ici, elle rencontrera sans doute un public plus large. Je n’attends rien d’autre que quelques réactions, et peut-être l’ouverture d’un débat.
Bonjour,
J’ai trouvé votre émission très intéressante ce matin. Les deux universitaires ont, cela dit, omis un point important qui me semble en premier lieu faire partie du "malaise dans l’Université", un point dont on ne peut pas ne pas parler. Il s’agit de la profonde et inquiétante médiocrité de l’enseignement universitaire. Je tire cette conclusion de ma propre expérience dans ces lieux : ayant suivi plusieurs années en faculté de lettres modernes, j’ai fini par m’enfuir, dégoûtée et intérieurement déstructurée. Cependant, ce n’est pas seulement en mon nom propre que je m’exprime ici ; j’ai autour de moi quelques amis remplis des mêmes sentiments. Mon expérience personnelle semble être assez répandue chez les personnes qui ont fréquenté les facultés de sciences humaines ; les zones de sciences dures me paraissant beaucoup moins abandonnées.
Le principal problème, c’est que le niveau d’exigence en faculté de lettres modernes est faible, très très faible. Un étudiant quelque peu consciencieux, exigeant et passionné (oui, ça existe !) ne peut que réussir ses années empli d’une sensation de vide et d’inutilité insupportable. L’enseignement en lettres modernes se résume à quatorze heures de cours par semaine. Certes, tout le monde sait que l’université laisse place à l’autonomie, les cours étant destinés à être approfondis au-dehors. C’est un système difficile à suivre mais incontestablement intéressant. Cependant, le niveau des cours et les examens ridicules auxquels il faut se soumettre ne donnent absolument pas envie de se mettre au travail, qui bientôt ressemble aux cours que l’on nous donne : médiocre et quasiment inexistant. Une fois lors d’un examen, les professeurs nous ont dit que nous n’étions pas ici pour être évalués, mais pour approfondir notre culture générale. Par conséquent, nous pouvions prendre notre cours à côté de nous pendant l’examen, qui consistait d’ailleurs simplement en des questions de cours. Un ami m’a raconté que pour lui les examens n’étaient pas très difficiles ; on leur donnait les sujets la veille. A eux d’y réfléchir, d’élaborer un plan. Il leur restait ensuite quatre heures le lendemain, simplement pour rédiger leur dissertation.... C’est simplement révoltant. Pendant ces années, je n’ai quasiment rien appris. L’un des deux universitaires que vous interviewiez disait à un moment que ce qui était révoltant, c’est que certains étudiants soient obligés de travailler pour financer leurs études. Moi, j’ai travaillé, et heureusement ! quatorze heures de cours par semaine, cela ne remplit pas une existence. Le cursus de lettres modernes est conçu de telle façon que nous nous sentons totalement désinvestis et déconnectés du réel. Peu de cours, peu d’exigence, rien que du vide... En d’autres mots, le système universitaire est névrosant. J’ai connu d’autres personnes autour de moi qui ne s’en sont jamais relevées. Il est très facile de perdre pied et de n’avoir plus aucune structure de vie lorsqu’on navigue dans un tel univers. On perd rapidement contact avec toute habitude de travail, à long terme, cela vous met dans l’incapacité de vous adapter au monde du travail. C’est un système qui vous sépare de la vie, à un âge où l’on est censé vous y préparer. La réalité apparaît bientôt derrière des murs, parfaitement intouchable. Il faut ensuite avoir une force intérieure immense pour pouvoir remonter.
Et cela n’est pas dû à la médiocrité des étudiants - car tous ne le sont pas-, mais à la médiocrité de l’université elle-même. On incrimine beaucoup ces centaines d’étudiants qui peuplent les facultés sans y être à leur place ; on ne parle jamais des quelques autres qui auraient dû y être et qui ne l’ont pas trouvée. Il est grave que des personnes qui ont le profil de l’université soient déçues au point de fuir et de ne pas envisager cette voie pour la suite de leur existence.
Ce système est dans une déroute complète et le problème est extrêmement grave. Le système universitaire détruit des destinées, des gens souffrent réellement de ce système lamentable.
7 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









