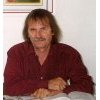Des taux d’intérêts à 26% l’an pour mettre au pas les micro-entrepreneurs africains !…
par Michel J. Cuny et Issa Diakaridia Koné

Il y a de la « microfinance » dans la mesure où la micro-entreprise ne peut pas fonctionner, par elle-même, comme une machine à produire du profit… Et on pourrait dire que c’est ce qui étonne – et ce qui amuse – tous ceux qui voudraient ici jouer les apprentis-sorciers… En prêtant de toutes petites sommes pour très peu de temps, et en exigeant le versement de taux d’intérêts très importants, la microfinance mord l’activité avant même que celle-ci ait commencé…
Tout ceci agit comme le pompon de la fête foraine : il n’y en a généralement qu’un par séance, et, pourtant, chaque enfant peut croire qu’il va s’en saisir… L’heureux gagnant fera gratuitement le tour suivant… Au-delà de quoi, il ne gagnera strictement rien : il n’aura fait qu’aider la crédulité publique à se développer… tout en amusant la galerie.
Ainsi, dans le Rapport de la Banque mondiale (1996), Peter Fidler et Leila M. Webster prétendent en faire l’amer constat :
« Lorsque l’on demande aux entrepreneurs d’Afrique de l’Ouest de citer la contrainte financière la plus sérieuse, la majorité répond « le manque d’argent ». » (Idem, page 13)
Voilà le pompon…
Dans ce contexte-là, les biens matériels ne sont pas d’abord ce qui semble manquer… Certes, ainsi que nous l’avons vu, il y a un défaut d’infrastructures, de routes, d’eau, d’électricité, voire même de nourriture, etc., en Afrique de l’Ouest. Mais ce qui est un vrai souci pour la Banque mondiale quand elle prétend s’intéresser à la microfinance – alors qu’au même moment elle prétend tout d’abord lutter contre la pauvreté et les crises alimentaires -, c’est l’équivalent argent de tout ce qui est nécessaire à l’activité de production et à la consommation de survie… Pour elle, c’est par l’équivalent argent que tout doit passer… Ainsi ne pourrait-il y avoir de production que si elle juge qu’elle est rentable en argent, et tout de suite… Les travaux qui nécessitent du temps et qui ne s’attachent pas qu’à faire immédiatement de l’argent n’intéressent effectivement pas du tout la microfinance : elle n’est pas équipée pour y intervenir avec les seules miettes dont elle dispose…
La microfinance s’offre uniquement à placer quelque chose de précis au départ de toute activité économique : une somme d’argent de toute petite taille, et qui devrait engager à produire quelque chose qui, d’abord, ne sera pas important par lui-même : il faudra seulement que cela soit vendable, et que la vente se traduise par la capacité acquise, de ce fait, de rembourser la dette initiale…
Les auteurs du Rapport n’ont pas manquer d’observer un autre phénomène qui fait jouer, à nouveau, la question de l’équivalent argent mais, cette fois-ci du côté des acheteurs de ce qui prétend à être produit :
« Il est fréquent que des entreprises travaillant par à-coups ne soient capables d’acheter des matières premières et d’embaucher du personnel que lorsqu’elles reçoivent une commande d’un client et parfois un acompte. » (Idem, page 14)
Dans ce cas, le financement se fait à l’envers : il vient de l’avant, au lieu d’être investi par l’arrière. C’est donc une activité bancaire à rebrousse-poil…
Passons maintenant sur un autre terrain… Historiquement, la microfinance a été précédée par ces ONG (Organisations non gouvernementales) qu’elle a tendance à traiter de haut quand il s’agit d’aborder la question du financement de l’activité économique des plus pauvres d’entre les pauvres… Ces ONG ont obtenu de nouvelles facilités pour s’introduire dans différents pays d’Afrique de l’Ouest depuis que le réchauffement climatique a été propulsé comme un thème dominant dans l’idéologie conquérante portée par l’Occident. On les aura vues arriver comme des sauterelles ou des criquets. C’est ce que constate le Rapport :
« Dans certains pays, les ONG nationales et internationales sont devenues d’importantes sources de services financiers pour les personnes à faibles revenus. De nombreuses ONG sont arrivées en Afrique de l’Ouest avec les interventions de secours à la suite de sécheresses. » (Idem, page 16)
Et le Rapport souligne aussitôt le caractère anarchique de cette nouvelle forme d’intervention qui ne sait sans doute pas très bien faire le métier de banquier :
« Certains pays comme le Burkina Faso, la Gambie et le Mali ont une pléthore de programmes d’ONG alors que d’autres, comme la Mauritanie, en ont très peu. » (Idem, page 14)
Pour les spécialistes autoproclamés de la microfinance, les ONG ne sont que de petits joueurs…
« Les études documentaires et les visites sur le terrain indiquent que la plupart des programmes de micro-financement mis sur pied par les ONG ont réussi à atteindre les pauvres avec leurs services, mais la plupart des ONG paraissent faibles tant du point de vue de leur étendue que de leur durabilité financière. » (Idem, page 16)
En effet, l’affaire à réaliser est beaucoup plus importante qu’il n’y paraît :
« Un programme s’adresse en règle générale à plusieurs centaines de personnes à faibles revenus (souvent surtout des femmes) avec des petits prêts et parfois par le biais de cours de formation, cependant, les coûts par personne restent élevés. De tels programmes ne peuvent survivre qu’avec l’aide de fonds fournis par des bailleurs de fonds. » (Idem, page 16)
Ces « bailleurs de fonds », qu’on peut très bien retrouver derrière certaines ONG, ne sont bien sûr pas des plaisantins : ce sont des gestionnaires de la politique d’intervention sur des terrains où il est question d’instituer une charité intelligente… celle qui apporte avec elle l’institution de l’économie libérale, la mise en œuvre de la liberté d’entreprise… et la constitution d’un prolétariat véritablement travailleur… celui qu’exige l’exploitation de l’être humain par l’être humain.
Être « bailleur de fonds », c’est être détenteur de capitaux en quête d’un placement qui peut très bien prendre la forme d’une véritable conquête de caractère politique… De ce point de vue, l’Afrique de l’Ouest est un terrain particulièrement propice à ce genre de conquérants…
Eh bien, justement, déclarent Peter Fidler et Leila M. Webster…
« Certaines ONG de la région semblent comprendre la nécessité d’atteindre une taille plus importante ainsi qu’une pérennité financière. » (Idem, page 16)
Mieux encore !… Il paraît qu’il existe déjà un modèle ré-utilisable :
« Sahel Action PPPCR au Burkina Faso par exemple, offre des petits prêts aux populations pauvres rurales de manière relativement efficace. » (Idem, page 16)
Regardons cela de plus près :
« Au mois de février 1995, le programme comptait 13 960 prêts en cours et la taille moyenne des prêts était de 48 $US. Ces 13 960 prêts avaient été accordés par 32 agents seulement, avec une moyenne de 436 prêts par agent. » (Idem, page 16)
Et c’est à ce moment-là des explications fournies par les principaux rédacteurs du Rapport (1996) de la Banque mondiale, que nous arrivons à quelque chose qui doit nous faire tendre l’oreille :
« Le taux d’intérêt réel est de 26 p. 100 par an et les taux de remboursement se situent juste en dessous de 100 p. 100. » (Idem, page 16)
Un taux d’intérêt qui arrache !… Eh bien, même cette cruauté extrême relativement aux plus pauvres n’est pas encore suffisante. Peter Fidler et Leila M. Webster n’hésitent pas à l’affirmer :
« Sahel Action PPPCR a un long chemin à parcourir avant d’atteindre une pérennité financière complète, mais cette organisation semble s’être engagée sur la bonne voie. »
C’est ce que nous allons voir…
NB. La suite immédiate est accessible ici :
https://remembermodibokeita.wordpress.com/2020/05/16/burkina-faso-une-tentative-de-microfinance-sous-tutelle-francaise-echoue-lamentablement/
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON