Michael Moore, une rage impuissante
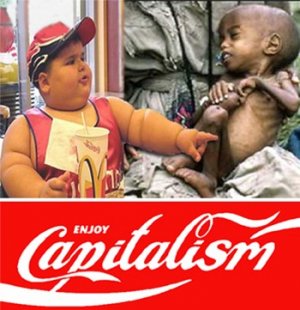
A bien y regarder Michael Moore ne nous raconte pas comment les Américains ont d’abord chéri le capitalisme pour finir par s’apercevoir à quel point celui-ci est néfaste et qu’il est urgent de trouver des solutions de rechange durables, mais combien le petit garçon qu’il fut dans les années cinquante finissantes vivait heureux. C’est plus ça. Papa allait au travail en voiture dans les vastes usines de la General Motors, à Flint. En ce sens, comme le remarque Henry Moreigne dans Agoravox, « Capitalism : a love story constitue le prolongement logique de son premier film réalisé en 1989, Roger et moi dans lequel il dénonce les conséquences des mesures de restructuration de Général Motors sur Flint, sa ville natale (30 000 licenciés dans une agglomération de 150 000 habitants). Michael Moore présente à ce titre sa dernière œuvre comme “une forme d’aboutissement, un point culminant de mon travail.“ ».
On sent le bonhomme usé. Même l’élection d’Obama ne lui redonne pas vigueur. Capitalism : a love story peut se lire comme l’autoportrait d’un homme désabusé qui s’interroge sur sa capacité à continuer à tourner des films. Il relève sa propre supercherie commencée avec Roger et moi. Dans ce film, ce n’est pas Roger qui compte. D’ailleurs chacun se souvient que le fameux Roger, on ne le voit jamais (alors que le cinéaste l’a vraiment rencontré). Mais à l’époque ce genre était nouveau, amusant et frais. Non ce qui compte c’est moi, Michael Moore, aujourd’hui un peu plus gros, un peu plus fatigué.
Retour sur les années cinquante. A l’époque, aux Etats-Unis, les ouvriers de l’industrie automobile étaient les rois du monde. Et puis, le Japon et l’Allemagne, détruits par les alliés pendant la seconde guerre mondiale, se refont une santé. La mondialisation pointe son nez. La compétition devient rude. Plus dure sera la chute. De ce point de vue-là le film de Moore est plutôt intéressant car il met un visage sur la souffrance causée par les difficultés économiques. C’est à mettre à son crédit. Pour une fois le cinéaste abandonne la défroque du polémiste populiste pour exprimer une réelle compassion envers les Américains qui souffrent. Les chiffres et statistiques ne disent rien aux gens. Ici au contraire, nous voyons des « vrais » gens raconter leurs histoires personnelles : l’un a perdu son emploi, d’autres, victimes de vautours qui prospèrent sur la misère, sont expropriés alors qu’ils vivent dans un maison qui appartenait parfois à leurs parents ou grand-parents, d’autres encore n’ont pas pu toucher l’assurance décès de leur proche. Un véritable scandale que ne fait qu’aborder le cinéaste qui constate qu’avec ce système d’assurance-vie « vous rapportez plus mort que vivant »
Napakatbra, sur Agoravox, souligne qu’« un des moments forts du film est certainement l’interview de l’avocat Mike Myers, qui dénonce les "dead-peasants insurances", aussi appelées "corporate-owned life insurances" (COLI). Pour faire bref, ce sont des assurances vie secrètement contractées par les employeurs sur la tête de leurs salariés... pour leur seul bénéfice ! Qu’un salarié meurt, et l’entreprise touche un petit pactole : entre 50 000 et 5 millions de dollars. Si une femme décède jeune, c’est le jackpot, son espérance de vie théorique étant des plus élevées. Bingo ! ».
Mais peut-on faire confiance en Moore dans sa défense de la veuve et de l’orphelin ? Un livre, signé Guy Millière (Michael Moore, au-delà du miroir. Editions du Rocher, 2008) dissèque l’oeuvre du cinéaste et éclaire ses zones d’ombre : “Il floue les ouvriers qu’il clame aider, déforme les propos d’un soldat amputé d’une jambe, inverse la chronologie des faits pour diffamer un directeur d’entreprise”, écrit Drzz sur Agoravox.
Autre moment intéressant, mais traité, là encore, de façon superficielle, c’est la relation que Moore entretient avec le catholicisme qui remarque logiquement que le capitalisme n’est pas inscrit dans le marbre de la Constitution américaine. Seulement on a tellement dit au peuple américain que le capitalisme était égal à Dieu et à la liberté que fatalement comment, logiquement, ne pas s’en remettre à lui ?
Il explique comment ce capitalisme industriel a dégénéré en capitalisme financier et devient une force destructrice. C’est ce capitalisme qui est condamnée dans les encycliques papales en raison de la façon dont il subvertit l’ordre de Dieu qui exige que les biens matériels de ce monde profite à la communauté humaine. Le manque de justice distributive pervertit une structure économique capitaliste pécheresse. Le chroniqueur du Washington post admet que Moore atteint dans ce dernier film les frontières de la bouffonnerie, mais que son message n’en est pas moins important : « Michael Moore, « clown de l’année » et « catholique de l’année » en même temps. »
Tous ses films dénoncent quelque chose. Pourquoi pas ? Le cinéaste pourrait se cantonner à une posture de pamphlétaire se contentant de gueuler sa rage. Une rage impuissante : "Moore a depuis longtemps prouvé qu’il était un excellent éditorialiste et comédien, mais il prêche toujours pour la même chapelle. Ses films ne sont pas assez convaincants pour faire la différence. Par conséquent, ils « sont devenus des emblèmes de rage impuissante, écrit the age.
Et surtout contre productive : "Roger & Me n’a pas sauvé les emplois, Bowling for Columbine n’a pas modifié la législation sur les armes ni Sicko celle sur les soins de santé et, en dépit de son intention affirmée à voix haute, Fahrenheit 9 / 11 n’a eu aucune incidence sur la réélection de George Bush".
Il en est ainsi de Capitalism : A love story qui ne convaincra que les esprits déjà convaincus. Moore a trop tendance à perdre de vue son sujet. Parfois on a l’impression que le cinéaste se parodie lui-même ou qu’il a perdu tout contact avec la réalité.
"En fait,ce qui séduit chez Moore, tout le monde en convient, lui le premier, c’est son talent de monteur. De propagandiste au service d’une cause qu’il croit juste. Rappelons que « la propagande désigne l’ensemble des actions menées dans le cadre d’une stratégie de communication par un pouvoir politique ou militaire pour influencer la population dans sa perception des événements, des personnes ou des enjeux de façon à l’endoctriner ou l’embrigader ». Michael Moore, avec ses énormes succès, est devenu un contre-pouvoir (donc une forme de pouvoir) politique", écrit Omnibuzz, toujours sur Agoravox, à propos de l’édition en dvd de Michael Moore, polémique système, documentaire canadien de Debbie Melnyck et Rick Caine tournée en 2006 (Wild Side Video).
Dans Capitalism : a love story, Moore, comme dans ses films précédents, fait semblant de vouloir rencontrer les dirigeants de Wall street. Fidèle à sa méthode il déboule dans les halls en marbre des temples de la finance et déclare au portier qu’il veut rencontrer le PDG. Rires dans l’assistance. Il y a beau temps, vingt ans exactement (depuis Roger et moi), que les patrons ne veulent plus rencontrer un cinéaste qui n’a de toute façon aucune intention de leur donner la parole. S’il le faisait, son scénario sécroulerait de lui-même.
La critique du système par Moore relève de la révolte adolescente. Pour en savoir plus il suffit de revoir le film de William Karel sur la crise de 1929 ou de lire les derniers livres d’Eric Laurent (qui dénonce les conflits d’intérêts et les chassé-croisés des patrons de la finance entre Wall street et la Maison blanche) ou ceux de Jean Montaldo (surtout lorsque ce dernier parle du fameux Angelo Mozillo, l’inventeur des subprimes qui accordait des prêts très préférentiels à ses amis haut-placé tandis que les américains « moyens » étaient condamnés à payer le prix fort).
Probablement dès la fin du film.
88 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









 )
)
