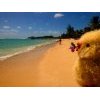Le pétrole se marginalisera lorsque l’Homme aura décidé de s’en passer
Le contre-choc de 2014-2015 illustre un fait bien réel : l’Homme est tout à fait en mesure de s’approvisionner en pétrole, la preuve c’est qu’il n’a même plus besoins d’en chercher, pour le moment… Alors comment s’en débarrasser ?

Toutes les compagnies pétrolières réduisent leurs investissements. C’est peut-être perçu comme une crainte pour les acteurs du secteur, mais c’est surtout le signe qu’il n’est plus nécessaire de courir derrière les découvertes pour assouvir la consommation mondiale. Entre croissance économique atone et amélioration de l’efficacité énergétique de nos sociétés, l’humanité a su maîtriser sa soif pour les hydrocarbures, entraînant une détente temporaire du marché pétrolier.
Aujourd’hui, nous savons que l’appareil productif est en mesure de développer rapidement et amplement de nouveaux sites de production. Certes, cette embellie de l’offre est principalement due au développement des non-conventionnels en Amérique du Nord. Mais imaginez si le pétrole était monté à 130 ou 140 dollars de manière aussi pérenne qu’il l’a été entre 2011 et 2014 ? Quelles autres technologies et quels autres sites auraient pu voir le jour ? Le potentiel d’adaptation de l’offre était sous-estimé, il est aujourd’hui suffisant.
On est donc rassuré, notre société ne verra pas le prix du pétrole s’enflammer par manque de ressource exploitable. Néanmoins, le retour à l’équilibre du marché pétrolier autour des 50 dollars le baril nous positionne devant un dilemme que nous avions oublié, celui de transformer notre modèle énergétique vers des moyens d’approvisionnement plus durables, plus écologiques. Avec une redescente à 50 dollars et grâce à son intégration inchangée dans l’économie mondiale, la compétitivité du pétroler est revigorée, au détriment du développement des énergies vertes. Comment convaincre l’Homme, cette espèce cupide et égoïste, que l’énergie la moins cher n’est pas ce qu’il y a de mieux pour lui ? Comment se débarrasser pour de bon de ces énergies fossiles que la nature peine à recycler ?
L’embellie de l’offre est à observer avec du recul. Les problèmes que rencontre le marché pétrolier depuis qu’il s’est aussi globalisé, c'est-à-dire depuis au moins un siècle, ne se sont pas effacés. C’est tout bonnement l’innovation qui a permis à l’appareil productif de tenir la cadence, mais les problèmes liés à la sécurité opérationnelle et financière ainsi que la sureté sont toujours à l’ordre du jour. Si les écologistes les plus déterminés veulent combattre le pétrole, ils doivent agir au cœur de son système. Ils doivent neutraliser ce qui maintient ce système à un état stable et doivent favoriser l’essor des influences négatives pour accroitre sa vulnérabilité jusqu’à le faire imploser.
Au cœur du système, il y a la notion de rente. Le marché pétrolier a pu engager de gros investissements ces dernières années parce qu’il offrait aux investisseurs internationaux l’occasion de faire de l’argent, alors que l’économie mondiale était asphyxiée. Les investisseurs n’ont qu’une chose en tête, faire de l’argent avec celle qu’ils ont déjà. Par conséquent, il faut arriver à dégrader la rentabilité du secteur pétrolier, donc son attractivité sur les marchés financiers. Les compagnies pétrolières entretiennent cette attractivité grâce à un haut niveau de fiabilité de leurs actifs opérationnels. L’idée est donc de forcer ces actifs à accumuler les échecs et à perdre en viabilité. Il y a un avantage à cette méthode, c’est que les compagnies sont aujourd’hui obligées de mener des opérations d’envergure de plus en plus grande, notamment à l’offshore. Ce qui implique que chaque échec est financièrement de plus en plus lourd à porter. Ainsi, soit il faut les pousser à augmenter davantage l’envergure de ces opération jusqu’à ce qu’elles deviennent impossibles à financer, soit il faut attaquer l’efficacité de ces opérations, notamment en jouant sur les facteurs qui jouent déjà contre celle-ci et contre lesquels les compagnies pétrolières luttent.
Dans ces facteurs, il y a la sureté. Si une région n’est pas sûre, les investisseurs étrangers n’auront aucune envie d’y engager des moyens, par crainte de toute perdre. Malheureusement, dégrader la sureté d’une région veut dire l’embraser, ce qui n’est pas souhaitable. Mais il faut garder l’idée de faire fuir les investisseurs de toutes les régions qu’ils considèreront eux-mêmes impraticables Pour y arriver, tout en évitant d’envoyer une région dans la spirale de la violence, la loi peut jouer le rôle de barrage, sous l’égide des décisions politiques. Or, si la loi d’une région autorise l’exploitation de ses ressources, c’est bien pour améliorer les conditions de son économie, donc de créer de l’emploi et de la richesse. Faire barrage aux compagnies pétrolières reviendrait à empêcher la région de développer son économie. Elle ne pourrait appliquer ce barrage seulement si elle avait des solutions alternatives de développement, comme le choix de la France de se passer du Gaz de Schiste. Mais mettre en place ces solutions semble parfois complexe pour des raisons d’influence politique. Puisque que ce soit pour des régimes autoritaire où les recettes du pétrole font la joie des dirigeant ou que ce soit pour des régimes démocratiques où la population est facilement convaincu de l’avantage économique du pétrole sur d’autres orientations d’investissement, il est assez délicat d’inciter un pays à se passer de la manne pétrolière.
Jouer sur la destination des investissements est donc possible mais pose des problèmes d’influence, puisque chaque pays est souverain et indépendant dans sa stratégie de politique économique. La seule influence que la société occidentale peut avoir, c’est simplement de décourager l’investissement à la source, se servir des raisons qui motivent les investisseurs à placer leur argent dans un pays pour que cette dernière ne contribue plus à la production de pétrole, sans pour autant priver ce pays de capitaux étrangers. Pour cela, il faut proposer aux investisseurs des solutions de substitution tout aussi intéressantes d’un point de vue économique.
Les régions à fort potentiel énergétique dont nous parlions sont exactement l’illustration de ce qu’on appelle un potentiel d’investissement à fort levier. En effet, si elles sont obligées de siphonner leurs sols pour faire vivre leur population, c’est que ces régions ont un potentiel de développement de leur économie bien supérieur à toutes les sociétés plus avancées. Le rendement de l’investissement dans ces pays sera bien plus intéressant que des projets pharaoniques proposés par le secteur pétrolier parce qu’ils seraient moins risqués mais tout aussi rentables. L’idée générale est donc de réorienter l’investissement aujourd’hui destiné aux hydrocarbures vers le développement économique de pays à fort potentiel de développement. Pour y arriver, ces pays doivent être prêts et doivent se protéger contre le risque d’emballement financier et monétaire. Enfin, pour éviter les dérives que l’Histoire a déjà trop souvent rencontrées, ces pays doivent définir auprès des investisseurs un objectif commun, c'est-à-dire un niveau de développement et non un niveau de génération de profits. Même si ces deux éléments semblent très liés, politiquement, elles ne le sont pas du tout.
Les accords qui seront conclu à la COP 21 dépendent principalement de l’aboutissement des négociations en amont lors de cette année 2015 cruciale. L’idée de faire participer le monde capitaliste à l’effort de changement est évidente, mais elle ne doit pas défier les règles du capitalisme, au risque d’être négligée puis oubliée. Ces dizaines de milliards de dollars promis doivent avoir un sens et une finalité. Parier sur la bonne volonté éthique des investisseurs serait une énorme victoire politique si cela se terminai en succès, mais c’est surtout un risque encouru beaucoup trop important compte tenu des enjeux. La clé de la réussite d’un changement de comportement de notre économie par rapport à l’environnement se joue sur le terrain de l’investissement, ça, la plupart l’ont compris. Mais il ne suffit pas d’attendre un élan de bonté paternelle des gérants de porte-feuille, car le système financier n’a pas d’esprit, donc pas de morale. Il faut lui offrir - sans forcément lui concéder - les moyens de s’épanouir comme il l’a toujours fait, c'est-à-dire en lui proposant des projets d’investissements concrets qui lui rapporteraient autant voir plus que ce que le système lui offre déjà. Mais cette fois, le profit ne viendrait pas du risque mais bien de la réussite économique et sociale de certaines régions qui n’attendent que ça. En fixant des objectifs précis de développement et en luttant contre « le financement de l’indifférence » obnubilé par le profit immédiat, c’est le système financier dans son ensemble qui se transformera, et c'est ainsi que l'économie mondiale se réorientera naturellement vers une croissance durable mais raisonnable.
Avant d’essayer de changer en vain le comportement de l’Homme par rapport à la nature avec des messages de bonté qu’aucune activité d’envergure ne peut respecter, il convient de changer d’abord le sens de nos mouvements, la finalité de notre production de richesse, donc la cible de nos investissements.
21 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON