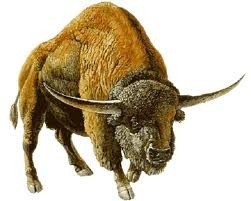Nouveaux arguments en faveur de l’ontophylogenèse
Nous avons sur le site Automates Intelligents donné le plus grand écho à la thèse désormais reconnue de Jean-Jacques Kupiec, référencée sous le terme d'ontophylogenèse. Elle montre que dans certaines conditions les caractères acquis par un individu peuvent être transmis à ses descendants en dehors de la lourde procédure décrite par le darwinisme génétique : mutations aléatoires et sélection des caractères conférant un avantage reproductif. Autrement dit, l'ontophylogenèse réhabilite dans une certaine mesure le concept lamarckien de transmission des caractères acquis.
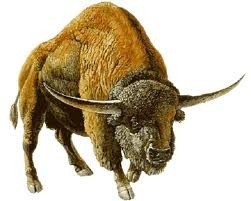
- Bison priscus
L'ontophylogenèse fait appel à ce que l'on nomme désormais l'épigénétique : un individu ayant acquis des qualités améliorant son adaptation à un changement du milieu peut, à génome constant, incorporer dans son génome et donc rendre héréditaires des modalités d'expression des gènes favorisant la reproduction de ces qualités chez les descendants.Ceci permet notamment de comprendre comment des populations soumises à des contraintes subites peuvent s'y adapter rapidement et massivement au lieu de les subir passivement et disparaître.
Des chercheurs canadiens et australiens pensent avoir apporté une illustration de ce mécanisme en étudiant l'ADN de bisons polaires aujourd'hui disparus conservés dans le permafrost. Ces bisons ont du s'adapter très rapidement à des cycles de refroidissement brutaux auxquels ils n'étaient pas préparés. Ils ont acquis pour ce faire différents caractères protecteurs, notamment d'épaisses fourrures. Ces propriétés se sont révélées transmissibles à l'ensemble de leurs populations, dans de courts délais, sans que le code génétique lui-même ait été modifié. Par quel mécanisme ?
Le paléobiologiste Alan Cooper, de l'Université d'Adélaïde et son équipe ont étudié l'ADN, bien préservé dans le permafrost, d'un bison ayant vécu il y a 10.000 ans (Bison priscus) afin d'y rechercher les traces d'un changement épigénétique particulier dit méthylation. Il s'agit d'un processus biochimique impliqué dans le développement et la différenciation cellulaire des organismes supérieurs. La méthylation ajoute un groupe methyl aux bases de la cytosine et de l'adésine constituant l'ADN. Cette modification se transmet lors de la division cellulaire. Elle modifie l'expression des gènes des cellules si bien que celles-ci peuvent « se souvenir » des évènements qui ont provoqué la méthylation.
Ceci voudrait dire que, dans le cas du bison, les premiers individus ayant développé des fourrures épaisses lors de leur vie, grâce à un certain type d'expression de leurs gènes résultant d'une méthylation, non encodée dans l'ADN, auraient pu transmettre facilement ce mode d'expression de leurs gènes à leurs descendants.
L'équipe de Alan Cooper a mis au point une technique dite du séquençage bisulfite (bisulfite sequencing) permettant de distinguer les ADN ayant subi une méthylation des autres. Il leur est donc possible de suivre l'évolution des ADN méthylées au long des générations, ce qui illustre la transmission des caractères acquis par les phénotypes au cours de leur adaptation aux changements du milieu. Or, fait intéressant, ils ont retrouvé dans les ADN des bovins modernes des gènes modifiés par méthylation identiques à ceux identifiés dans les ADN fossiles.
Ceci semble montrer que le caractère acquis par les bisons primitifs s'est transmis jusqu'aux bovins d'aujourd'hui sans entraîner de modification de l'ADN de ces espèces. Les biologistes évoluionnistes n'ont pas l'intention de s'en tenir là. Ils ont l'intention de rechercher des traces de méthylation dans d'anciens ADN relativement bien conservés, Néandertaliens, mammouths, afin de tenter de retrouver les gènes correspondants chez les homo ou les éléphants modernes. Ceci prouverait que le phénomène de l'adaptation épigénétique, sur le modèle de l'ontophylogenèse, a bien tout au long des âges façonné l'évolution des espèces en réaction à de nombreux et rapides changements de leur environnement. Evidemment, les preuves de telles adaptations restent difficiles à obtenir et plus encore à interpréter. Néanmoins l'hypothèse est jugée très intéressante.
|
Comment se représenter le mécanisme épigénétique permettant aux espèces de s'adapter rapidement à des changements du milieu ? Nous pouvons peut-être essayer d'en proposer une image.
Prenons l'exemple d'une vague durable de froid qui frappe un territoire. Les animaux atteint par ce refroidissement disposent de nombreux mécanismes physiologiques régulateurs pour faire face à la perte de calories. Ces mécanismes sont commandés par des gènes ou ensembles de gènes transmis héréditairement. En simplifiant, on peut dire qu'ils interviennent quasi automatiquement en fonction des besoins en calories de l'organisme. Ainsi de ceux qui commandent la capacité de celui-ci à utiliser les graisses et les sucres, ou à se protéger du froid par la couverture pileuse. Plus le froid dure, plus l'organisme consomme de graisse ou fait appel à sa fourrure pour se protéger. Mais ces mécanismes de régulation, dans le modèle classique, sont liés aux individus. Si le froid se prolonge, les individus ne transmettent pas à leurs descendants l'expérience qu'ils ont acquise au long de leur vie afin de résister au froid. Chaque descendant doit réapprendre à mobiliser ses ressources physiologiques sans bénéficier des acquis de la génération précédente. L'adaptation à un froid prolongé, frappant plusieurs générations, demande alors beaucoup de temps : celui nécessaire à l'apparition d'une mutation génétique, avec apparition et sélection d'un gène ou ensemble de gènes commandant par exemple l'acquisition héréditaire d'une épaisse fourrure laineuse. Seuls d'ailleurs à ce moment les individus ayant bénéficié de cette mutation peuvent en profiter pour survivre à la vague de froid. Les autres disparaissent. Dans l'hypothèse évoquée par les travaux précités sur le bison priscus, les chercheurs pensent mis en évidence un mécanisme permettant à l'organisme d'identifier et de transmettre aux descendants l'état de protection maximum offert par l'expression d'un gène intervenant dans la lutte contre le froid. D'une façon générale, il est désormais admis que les gènes ne s'expriment pas d'une façon déterministe, mais de façon aléatoire. Ce sont les conditions extérieures, liées à l'état du milieu, qui sélectionnent les modes d'expression les plus adaptés. Dans le cas évoqué ici, le gène peut aléatoirement commander la consommation de sucres dans l'organisme, indépendamment de la température extérieure. L'organisme a donc intérêt à marquer le niveau de protection le plus élevé permis par l'expression du gène, afin de le retrouver et en bénéficier tout au long de son existence. C'est ce que permet le processus de la méthylation. Grâce à celui-ci, l'organisme peut distinguer l'état méthylé du gène, offrant la protection la plus élevée, de l'état non méthylé. L'expression du gène méthylé est alors sélectionnée sous la pression de l'environnement au détriment de l'expression du gène non méthylé. Il s'agit dans les deux cas du même gène mais dont les modes d'expression sont différentes. L'organisme doit donc les distinguer, afin de faire appel aux plus favorables. Dans le modèle classique de l'évolution, la capacité de faire appel à un mode favorable de l'expression du gène ne se transmet pas aux descendants. Tout nouveau descendant doit donc réapprendre à utiliser le « bon » mode d'expression de son gène. Dans l'hypothèse proposée par Alan Cooper, qui rejoint celle de l'ontophylogenèse, ce sont les contraintes du milieu elles-mêmes qui sélectionnent et permettent de transmettre les modes d'expression les plus favorables. Un individu soumis à ces contraintes (en l'espèce un froid rigoureux continu) transmet à son descendant la capacité de recourir à l'état d'expression du gène offrant la protection la plus élevée, tel qu'identifié par la méthylation. C'est ce que permet le processus de la méthylation, qui peut se transmettre d'un individu à l'autre très rapidement si les contraintes extérieures l'exigent. Au bout d'un certain temps, l'espèce et au sein de l'espèce le groupe peuvent ainsi se trouver dotés des caractères les plus favorables à la lutte contre le froid. En principe, si le froid cessait, les gènes retrouveraient leur mode d'expression moyenne antérieure. On voit que dans ces hypothèses, des phénomènes encore mal compris, relatifs par exemple à l'adaptation morphologique relativement rapide des homo sapiens à des conditions climatiques différentes, du pôle à l'équateur, pourraient trouver une explication. Il en serait de même de toutes les modifications adaptatives rapides intéressant les animaux supérieurs. |
Références
* Bob Holmes. Ice age survival : clues in fossil DNA NewScientist, 4 février 2012, p. 8
* DNA methylation http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_methylation
* PLOS High-Resolution Analysis of Cytosine Methylation in Ancient DNA
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0030226
15 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON