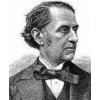Non, merci ou l’union est un combat
L’émission Mots Croisés de lundi recevait Stéphane Le Foll (ministre PS) et Bruno Le Maire, Marine Le Pen (FN) et Emmanuel Todd. Des commentateurs affolés ou simplement peu instruits ont noté que ces deux-là « sont souvent tombés d’accord dans leur diagnostic sur l’Europe et l’économie... ce qui a inquiété certains observateurs sur Twitter. » Ils n’ont en revanche rien trouvé à redire sur le fait tout aussi remarquable que Le Foll et Le Maire « sont souvent tombés d’accord dans leur diagnostic sur l’Europe et l’économie...
C’est l’occasion de relire un texte de 2005 publié à l’occasion d’un fameux référendum.
Non, non, non, VGE n’est pas mort
(Vieux chant des Europtimistes du Poitou)
Depuis plusieurs semaines, l’envie de dire NON était perceptible. Comédie humaine que certains ont voulu dramatiser. Les raisons de dire NON étaient nombreuses, diverses et contradictoires ; les raisons de dire OUI, plus rares, plus rationnelles, et beaucoup moins audibles. Finalement, les gens se sont décidés pour un oui ou pour un non, pour d’aussi mauvaises raisons, mais avec aussi bonne conscience.
La raison dans l’histoire
Les meilleurs défenseurs du OUI ont été des Français d’adoption ou des Européens francophiles, Jorge Semprun ou Daniel Cohn Bendit. Tous deux issus du socialisme, pourfendeurs des totalitarismes, et devenus hommes d’Etat, ils savent le sens de l’histoire, la raison dans l’histoire.
La partie III du traité, la cible de tant de critiques, n’était, disaient-ils, qu’une reprise en compte des traités antérieurs, insatisfaisants, mais qui resteraient en vigueur si l’on refusait de ratifier les parties I et II, imparfaites certes, mais progrès historique indiscutable. L’argument semblait imparable.
Mais le Yoda Jospin, en développant l’argument suivant, de l’incompatibilité des NONs, démontrait aussi la connivence des OUIs.
Et dès lors, un homme politique avisé comme Marie France Garaud avait beau jeu de rappeler que « n’importe quelle femme sait qu’il faut d’abord dire NON ».
Les raisons de la colère
La connivence des OUIs s’étendait au monde des affaires et au monde des médias : c’était dire la compatibilité, et la comptabilité, des OUIs.
A ceux qui n’avaient pas lu le texte, ou ne savaient pas le sens de l’histoire, et à ceux qui ne l’avaient pas fait traduire par leurs avocats d’affaire ou leurs experts en communication, il restait deux raisons sentimentales de dire OUI :
- ne pas dire NON à l’Europe (« ça s’rait dommage »)
- faire sienne cette réplique théâtrale : « Puisque les événements nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs ».
Bref, les électeurs convaincus par les sirènes du OUI entendaient demeurer dans le sens de l’histoire, et ceux alarmés par les cassandres du NON ne l’entendaient pas de cette oreille. Mais les uns et les autres ne se sont prononcés généralement que par ouï-dire, et dénonçant des non-dits et des arrière-pensées chez les chefs du camp adverse.
Bien sûr, il y avait quelques arrières-pensées électoralistes chez certains socialistes passés dans le camp du NON. Et des préoccupations électorales permanentes chez les concurrents de la mouvance souverainiste. Mais pour parvenir à une majorité confortable dans les urnes, l’opposition au traité devait transcender ces deux pôles. Elle ne pouvait se suffire non plus de la recomposition d’une gauche singulière à la gauche de la gauche. Ni de l’envie de dire NON à un président assez discrédité, tacticien de son maintien au pouvoir, mais poussé par un François Hollande qui exigeait hardiment la tenue d’un référendum : tous deux piégés par un Tony Blair en avait proposé un pour son pays sans avoir l’intention de le tenir.[1]
Le management du monde et le monde du management
Les raisons de l’affirmation du NON sont à chercher ailleurs. Ce serait, selon un commentaire en vogue depuis le 29 mai, un NON de la France à ses élites. Mais il conviendrait de dire comment il a pu s’affirmer.
Depuis Marx, il est entendu qu’ « il ne s’agit plus d’interpréter le monde, mais de le transformer ». Cette idée a connu au cours du siècle précédent plusieurs tentatives de réalisation, socialistes souvent, totalitaires encore plus souvent.
Après la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs ont pris de bonnes résolutions : le maintien de la paix dans le monde. C’est sur ce principe que s’est fondée la construction européenne, et c’est dans la coexistence des deux blocs ou « guerre froide » que ce principe s’est réalisé : la paix dans les deux mondes et des guerres locales à leurs périphéries. La fin de l’un de ces deux mondes, à la fin du siècle dernier, si elle n’a pas été la fin du monde, a bien été en Europe comme une fin du monde, la fin d’une certaine conception de l’Europe et le début d’une mondialisation sans réplique..
Déjà, dès 1948, puis dans les années 50, ce monde oriental qui se prétendait communiste et se présentait comme une collection de « démocraties populaires », avait commencé de se disloquer : (hérésie titiste, puis schisme maoïste) dévoilant ainsi sa réalité de bloc fragmenté de bureaucraties totalitaires concurrentes. Cependant, les dirigeants des deux blocs avaient intérêt à maintenir la fiction de la division du monde deux blocs, l’un prétendant propager le communisme, l’autre maintenir la démocratie et la liberté. Mais déjà les dirigeants des démocraties occidentales, au tournant des années 60-70, étaient convenus que le monde devait être transformé. Cependant ils considéraient que, puisque depuis longtemps déjà ils assuraient la domination de plus de la moitié du monde, ils étaient les plus qualifiés pour transformer le monde entier.
L’effondrement des bureaucraties a semblé leur donner raison, tant elle a été aussi le spectaculaire triomphe de ce qu’il faut bien appeler le capitalisme. Et les managers du monde occidental se sont effectivement trouvés en charge du monde entier, même si aujourd’hui les managers chinois, issus de l’autre « bloc », commencent de leur contester cette domination.
Le management est devenu le langage de la domination et l’idéologie de ce nouveau monde que certains n’hésitent pas à qualifier de post-capitaliste. Il avait d’abord été la diffusion dans le monde entier d’un américanisme et d’une façon de gérer, d’administrer et de diriger les affaires (Business is business). Manager (verbe et substantif) avait été préalablement emprunté aux mondes du sport et du spectacle ; et managerial devait connaître un succès plus tardif, quand le management eut glissé de la sphère des affaires à celle des ressources humaines. La France, quand elle n’est pas farouchement anti-étatsunienne, adopte avec ferveur les modes venues d’Amérique. Son twist, autrefois. Puis son vocabulaire managérial, avec l’accent et en accentuant le caractère novateur de ces façons de gérer, d’administrer et de diriger. En français, le management ne pouvait être que participatif et de proximité, une émanation de la démocratie, un héritage de 68, une preuve de l’entreprise citoyenne.
Une enquête plus approfondie montrerait quels liens de parenté le management entretient avec le socialisme comme idéologie, et avec le totalitarisme comme pratique de la domination. Auteur de la formule : « L’homme, notre capital le précieux », Staline aurait volontiers assumé la paternité du management par le stress.
Le management des ressources humaines est l’obtention de leur adhésion au changement : leur donner le pouvoir de dire OUI. Il a emprunté au socialisme l’idéologie de la participation et de la discipline ; au totalitarisme, le contrôle des esprits (par la propagande, la communication, la manipulation, le pseudo-dialogue, le stress).
Le monde de l’entreprise (de l’économie) a donc emprunté au monde de la l’Etat (de la politique) quelques recettes de manipulation, de persuasion et de coercition. En retour, le monde politique aujourd’hui au monde du management des recettes de bonne gouvernance.
Valéry Giscard, en s’invitant chez ses électeurs au siècle dernier, avait introduit en France le management de proximité. C’est certainement par une ruse de l’histoire (et de son vieux rival Chirac) qu’il s’est retrouvé, au début de ce millénaire, chef de projet d’une constitution européenne et principal rédacteur du traité qui vient d’être désavoué dans deux référendums.
Des textes d’une même obscurité et ambiguïté sont fréquemment produits dans les entreprises en proie au changement. Ils sont rédigés par des experts et des consultants. Ils sont soumis aux ressources humaines, pour leur information et pour leur édification. On leur en souligne l’importance pour leur avenir. Généralement, les ressources humaines s’inquiètent de quelques dispositions qui semblent mettre en cause leur avenir justement. On leur explique alors qu’il n’a pas lieu de s’inquiéter et que ses dispositions importantes sont sans importance finalement.
La différence est que ces textes, soumis aux ressources humaines pour consultation, ne sont que rarement soumis à leur approbation par un vote. La construction européenne n’est pas un long fleuve tranquille. « Putain, putain, c’est vachement bien, Nous sommes quand même tous des Européens ».(Arno)
[1] Le Président visé ici Jacques Chirac, l’actuel Président n’étant alors que Premier Secrétaire du parti Socialiste.
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON