Cambodge : un procès à responsabilité limitée
Depuis début février, les premières audiences publiques du procès à caractère international, avec mixité entre les juges cambodgiens et ceux issus de la communauté internationale, se sont ouvertes à Phnom-Penh afin de juger les quelques anciens dirigeants khmers rouges encore de ce monde. L’affaire est d’importance puisqu’il s’agit de clore par cette phase judiciaire la période sans aucun doute la plus sombre de l’histoire du Cambodge qui vit ce peuple en partie détruit par l’âme génocidaire de ses dirigeants. 2 millions de morts, plus ou moins selon les historiens, l’holocauste le plus massif depuis la shoah alors que l’humanité vibrante encore d’émotion après la seconde guerre mondiale s’était jurée : “plus jamais ça !”

Un procès à voilure étroite
Cela fait maintenant une trentaine d’années que les crânes poussiéreux visités par les touristes en quête d’émotion à Phnom-Penh au lycée Toeul Sleng devenu centre de détention S-21, sous la férule de M. Kang Kek Ieu, alias « Douch », puis musée des horreurs attendent que justice soit rendue à leurs anciens propriétaires, tués après des jours de torture et d’absolue détresse. Depuis ces temps dissous dans le sang des victimes, notre monde a connu d’autres génocides et sur d’autres terres, le Rwanda en figure de proue et la mémoire de l’immolation des cambodgiens dans l’indifférence générale si ce n’est la complicité, il est vrai que le droit d’ingérence humanitaire n’avait pas encore été inventé, n’intéresse plus grand monde. Une couverture médiatique très moyenne, l’absolue ignorance de la jeunesse cambodgienne et un intérêt mitigé pour le reste de la population saisie par les difficultés de la vie et souvent prise en étau par un État qui est loin d’être de droit, les audiences vont se poursuivre durant de longs mois sans grande surprise puisqu’il est quasiment certain que les prévenus, qu’ils reconnaissent leur culpabilité comme Douch ou qu’ils se cachent, ainsi Khieu Samphan, ancien Chef d’Etat et Ieng Sary ministre de Pol Pot, sous les plis de la défense habituelle des dirigeants mandants de crime de masse : ils ne savaient pas, c’est la faute du chef suprême ou des subordonnés, seront tous reconnus coupables et condamnés à la détention perpétuelle, soit à quelques années de prison eu égard leur grand âge.
Encore de la place sur le banc des accusés…
Si de nombreux chercheurs et des récits de rescapés ont montré ce que furent de avril 1975 à janvier 1979 les mécanismes de la nouvelle société promue et violemment mise en œuvre par les dirigeants de l’Angkar, « l’organisation » selon la traduction française : collectivisation et travaux forcés, abolition de la monnaie, des écoles, des universités, du commerce et de l’industrie, séparation des familles et évidement des villes au profit des campagnes, le tout enrobé d’un climat de suspicion généralisée et d’une théorisation fumeuse entre peuple nouveau et peuple ancien, les uns étant de nature supérieure aux autres qu’il convenait de rééduquer ou d’exterminer, les mauvais génies qui se penchèrent sur le berceau du mouvement des khmers rouges semblent exclus de la compétition en terme de responsabilité. Ils sont pourtant nombreux :
- Les Etats Unis bien entendu, sous la férule de Nixon et de Kissinger qui, faisant du Cambodge une base arrière pour leur guerre au Vietnam, sans jamais hésiter à déverser des pluies de bombes dans les campagnes sous prétexte d’infiltration des Vietnamiens, désespérant un peu plus les paysans khmers et les jetant ainsi dans les rangs des maquis khmers rouges,
- Le prince Sihanouk en ordonnateur du destin de son peuple par sa politique pompeuse, zigzagante et répressive provoquant la prise de pouvoir des républicains le 18 mars 1970 menés par le Maréchal Lon Nol,
- Les pays de la zone, tel que la Thaïlande qui ne cessa ses interventions depuis le début des années cinquante pour déstabiliser son voisin, mais aussi le Nord Vietnam qui anima les premiers bataillons khmers rouges mais bon celui-ci avait l’excuse de mener seul une terrible guerre d’occupation contre les troupes US.
Les choses en matière de justice internationale étant bien faites et arrangeantes, ce procès n’a été organisé que pour les crimes commis au Cambodge entre le 17 avril 1975, date de la prise de Phnom-Penh par les soldats Khmers rouges et le 6 janvier 1979 lorsque ils furent chassés du pouvoir par l’invasion tout de même libératrice des Vietnamiens, quelques soient leurs arrière-pensées ! Tout ce qui fut commis avant et après, tels que les appuis des Etats-Unis, de l’Europe menée par le Royaume-Uni, de Singapour, de la Chine aux Khmers rouges réfugiés dans la région frontalière avec la Thaïlande afin de les réarmer, rien de cela ne sera jamais jugé…
Aujourd’hui les millions de morts de Kampuchéa démocratique dont l’adjectif indique seulement l’égalité d’asservissement entre tous, ceux d’avant et d’après se sont fondus dans la terre cambodgienne et donnent le terreau de son avenir. Ce sera sans doute l’unique vertu de ce procès de leur rendre un dernier hommage même si le banc des accusés va leur sembler bien vide.
Et la France ?
Elle fut comme les autres pays témoin engagé et acteur aveugle. On peut se rappeler du discours du Général de Gaulle à Phnom-Penh en 1966 lorsque tout était encore possible pour ce pays, faisant alors figure de petite « Suisse » d’un Sud-est asiatique encore embrumé par le sous-développement et des guerres incessantes. Il appela au respect de son indépendance mais ne fut pas écouté. Puis il y eut le départ du pouvoir de Sihanouk, son ralliement à ses anciens ennemis Khmers rouges et son refuge trouvé à Pékin. La république qui lui succéda, cancérisée par la corruption et l’allégeance aux Américains n’eut malheureusement très vite aucune légitimité, malgré des éléments sains dans les nouvelles générations de l’époque, parmi les jeunes intellectuels et certains politiciens qui n’en pouvaient plus du régime princier et y crurent un moment. Le choix fut alors par défaut et la France de Pompidou puis celle de Giscard soutint le Prince, allié des Khmers rouges, qui recouvrit ainsi un peu de son éclat. Ce fut ainsi jusqu’à la prise de Phnom-Penh en avril 1975 et la nuit d’effroi plombant le pays durant quatre ans.
Des morts oubliés et de trop…
Il y a de vraies victimes et d’autres que l’on cache. C’est l’affaire des vivants que nous sommes d’en faire l’inventaire et le tri, leur offrant pour seule épitaphe leur souvenir dans nos mémoires. Dans cette tragédie, il faut alors ne pas oublier celles qui furent sans aucun doute les premières à être sacrifiées juste après la prise de Phnom-Penh mais occultées du fait d’une certaine raison d’Etat.
Nous sommes en avril 1975 et la ville s’apprête à accueillir le bataillon khmer rouge qui l’assiège depuis plus d’un mois. La totalité des ambassades occidentales ont déjà fermé leurs portes, sauf celle de la France, avec la seul présence d’un vice-consul Jean Dyrac qui accueille les derniers étrangers encore présents et des cambodgiens ayant plus ou moins la double nationalité désirant quitter leur pays. C’est alors une véritable foire d’empoigne que décriront le livre et le film « La déchirure », mélange bigarré dans les jardins de l’ambassade, devant faire face à un véritable siège et attendant leur évacuation selon le bon vouloir du commandant khmer rouge nommé Nhem qui a fait encercler le bâtiment.
Le 17 avril, l’ancien président de l’assemblée na Ung Boun-Hor arrive à se faufiler afin de demander l’asile politique de la France pour aller retrouver sa jeune femme et ses enfants déjà réfugiés à Paris. D’autres responsables politiques républicains feront la même démarche.
Dès son arrivée, le vice-consul l’installe et demande des consignes au Quai d’Orsay. La réponse tombe dans l’après-midi : ” Le fait que le droit d’asile ne soit pas reconnu en droit international et le caractère particulier de votre mission, ne nous permettent pas de donner satisfaction aux demandes du Prince Sirik Matak et de M. Um Bum Hor, ou de toute autre personne qui se présenterait à l’ambassade dans les mêmes conditions. Vous ferez savoir aux intéressés que nous ne sommes pas en mesure d’assurer la protection qu’ils attendent. “*
Le vice-consul insistera ainsi qu’en atteste son télégramme diplomatique n°595 envoyé le 18 avril 1975 à 15h18 :
” Objet : asile politique. Suite ultimatum de la délégation du comité de la ville, je me trouve dans l’obligation, afin d’assurer la sauvegarde de nos compatriotes, de faire figurer sur la liste des personnes présentes dans l’ambassade :
1-le Prince Sirik Matak et deux de ses officiers 2-La princesse Mom Manivong (3e épouse du prince Sihanouk). 3-M. Ung Bun Hor, président de l’Assemblée nationale.
4- M. Loeung Nal, ministre de la Santé. Sauf ordre express et immédiat du département m’enjoignant d’accorder l’asile politique, je devrai dans un délai qui ne pourra excéder 24 heures livrer le nom de ces personnalités. Répondre par télégramme clair : -oui, si je dois les livrer.
- non, si je dois m’abstenir.”
Les gendarmes français les livreront manu militari aux officiers khmers rouges et ceux-ci seront sous toute vraisemblance exécuter dans les heures qui suivirent.
Si le gouvernement français de l’époque dirigé par Jacques Chirac avait décidé que l’on ne transige pas avec le droit d’asile, bien des moyens, diplomatiques et militaires étaient à sa disposition pour protéger leur vie et assurer leur sécurité mais il fallait donner encore des gages aux nouvelles autorités et à Norodom Sihanouk.
Aujourd’hui, sans le courage et la détermination de sa veuve, Mme Billon Ung Boun-Hor qui a déposé plainte devant le tribunal de Créteil, il y a huit ans, avec l’aide des avocats de la ligue des droits de l’homme, procédure judiciaire semée d’embûches puisqu’elle met en cause les plus hautes autorités françaises de l’époque, ces cambodgiens doublement victimes de la raison d’Etat et de la haine des khmers rouges auraient laissé peu de trace dans cette tragédie, sauf peut-être pour ceux qui se partagèrent argent et bijoux, ainsi les 300.000 dollars que son mari détenait lorsqu’il demanda la protection de la France.
Documents joints à cet article
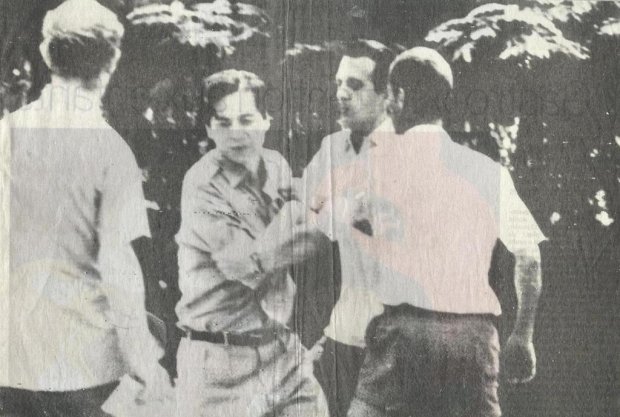
14 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









