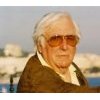Les bonzes et la jeunesse birmanes : l’énergie du désespoir
La « révolte safran » couleur de la toge des bonzes en colère qui secoue la Birmanie depuis le 18 août pourrait être le début d’importants bouleversements dans la situation politico-stratégique du Sud-Est asiatique.

Le monde occidental assiste, de loin, à une version
asiatique de la lutte du "goupillon" contre « l’épée et le bouclier
». Les 500 000 bonzes du bouddhisme birman, suivis par la jeunesse de ce pays
représentent une véritable armée dont la puissance réside dans l’inflexible
volonté que leur apportent la pratique de la méditation et l’enseignement
hérité d’un homme qui devint le Bouddha, né sous le nom de Siddartha Gautama,
dans le nord de l’Inde, il y a plus de deux mille cinq cents ans...
Mais déjà en ces derniers jours de septembre 2007, le
crépitement des armes automatiques, les explosions de grenades lacrymogènes ont
retenti dans le centre de Rangoon, aux pieds de la pagode de la Shwedagon,
couverte de d’or et symboles millénaires du bouddhisme birman et à Mandalay,
l’antique ville impériale de la dynastie d’Ava dont le déclin et la disparition
ont été provoqués par l’irruption de l’armée des Indes britanniques dans le but
de mettre fin - sous le prétexte d’éradiquer les débauches et les actes de cruautés
de leur dernier empereur - à ses projets d’entente avec les Français désireux
d’étendre vers l’Ouest leurs colonies d’Indochine.
Fait intéressant : alors que les journalistes ne peuvent
entrer en Birmanie, la généralisation de l’usage de téléphones-caméras permet
de lancer, à travers le monde, toutes les images essentielles de la révolte en
transformant ainsi la jeunesse de Rangoon et de Mandalay en un peuple de
"paparazzi" résistants et utiles.
Déjà le monde entier a pu voir ce que la censure militaire
voulait cacher.
C’est la première fois depuis vingt ans qu’est lancé un tel
mouvement de révolte dont on ne peut pas dire qu’il ait pu prendre par surprise
les généraux de la Junte. Dans une Birmanie apparemment soumise, décrite comme
le pays des temples d’or, par les portails publicitaires des agences
officielles de tourisme, on ne peut oublier dans les temples, les villes ou les
campagnes que la junte a fait tuer, il y a vingt ans, sans état d’âme, trois
mille jeunes gens et moines. Leur seul crime avait été d’avoir osé contester le
pouvoir de l’Etat militaire, après l’annulation d’élections générales dont les
résultats avaient consacré la victoire du mouvement démocrate birman, conduit
par Mme Aung Suu Kyi. En les rejetant dans la minorité ces résultats avaient
ridiculisé et fait perdre la face aux généraux qui avaient tenter d’imposer au
peuple un rapprochement « démocratique » à leur manière, après l’évincement du vieux
général Ne Win, celui qui avait imposé sa dictature aux peuples de la
fédération et son pouvoir, après l’annulation des élections générales dont les
résultats avait consacré la victoire du mouvement démocrate birman, conduit par
Mme Aung Suu Kyi. En les rejetant dans la minorité ces résultats avaient
ridiculisé et fait perdre la face aux militaires qui avaient un rapprochement «
démocratique » à leur manière après avoir évincé le général Ne Win, qui avait imposé
pendant vingt-six ans une dictature sans partage aux peuples de la Fédération en
chassant le pacifique président U Nu.
Depuis quarante-cinq ans les peuples de Birmanie sont
prisonniers de ce régime militaire impitoyable fondé en mars 1962 par ce
général pro japonais issu de la résistance anti-britannique durant la Seconde Guerre mondiale.
En une nuit, les Birmans étaient passés de la gouvernance
parlementaire momentanément tranquille du président U. Nu à une dictature
ubuesque bien pire que n’avait été avant la conquête coloniale anglaise le
règne fou de l’empereur alcoolique Tibaw.
En quelques mois une junte de généraux prétendit ouvrir « la
voie conduisant au socialisme birman » un mélange harmonieux, selon eux, mais
surréaliste, de bouddhisme et de national communisme. Cela avait été plus long
que prévu, mais au cours des mois et années suivantes, les membres de la junte
avaient nationalisé, c’est-à-dire mis la main, sur tous moyens de production du
pays. D’abord la culture du riz, son industrie de décorticage et son commerce
national et international, ensuite tout le réseau bancaire, puis l’ensemble du
commerce, allant de la boutique mobile des marchandes de soupe aux coins des
rues à la grande distribution internationale dont l’administration et les
directions furent confiées à des colonels inexpérimentés. Ensuite la monnaie,
par un changement de billets qui ruina les deux tiers du pays tandis que les
Etats de la fédération, dans leur majorité (Shan, Karen Kachin, etc.) refusaient
de reconnaître la constitution fédérative birmane créée au moment de
l’indépendance et entraient en dissidence.
Une première révolte des étudiants de l’université de Rangoon,
en mai 1962, fut noyée dans le sang. La « Sangha » ainsi que l’on nomme
l’assemblée des hautes autorités monacales eut beau organiser sur les lieux de
cette tuerie des cérémonies propitiatoires, dans le but de calmer les milliers
« d’âmes errantes » des jeunes gens victimes de la cruauté des militaires, rien
n’y fit et le pays de mois en mois, d’année en année sombra dans la plus
profonde et sinistre des dictatures. Jusqu’au moment ou le général Ne Win, usé
par l’âge et les excès, fut écarté du pouvoir par des généraux plus jeunes que lui et
dont certains qualifiés de « modérés » avaient imaginé qu’en organisant des
élections générales que tout le peuple attendait, ils pourraient établir sous
leur direction un régime pseudo-démocrate qui leur aurait permis de durer indéfiniment.
Les résultats de cette consultation populaire furent tels
que la junte au pouvoir en 1988, ainsi ridiculisée, ayant perdu la face, décida
de les considérer comme nuls et non avenus.
On prétend que le pouvoir rend fou et aveugle. La richesse
également, depuis janvier 2005. On a constaté en effet depuis la découverte à
cette époque, de gisements de gaz extrêmement importants dans le Nord, en off
shore, à l’extrémité du golfe de Bengale, la Birmanie est devenue une des
nations potentiellement les plus riches du Sud-Est Asiatiques. L’énorme
potentiel d’exploitation qui est désormais à sa disposition, avec la présence
de compagnies pétrolières françaises, indiennes ou internationales, a provoqué chez
les généraux une sorte de folie des grandeurs entretenue par de grandes
puissances telles que la Russie et la Chine ou incontournables comme l’Inde, le
Pakistan et l’Indonésie. Ou prudentes comme celles de l’ASEAN.
Les Russes dont les bonnes relations avec Rangoon sont
traditionnelles depuis les années 50, et renforcées depuis le coup
d’État de mars 1962, y ont vu l’occasion de poursuivre leur progression
stratégique, diplomatique et économique vers les mers chaudes d’Asie, selon le
vieux rêve de la Grande Catherine. Ils ont vu dans la découverte du pactole
pétrolier, qui a donné des moyens financiers illimités à la junte des généraux,
l’occasion de renforcer ces liens par des accords industriels, nucléaires,
commerciaux et des conventions de coopération militaire entre le gouvernement
de M. Vladimir Poutine et la junte. Ces accords ont notamment porté sur la
fourniture d’équipement neuf, des chasseurs bombardiers à l’armée birmane et
surtout l’inauguration d’une coopération nucléaire avec Rangoon pour la
construction d’une centrale et l’établissement de laboratoires de recherche
nucléaire médicale.
C’est probablement pourquoi, à Moscou, on ne s’est pas ému
au sujet de la « révolte safran », en préconisant un règlement prudent de cette
crise.
Alors que les États-Unis et l’Union européenne ont appelé
l’ONU à envisager des sanctions contre le Myanmar, après la répression des
manifestations d’opposants au régime, le ministère russe des Affaires
étrangères a déconseillé mercredi "de profiter des derniers événements
pour exercer des pressions ou se livrer à des ingérences dans les affaires
intérieures" de la Birmanie. La Russie continue "à penser que les
événements au Myanmar ne sont une menace ni pour la paix internationale et régionale
ni pour la sécurité", poursuit le communiqué, qui appelle néanmoins
Rangoon et l’opposition à "faire preuve de retenue".
Quant à la Chine, dans la perspective des jeux Olympique,
elle paraît fort embarrassée, au point que son ministre des Affaires étrangères
- fait rarissime - a "recommandé" à la junte de résoudre
"pacifiquement" cette crise.
En fait Pékin, manifeste trois préoccupations :
- la nécessité de compter sur un fournisseur constant de
produits énergétiques indispensables pour la poursuite de son développement
industriel et économique ;
- assurer ses arrières le long d’une frontière de mille cinq
cents kilomètres ;
- éviter de se laisser entraîner dans une aventure
diplomatique au moment où elle prépare le grand show des jeux Olympiques.
De leur côté, l’Inde et la Thaïlande espèrent continuer à
acheter du gaz et du pétrole birmans et, en Extrême-Orient, la Corée du Nord
souhaite maintenir de bonnes relations avec le Nyanmar. Elles n’ont aucun intérêt pour
l’instant voir un chaos s’installer chez leur fournisseur ou partenaire. Ce
déséquilibre risquerait de provoquer une crise majeure dans cette région.
En Asie, tout est atrocement compliqué. Et pourtant la mise
en scène actuelle comportant trois acteurs principaux est relativement simple.
Logique en tout cas, mais périlleuse pour ses initiateurs.
D’un côté l’armée
birmane, « Tatmadaw » dont les effectifs sont supérieurs à 400 000 hommes,
biens armés et dont les généraux, au moins ceux qui composent la junte, se sont
partagé un butin composé essentiellement des richesses produites par
l’exploitation des gisements gaziers et pétroliers, celles des mines de Mogok
où l’on extrait les saphirs, les rubis, les jades considérés comme les plus
beaux du monde. Sans parler naturellement de la vente de millions de tonnes de
riz et de bois précieux.
De l’autre, « le Sangha » qui compte quelque 500 000 bonzes
du « petit véhicule » (toge safran). Ils peuvent tenir tête aux militaires avec
l’aide du monde bouddhiste extérieur. Il se pourrait qu’il existe un commun
accord entre les pays bouddhistes de la région du Sud-Est asiatique.
Pour la première
fois depuis le début de leur révolte le 18 août dernier, les moines ont invité la population à les
rejoindre dans leur « campagne pacifique pour faire tomber la dictature
militaire néfaste ».
Les manifestations de Yangoon (Rangoon) et Mandalay ont
confirmé que l’ampleur de la révolte en cours est sans précédent depuis celles
de 1988 qui avaient été écrasées dans le sang par les généraux birmans.
« Nous décrétons "ennemi commun" de tous nos
citoyens, le despotisme militaire qui "appauvrit et paupérise les gens de
toutes conditions, y compris le clergé", a déclaré sur internet une "Nouvelle
Alliance nationale des moines birmans" ».
Parmi les causes immédiates de cette révolte figure la
hausse du prix de l’essence et du coût journalier de la vie. Ce furent les
premiers prétextes du soulèvement, Mais ce qui a pu avoir toutes apparences
d’une « fronde sans lendemain » est en train de se transformer en une révolte
puissante contre le régime.
Que la population ait été exaspérée par ces augmentations de
prix. Cela ne fait pas de doute, d’autant que l’enrichissement spectaculaire
des militaires n’avait pas empêché la misère de s’installer dans un pays qui -
en dépit de son économie vivrière - ne souffrait pas de la faim. Il y a
certainement d’autres bonnes raisons : faut-il les chercher du côté pétrolier ?
Ou doit-on considérer ces événements comme le début d’un "containment"
de la Chine ? Cela vient-il des membres de l’ASEAN ? Autant de questions
auxquelles il est difficile de répondre.
Ou bien l’arrogance des généraux a-t-elle fini par
incommoder leurs voisins qui ont vu dans le mécontentement à peine dissimulé
d’une population lasse de près d’un demi-siècle de dictature des risques de
déstabilisation d’une des régions les plus sensibles du Sud-Est asiatique.
Maintenant qu’ils se sont réfugiés dans leur niz d’aigle par
crainte des étudiants, des bonzes et des civils en général de Rangoon,
l’ancienne capitale, que vont faire les généraux ?
- faire tirer sur les manifestants pour mettre un terme à ce
qu’ils qualifient de « désordres provoqués par les ennemis du peuple » ;
- transiger ? Les Birmans démocrates en exil en doutent fort ;
- céder aux pressions internationales ? Encore moins.
Comment accepteraient-ils de le faire alors qu’ils savent que la Chine et la
Russie n’approuveront pas les sanctions décidées au sein du Conseil de
sécurité des Nations unies ?
Pour le reste, wait and see. Mais il paraît probable et à craindre que les militaires ne se servent d’Aung Sand Suu Kyui, la « Dame de Birmanie » comme otage en face d’un peuple et d’un clergé bouddhiste venus prier devant sa porte, mais réduits à l’impuissance, tandis que la démocratie une fois de plus, ne leur paraîtra que le leurre trompeur d’un monde occidental invertébré ?
19 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON