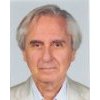Ce que démocratie veut dire
CE QUE DEMOCRATIE VEUT DIRE
La loi du plus fort a toujours existé et seule une organisation et une morale solides ont réussi à la contenir. Il s’agit d’un « contre-pouvoir » régulateur qui a donné naissance à un nouvel enjeu : Celui de la justice.
Lorsqu’on parle de « démos », le peuple, d’où « démocratie », - le pouvoir décisionnel d’une assemblée basée sur ce qui est juste -, ce mot n’a pas été pensé par une banque, ou une entreprise multinationale. Il s’agit d’un exploit. Il a fallu plus de quelques décennies et beaucoup de pensée, pensée « présocratique ». (Socrate, c’est déjà la décadence)
Parler de démocratie aujourd’hui sans revenir à la source, qu’est l’étymologie des mots, est une vaine entreprise.
D’où est sortie cette fabuleuse idée de « DÉMOCRATIE » ?
Prenons l’exemple de l’économie, préoccupation générale du « monde démocratique » actuel. Les spécialistes nous parlent de pouvoir d’achat, de statistiques et de PIB, convaincus d’être compris par tous. Bien sûr le discours est très construit et « pragmatique ». Que veut dire « pragmatique » ? « Pragma » en grec est la chose. Le pragmatique s’intéresse exclusivement aux choses qui tombent sous les sens sans chercher d’autre dimension. Autrement dit, il est « matérialiste ». Marx, le « pragmatique » n’a pas écrit son « Capital » pour les prolétaires, mais pour son parti, devenu « élite » de nos jours sans plus citer l’auteur qui est toujours le même : Karl Marx.
En grec, l’argent se dit « chrima », mais aussi « nomisma ». Deux mots pour la même chose ?
Et bien, oui. Le premier signifie « chose », préoccupation principale du pragmatique, d’où la phrase du sophiste Protagoras : « L’homme est la mesure de toute chose », l’homme ici est l’homme pragmatique. Le deuxième est un mot composé de « nomos », la loi. Dans la véritable démocratie la loi est acceptée par tous comme un « bien commun » grâce auquel le citoyen est libre. Cette « Liberté » fondée en Justice, est l’opposée de la « licence » qui est le propre de la décadence.
Voyons ce qu’« économie » veut dire au juste. Le mot « économie » est composé de « oikos », la maison et « nomos », la loi. C’est la loi qui prend naissance dans la maison natale, où le jeune enfant voit sa mère traiter tous les membres de la famille avec d’égard, affection, « storgi » et respect. Les petits comme les grands, les jeunes comme les vieux, les malades et les blessés comme les bien-portants. C’est ici que la justice prend naissance et se cristallise pour le reste de sa vie comme une chose naturelle. Plus qu’un « droit », elle est un « devoir » envers son prochain et envers l’Univers entier. Oikos, la maison est un havre de paix, une cellule d’harmonie et de bien-être.
À sa majorité, le jeune grec arrive sur l’« agora », la place publique, là où la « démocratie » prendra son essor. Il prend la parole après avoir bien observé combien la parole est importante. Il est « riche » de son « éducation », paideia, cette éducation qu’il a reçue depuis son enfance. Il sait déjà que l’écoute est toujours plus importante que la parole. Et il sait aussi que la « Liberté » ne se donne pas, Elle se prend, avec courage, loyauté, et intelligence.
Démocratie veut dire seulement majorité ? Hitler est venu au pouvoir par les urnes. « Bolcheviques » signifie majoritaires, cette majorité dont le but a été de déposséder l’aristocratie tsariste et d’envoyer au Goulag ceux qui osaient les contredire. L’intérêt commun suppose une cohésion nationale telle, qu’aucune majorité ne peut l’emporter en écrasant la ou les minorités opposées. C’est toujours une poignée d’hommes qui a pu changer quelque chose dans la bonne ou la mauvaise direction de l’humanité, bien au delà des majorités et des minorités.
L’autre pilier de la Démocratie est « ethos » qui est bien différent de la morale. La morale est toujours la morale des autres. Ethos est cette exigence de soi-même à rester fidèle à son devoir d’homme par rapport à la vertu. C’est quoi la « vertu » ? Voilà une question que l’on ne se pose plus en politique. En grec, ARETI est le sujet principal de la pensée humaine. C’est l’élévation de l’esprit vers les valeurs éthiques.
Le troisième pilier de la démocratie est cette « paideia », cette éducation fondée sur « andreia », insuffisamment traduit par courage. Aristote la définit comme la victoire suprême emportée sur soi-même. Il la situe entre la lâcheté et le culot, ces deux extrêmes qui se joignent pour définir l’homme de tous les vices, sorte de « pervers polymorphe » selon Freud, modèle très prisé à notre époque.
La liberté promise par l’Europe d’aujourd’hui est limitée par l’urgence de la sécurité, ainsi la Justice est remise à plus tard, à cause de la crise. Il n’y a jamais eu autant de trafic d’armes. Chaque fois on affiche les mêmes promesses de sortie de la crise. De quelle politique est-il question ? De quelle démocratie ?
Prenons un exemple significatif : ce beaux pays, la Grèce, « berceau de la Civilisation, de la « Démocratie ». « Europe » est un mot de la Mythologie Grecque. On aurait pu appeler ce continent « Occident » ou « Atlantide ». Elle est devenue une proie pour les grandes banques liées aux entreprises pétrolières et une sinistre base militaire pour l’Otan. Des beaux paysages qu’inspirent la paix et le bien-être sont détruits. Quel désastre cette volonté d’uniformité imposée à tous les pays riches de cultures millénaires par leur différence et pauvres par la volonté de leur soumission.

Je ne vois d’autre espoir que le Frexit. C’est uniquement de cette manière que le mot « démocratie » ne sera peut-être plus un mot à géométrie variable, un peu trop « démocratisé » utilisé jusqu’aux crimes de guerre, mais un mot qui a un sens dans un pays de grande culture et de longue tradition comme la France.
C’est la raison pour laquelle je me suis inscrit à l’UPR. Non pas l’union d’une élite contre la volonté du peuple, ni populiste, (« la France d’en bas », « les sans dent » etc) ni nationaliste, ni propagand-iste. Aucun -iste.
Si chacun ne mène pas un combat pour qu’il n’y ait plus de guerre, solution fatale du capitalisme libéral atlantiste /« atlante »-iste, nous aurons une guerre sans combat.
On ne sait pas si l’« Atlantide » citée par Platon fut une réalité ou un mythe, on suppose pourtant que cette civilisation fut ensevelie après une catastrophe naturelle ou une catastrophe nucléaire. Aujourd’hui la menace à laquelle nous faisons face est réelle dans les deux cas. C’est une grande question qui demande une longue recherche et un ferme engagement pour la dignité humaine.
12 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON