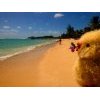Cette Gauche-là sur laquelle on aimerait compter, ou l’idée absurde d’une Primaire inutile
S’il y a une chose dont la droite a besoin pour passer le premier tour en 2017, c’est que la Gauche se divise. Une primaire serait le meilleur moyen de leur donner raison, car les primaires ne sont pas faites pour débattre de fond, elles ne sont qu’une étape parmi d’autres pour choisir la personnalité la plus apte à se présenter aux élections présidentielles au nom de la Gauche. Mais la Gauche a-t-elle de quoi offrir cette personnalité ? Est-ce vraiment le meilleur moyen pour elle de se réinventer comme elle en ressent le besoin ?

Les maux de la Gauche sont connus : mauvaise représentativité, manque de vision d’avenir, manque de personnalité forte, manque d’effort pour la défense et la construction des valeurs de demain. La Gauche a un problème identitaire et structurel. Elle n’a plus les moyens de se réinventer, non pas qu’elle n’est pas inspirée, mais sa composition, son organisation ou encore sa direction ne sont pas en mesure de faire valoir les idées existantes, ni même d’encourager à la création et la concrétisation de nouvelles. Les élus de gauche ont passé tellement de temps de leur carrière dans l’opposition qu’ils n’ont su trouver la force pour se rassembler autour d’un projet ambitieux dans l’espoir de l’appliquer au quotidien. Hélas, pour une fois que le pouvoir lui en offre la possibilité, l’énergie déployée consiste davantage à la critique, passion des politiques, plutôt qu’à la construction, devoir d’élu. En conséquence de quoi, ce sont les technocrates de l’exécutif qui rédigent les réformes, au détriment de la représentativité et de la démocratie dans le processus législatif.
Le pouvoir, une responsabilité mal anticipée
En 2012, la Gauche avait tous les pouvoirs, elle avait les moyens de dessiner enfin l’avenir du pays et de participer activement au développement du projet européen. Malgré les divergences en termes de politique économique avec nos voisins, les relations diplomatiques entre Etats fondateurs européens étaient au beau fixe. Le nouvel exécutif français était accueilli avec engouement par la presse, par l’Europe et par le peuple, parce qu’il incarnait un espoir de réorientation de la France vers des jours meilleurs, entrainant l’Europe avec elle.
Seulement, l’élection de François Hollande n’était pas le souffle heureux d’un vent idéologique venant de la gauche, ce n’était qu’un mouvement réactionnaire venant du peuple tout entier, motivé par un refus de se voir réélire un parti ne représentant à ses yeux que les intérêts de l’élite économique nationale. François Hollande a accompli une prouesse en chassant de son trône une pointure en communication, un artiste de la politique, un génie de la démagogie, mais il n’incarnait pas une nouvelle vision de la Gauche, bien loin de là, et nous le savions. Rien dans les propositions de François Hollande n’aspirait à un véritable renouveau, ce n’était qu’une artillerie lourde mais finement aiguisée pour assurer la victoire face à une machine politique bien rodée, celle de Nicolas Sarkozy.
Pendant la campagne présidentielle, les commentateurs imaginaient les bienfaits d’une prise des commandes par la Gauche. Chacun participait activement à l’éclosion d’un réel engouement à l’idée de chasser cette droite ringardisée, c’était la victoire supposée du peuple face à la classe économique supérieure. Pendant ce temps, l’échéance de la prise de pouvoir se rapprochait, sans que les intellectuels et les dirigeants de la Gauche française ne s’y préparent. Arrivée au pouvoir, la Gauche se plaint des mois durant de l’état délétère des comptes publics offert par l’exécutif précédent, sans pour autant présenter de nouvelles solutions. Depuis lors, l’exécutif n’a eu de cesse de tergiverser, de bricoler les comptes, d’adapter sa politique pour froisser le moins possible, en quête de compromis dans un système politique qui n’a jamais été capable d’en trouver.
Les premiers mois de pouvoir ont été marqués par une obstination passionnée pour les finances publiques, une priorité était donnée aux déficits, dans la dynamique de gestion de la crise des dettes souveraine qui balayait l’Europe depuis l’été 2011. La finalité était de « redresser les comptes dans la justice », alors que la droite se serait contentée de « redresser les comptes ». Les moyens envisageables pour y parvenir n’étaient alors pas encore bien connus, puisque mal anticipés. Cette Gauche d’improvisation accusait à tort et à travers la droite d’avoir blessé le pays, d’avoir découragé les français, ces personnes aussi diverses que variées qu’elle prétendait comprendre. Au bout de deux ans de recherche d’inspiration et de manque de soutien de la part des élites de gauche, l’exécutif tranchera en faveur d’une politique de l’offre puissante, tout en gardant un objectif ambitieux de réduction des déficits publics, supposés être la cause des malheurs économiques du pays. Son raisonnement n’a jamais été expliqué, et une grande partie de la Gauche n’a pas pris la peine d’essayer de le décrypter, peut-être justement parce qu’elle n’en avait pas les capacités. C’est alors que l’unicité de 2012 se déchira, sur une histoire de stratégie de politique économique, pour laquelle personne n’a été en mesure d’en prouver la pertinence ou l’impertinence. Certains élus indisciplinés dénoncèrent l’inefficacité assurée de ces mesures « libérales », « de droite », ce « cadeau aux patrons », sans pour autant être en mesure de confronter leur propre vision de la politique économique, puisque pendant ces deux années précédentes, ces « frondeurs » n’ont pas fait l’effort d’en imaginer une. On découvre alors le clivage pesant qui règne entre ces penseurs de Gauche et le monde de l’entreprise, ce moteur de l’économie.
C’est alors que l’exécutif se détacha lentement de sa base électorale, symbolisée par un Parti Socialiste vidé de son identité idéologique. La fracture en son sein est profonde, sans confrontation de fond, sans discussion acharnée sur l’engagement fort et incertain de l’exécutif. Non. Les ténors de gauche et leurs assistants invisibles sont à court de munition, puisqu’ils n’ont jamais pris le soin de recharger du temps où ils étaient dans l’opposition. Ce temps long où la contestation systématique primait sur la confrontation constructive d’idées élaborées et ambitieuses. Les antennes locales se vident, les propositions se raréfient, et l’influence s’érode jusqu’à devenir inaudible. Néanmoins, François Hollande a choisi sa stratégie et compte bien s’y tenir. Le temps perdu où celui-ci comptait sur les ressources intellectuelles de gauche pour redresser efficacement le pays « dans la justice » l’a poussé accélérer les réformes, au prix d’une gouvernance devenue plus autoritaire. Le chômage monte, la croissance ne repart pas, le déficit public n’évolue pas, François Hollande veut jouer de son statut privilégié de Président prévu par la Constitution pour accélérer les réformes, dans un sens toujours affirmé et jamais remis en question, car l’urgence est là, il en est conscient, et il veut agir.
Les projets de loi s’enchainent, la machine législative tourne à plein régime, sous la pression d’un exécutif hyperactif. Mais les institutions parlementaires, cette machine lourde et capricieuse, peinent à suivre la cadence. Les mesures dictées par l’exécutif tardent à aboutir sur une application dans la société, retardant d’autant plus le retour de l’embellie économique. Puisque ces mesures, aussi ambitieuses puissent-elles être, parient sur une logique de moyen-terme dont les résultats ne peuvent se sentir immédiatement. Renverser l’évolution de ce chômage dramatique prendra du temps, le temps que l’appareil privé français retrouve des couleurs, le temps que celui-ci redevienne compétitif, qu’il puisse profiter davantage de l’exportation vers des pays à la croissance galopante, le temps qu’ils réinvestissent dans de nouveaux appareils productifs après avoir remis en service les outils précédemment mis à l’arrêt, le temps de renouveler leurs stratégies industrielles et commerciales pour s’adapter aux enjeux économiques à venir, le temps que la confiance des consommateurs remplisse les carnets de commande durablement. Ces étapes successives et incertaines sont les conditions de la réussite de cette politique d’offre aux effets impalpables proposée par l’exécutif ce 14 janvier 2014 et durant les mois qui suivirent. En attendant la « reprise », la population française s’inquiète, du moins la plus en forme. Des pans entiers du peuple français dérivent dans le désespoir, la précarité, l’incertitude, la pauvreté, la nostalgie d’un précédent meilleur et regretté. La peur d’un avenir morose et la souffrance d’un présent rude alors que le monde autour semble continuer d’avancer. L’exclusion se répand comme un virus, par le chômage de longue durée, l’isolement dans la solitude, la vieillesse ou le travail dévalorisant voire déshumanisant.
Le tournant sécuritaire d'un gouvernement solitaire
La solidarité chère à la gauche est invisible. Les associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire survivent dans un environnement austère. L’opinion publique s’enferme dans un sentiment de peur envers cette vague montante venant du Maroc, de Libye et de Turquie. La politique économique engagé par l’exécutif et critiquée mollement par cette gauche irresponsable passe au second plan lorsque cette peur d’ordre socio-économique se transforme en une angoisse foudroyante d’ordre sécuritaire. L’autorité toujours critiqué de ce Président solitaire devint le symbole d’un tournant sécuritaire sans précédent. La France, malgré son enfermement nationaliste, malgré son déficit public supposé dangereux pour sa souveraineté et sa liberté, et malgré l’urgence sociale qui couve et qui s’échauffe sur tout son territoire, assume l’entrée en guerre contre un ennemi qu’elle peine à imaginer.
Après la solidarité, la gauche oublie son identité pacifiste et humaniste. L’opinion est angoissée, son intérêt pour la politique s’épuise, sa confiance envers les élites politique est inexistante. Pour cause ? Cette urgence sociale que les médias négligent et que les politiques dénient, et qui développe un sentiment d’atteinte face à un évènement migratoire majeur né d’instabilités sécuritaires tragiques que ces mêmes médias anxiogènes couvrent sans pédagogie, sans se soucier des capacités du destinataire à interpréter les images diffusées. La responsabilité qu’incarne un Président l’oblige à agir. La gauche est immobile, muette, passive. La droite se radicalise et incite l’exécutif à répondre avec une fermeté que la gauche n’aurait jamais souhaité. Cette fois, elle n’a pas pu l’empêcher, par manque de force, d’influence, de pouvoir. Ce pouvoir qu’elle avait dans ces mains quelques mois plus tôt et que ses représentants ont lâchement abandonné pour des raisons économique, au détriment de ses valeurs sociétales qu’elle ne peut plus imposer ni même renouveler. Le séisme redouté viendra au lendemain d’un drame qui marquera l’Histoire. L’exécutif cesse toute relation avec une gauche inexistante et gouverne dans le sens de l’opinion déboussolé. La révision de la Constitution avec des mesures inégalitaires et autoritaires sera le symbole d’un mandat manqué pour une gauche mal préparée, mal composée et mal organisée. Pendant ce temps, l’exécutif gouverne dans un environnement politique retourné, difforme et bouleversé. L’habilité de François Hollande peut suffire à contenir le chaos, mais sans soutien depuis sa famille d’origine, cet apatride politique représentera à lui-seul et malgré lui la déchéance d’identité de la Gauche française, au détriment du peuple, perdu, mais souverain.
En ce début d’année 2016, la situation politique de la France est inédite. De ce fait, la façon dont les appareils politiques vont préparer la prochaine échéance électorale nationale sera déterminante pour l’évolution de notre République, de son identité, de ses valeurs et de son modèle de société. On l’aura compris, la gauche a une part de responsabilité dans ce marasme, puisqu’elle n’a pas su profiter de ce quinquennat « Hollande » pour tisser son influence à travers le pays. Néanmoins, de nouvelles initiatives émergent chez certains intellectuels en vue de cette présidentielle en ayant comme objectif de faire revivre l’espoir d’un avenir aux couleurs de la gauche. Au centre de ces mouvements, l’idée d’un primaire commence à prendre de l’envergure. Pour autant, est-ce ce dont la gauche a besoin pour retrouver sa place au sein de notre démocratie en berne ?
A défaut de ne pas avoir d'icône, la Gauche doit se concentrer sur un projet collectif
L’exercice de la primaire, dans le cadre de l’élection présidentielle, est nouveau, et son rôle n’est pas encore bien défini. Les conséquences de sa tenue au cours d’une campagne électorale dépendent aussi bien du contexte que des conditions dans lesquels elle est organisée, ceux-ci pouvant changer considérablement selon les choix de ses organisateurs et de l’époque. Il convient tout de même d’imaginer à quoi servirait celle de la Gauche si elle était organisée fin 2016.
Lorsque l’on inventorie les maux de la Gauche, tel que nous l’avons fait jusqu’à cette phrase, nous répertorions deux éléments centraux : le manque d’icônes, essentiels pour un exécutif personnifié tel qu’il est représenté dans notre démocratie ; et le manque d’idées concrètes et visionnaires, essentielles à la rédaction d’un programme de campagne crédible et surtout à la conduite des responsabilités au sommet de l’Etat français.
Une primaire aura pour effet de confronter plusieurs personnalités de Gauche – peu d’entre-elles n’ayant de chances d’être nouvelles – autour de programmes incomplets et d’ambitions individuelles. C’est donc un exercice d’affrontement entre esprits et idées plus ou moins nouvelles, plus ou moins crédibles et plus ou moins adaptées qui viendront occuper l’espace médiatique pendant des semaines. La conséquence heureuse est que la légitimité du candidat à la présidentielle serait améliorée, tout en restant très imparfaite. La conséquence malheureuse est que toute l’énergie dépensée pour l’organisation de ces primaires aura l’odeur d’un gâchis. Encore une fois, la logique électorale de légitimation d’une personnalité prendra très largement le dessus sur l’intérêt fondamental qu’à la Gauche à se réinventer et à bâtir un programme de campagne digne de son rôle historique dans l’évolution du pays. Or, l’émergence de cette nouvelle vision de l’avenir, de cette nouvelle identité dont nous avons défini la nécessité plus haut, est la condition sine qua non pour redonner de la vitalité au débat démocratique nationale et pour que les mesures que l’exécutif élu en 2017 prendra puissent aller dans le sens de l’intérêt générale. L’action gouvernementale du prochain exécutif doit être le bras armé de la gauche française, dans sa diversité et son unité autour de l’intérêt commun pour le collectif. La victoire à la présidentielle ne doit plus être la consécration d’une minorité d’élites solitaires de gauche après un combat acharné et inutile, lâchés dès la fin des primaires pour cause de divergence, mais bien la victoire d’un projet partagé entre les élus et les citoyens, portée par une vraie vision collective de l’avenir.
Lorsque l’on demande à un représentant de s’engager à défendre une position lors de primaires, on ne peut pas lui demander de se ranger, lui et ceux qui le soutiennent, dans les rangs quelques semaines plus tard, au risque de lui faire perdre toute crédibilité. Or, c’est bien cette crédibilité des représentants qui fait défaut, il ne faut donc pas organiser des primaires qui viendrait davantage l’éroder. Ces mêmes ténors, représentant une Gauche la plus large possible, doivent s’unir plutôt que de s’affronter pour construire plutôt que de démolir un projet collectif plutôt qu’individuel. Ce travail doit être le fruit d’une réflexion profonde élaborée dans la durée et pour le long terme, enrichit par les acteurs de la société civile attachés aux valeurs de solidarité et de liberté que la gauche doit incarner. Intellectuels, journalistes, artistes, universitaires, politiques, cadres d’entreprise, tous ces ambitieux qui souhaitent contribuer à la prospérité dans la justice doivent eux-mêmes être les porteurs de ce projet. Le candidat à la présidentiel n’est qu’une icône au milieu d’une idée qui recouvre toute la société, il ne doit pas rester seul à espérer que la masse le suive passivement.
On devine alors que ne pouvant pas confronter des idées, les primaires pourraient peut-être aider à trouver la personnalité la plus apte à répondre aux exigences de l’exercice présidentiel, cette fameuse icône qui inscrira son nom sur les bulletins de vote. Mais dans le contexte qui sera celui de fin 2016, rien ne nous fait croire aujourd’hui qu’un ténor de la Gauche sera en mesure de devenir plus « présidentiable » que François Hollande. En effet, ce dernier, malgré les décisions ambiguës qu’il ait pu prendre par rapport à la Gauche lors de son mandat, reste néanmoins la personnalité la plus préparée à assumer cette fonction hautement difficile de Président de la République française. Il a les qualités d’orateur, de négociateur, de représentant, de chef des armées, il a ficelé des liens étroits avec ses homologues étrangers, rendant l’action diplomatique de la France efficace, il a accumulé une certaine expérience dans la gestion de l’appareil d’Etat et connait mieux que quiconque à gauche le rôle d’un Président. Mais ni sa campagne ni son mandat ne devra ressembler aux précédents, il doit être le messager d’un mouvement global d’engagement du peuple de gauche, porté par un projet. L’évolution solitaire et autoritaire qu’il a menée ces quatre dernières années doit être comblée par une gouvernance hétérogène et populaire.
Cette critique de l’initiative d’une primaire à gauche n’est pas une critique de l’ambition, la Gauche doit retrouver l’optimisme et se remettre à rêver, c’est plutôt la critique d’une méthode qui ne fera qu’enliser davantage un mouvement trop dispersé. Ainsi, le vainqueur de la présidentielle de 2017 ne doit pas être François Hollande mais bien la Gauche. Cette Gauche indispensable qui a toujours marqué l’Histoire par des initiatives inédites, cet entité profondément humaniste qui donne sens à notre modèle républicain, qui défend l’importance de la solidarité au nom de la fraternité, progresse dans la justice au nom de l’égalité et s’adapte au temps au nom de la liberté. Cette Gauche qui n’a aujourd’hui ni prénom ni visage, ni présent, ni projet. Cette Gauche couve dans l’esprit d’un peuple impatient, il est temps de lancer sa marche, au nom de notre jeunesse, au nom de l’espérance.
Documents joints à cet article

7 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON