Il était parti. Il est donc revenu...
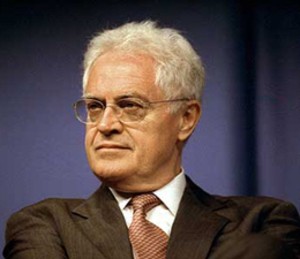
![]()
Qui a dit : "Je me retire de la vie politique" ? Lionel Jospin, le 21 avril 2002. Qui a dit : "Pour moi, aujourd’hui, à quelques mois de ce moment où les décisions doivent être prises, cette question [d’une candidature à la prochaine élection présidentielle] est une question ouverte." ? Lionel Jospin, hier soir, sur TF1.
Il était parti. Il est donc revenu. Pour commenter cette actualité, Pierre Moscovici, ancien ministre de Lionel Jospin, partisan de Dominique Strauss-Kahn dans la pré-campagne présidentielle du Parti socialiste, était l’invité de RTL, ce matin, à 7h50. De ses propos prudents, il faut retenir sa fidélité à la candidature de Dominique Strauss-Kahn, doublé d’une analyse mesurée sur le retour de l’ancien Premier ministre. Il ne voit pas bien les circonstances qui le rendront effectif, mais il convient que les mots prononcés sur TF1 hier soir changent un peu la donne.
Pour être complet sur le sujet, il faut préciser que le rendez-vous avec Pierre Moscovici a été bouclé vers 17 heures hier soir. Plusieurs responsables socialistes contactés avant lui avaient, tous, refusé l’invitation. Hier soir à 20h45, constatant que Lionel Jospin s’était avancé davantage que ne le prévoyaient ses propres amis, j’ai sollicité François Hollande ; il m’a répondu "non" pour ce matin, "non" aussi pour demain matin, réservant sa première réaction pour ses partenaires du Parti socialiste, réunis en convention samedi prochain.
Sur
le fond de l’affaire, que dire de ce retour de Lionel Jospin ? Qu’il met
en lumière deux faiblesses de la démocratie française.
La première
tient au prix accordé à la parole donnée. Défait au premier tour de
l’élection présidentielle, Lionel Jospin a dit : "Je me retire". Dès ce
moment, pratiquement, personne n’a cru à la solidité de cet
engagement. Aussitôt, des spéculations se sont nouées sur le thème :
reviendra ? Reviendra pas...
Au-delà du petit jeu, ceci veut dire que la parole politique n’est jamais considérée comme fiable dans le débat politique français. Les exemples sont innombrables de ce rapport très ambigu que les citoyens entretiennent avec leurs dirigeants. C’est Jacques Chirac qui dit qu’il ne nommera jamais un chef de parti au gouvernement. Puis il nomme Nicolas Sarkozy, président de l’UMP. C’est Nicolas Sarkozy qui assure aux députés que jamais l’Etat ne descendra en dessous du seuil de participation de 70% dans le capital de Gaz de France. Désormais, il soutient la privatisation de l’entreprise publique, préalable à sa fusion avec Suez. Fait significatif : invité hier soir du journal de France 3, Nicolas Sarkozy n’a même pas été confronté à sa promesse antérieure par la journaliste qui l’interrogeait, preuve supplémentaire qu’un engagement pris dans la vie politique française n’a aucune valeur pour personne.
La
culture commune qui est la nôtre privilégie en fait la tactique,
l’adaptation aux circonstances, les méandres de la lutte pour le
pouvoir, à la morale et au respect de la parole donnée. C’est pourquoi
nous préférons une campagne électorale flamboyante, où le candidat
dira le mieux aux Français ce qu’ils souhaitent entendre, plutôt qu’un
moment pédagogique, où la réalité des problèmes sera exposée, avec
l’aridité des solutions pour les résoudre.
Cette psychologie
collective est proprement destructrice. D’une part, elle met
totalement de côté la question de la confiance. Comment croire à une
parole publique qui n’engage personne ? Et dès lors, comment investir
durablement ses espoirs dans un fonctionnement démocratique quand cette parole, au bout du compte, s’installe dans le mensonge permanent ?
Le désenchantement qui découle de cette situation explique, à mon sens, davantage que des analyses sociologiques ou des projections pseudo historiques, la puissance des courants extrémistes, à droite et à gauche, qui contestent aujourd’hui la démocratie française.
Le
journalisme, pour ce qui le concerne, n’a jamais fait de la morale une
question importante dans son traitement de l’actualité. Représentatif en
cela de la culture dominante, il fait la part belle, avec
complaisance, au romantisme de la politique qui survalorise le parcours
des acteurs, leurs revirements, leurs interminables courses au pouvoir
de leurs interminables carrières, plutôt que la rectitude de leurs
propos et de leur pensée.
Ce journalisme-là est une faiblesse. Il ne
remplit pas le rôle qui devrait être le sien, aujourd’hui, dans une
société gangrénée par le doute et affaiblie par la méfiance.
Donc
Lionel Jospin revient, après avoir dit qu’il partait. Un peu comme il
avait dit qu’il n’avait jamais été trotskiste avant de concéder qu’il
l’avait été un peu, ou qu’il ne privatiserait jamais France Télécoms
qu’il a lui même mis sur le marché boursier.
La cohérence dans le zig-zag : voilà un concept typiquement français.
La deuxième faiblesse mise en valeur par cet épisode est, elle aussi, caractéristique de notre ordre politique malade. Partout ailleurs en Europe, ou dans les démocraties comparables, les moeurs imposent un renouvellement des acteurs publics. Margareth Tatcher, Felipe Gonzales, Gerard Schroder, Bill Clinton, pour ne citer qu’eux, n’ont jamais pu entretenir l’ombre d’un espoir de retour au pouvoir, parce que cela aurait paru inconcevable à leurs propres concitoyens.
Une loi non écrite, mais salutaire, paraît stipuler qu’après avoir tenté votre chance, appliqué votre programme, réalisé votre dessein au service de la collectivité, il est temps de laisser la place à d’autres, porteurs de nouveaux projets, dotés d’une énergie et d’une fraîcheur qui donneront de l’allant à leur action et insuffleront de l’optimisme dans la société.
En
France, pays comparable en cela à l’Italie, c’est pratiquement l’inverse. On
accepte les valeurs sûres, voire on se réfugie en elles. On investit dans
des personnages déjà couturés par les combats, cabossés par les échecs,
hélas aussi souvent convertis au cynisme à force d’avoir tant et tant
bataillé. Ce type de représentation finit par teinter une psychologie
collective et introduit un pessimisme assez profond sur l’ordre des
choses et l’évolution du monde.
On pourrait dire de la France
qu’elle est un vieux pays parce qu’elle a de vieux dirigeants. C’est
ainsi que la même semaine, le lundi, puis le mercredi, on a entendu
d’abord Jacques Chirac expliquer qu’il se prononcerait sur une nouvelle
candidature au début de l’année prochaine, puis Lionel Jospin expliquer
qu’il était lui aussi disponible pour refaire un tour de piste.
Chirac-Jospin en 2007, avec en embuscade Jean-Marie Le Pen : plus le temps passe, et plus c’est toujours la même chose. Connaissez-vous une autre définition du désespoir ?
77 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









 )
)
