Les communes nouvelles arrivent
On dispose d’un avant projet de loi de réforme des collectivités locales, en 98 pages, depuis le 17 juillet 2009. C’est la première mouture issue des rapports d’Edouard Balladur et du sénateur Claude Belot, qui devrait se muter en projet de loi après le passage en conseil des ministres le 16 septembre prochain. La réduction du nombre des communes est au programme, dans une formulation très influencée par les échecs passés.
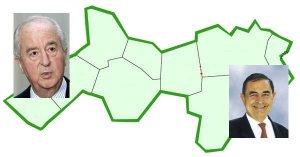
A l’annonce de l’avant-projet, la presse s’est focalisée sur deux points que je n’évoquerai pas ici, la création de conseillers territoriaux regroupant conseillers généraux et régionaux et l’apparition d’une dizaine de métropoles sous forme de nouvelle catégorie de collectivité territoriale. Il y a deux autres points moins spectaculaires, probablement plus importants dans ce projet de réforme : une série de dispositions renforçant la position des communautés par rapport aux communes et l’introduction des communes nouvelles.
C’est la 3ème tentative, après les échecs de 1959 et 1971, de diminuer le nombre de communes. Une partie de l’opinion y est favorable (1), mais il y a des résistances en particulier au sein de la population rurale, la plus directement concernée par l’éclatement communal. On accuse souvent le conservatisme des élus, mais les ruraux sont aussi très réticents à ce qui leur apparaît souvent comme une prise de pouvoir du centre sur la périphérie, plusieurs expériences de consultation dans les communes fusionnées ont montré qu’il était risqué de solliciter le consentement des électeurs de la campagne pour un regroupement. Cette nouvelle tentative affiche d’abord beaucoup de prudence, mais très tactique, elle prépare un encerclement.
Donc l’avant-projet de loi propose la création de communes nouvelles en substitution des communautés et de leurs communes membres. L’initiative de la création peut être prise soit par la majorité qualifiée des conseils municipaux de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale, c’est-à-dire communauté de communes ou communauté d’agglomération), soit par le conseil communautaire, soit par le Préfet. Mais, de toute façon, la majorité qualifiée (les 2/3 des conseils représentant 50% de la population ou 50% des conseils représentant les 2/3 de la population) des conseils municipaux est requise. Ensuite, il faut encore une ratification par 50% des électeurs représentants au moins 25% des inscrits.
Qui plus est, le recours contre la procédure électorale est suspensif ! Entre nous, une telle consultation dans plusieurs communes ne peut que créer de l’agitation et ce type de recours a un coefficient de probabilité très élevé. Conclusion pratique évidente : aucun groupe d’élus communautaires ne devrait être assez fou pour proposer aux électeurs une chose pareille avant les élections municipales, nous voilà donc tranquilles jusqu’en 2014.
L’affaire ne se fera pas dans l’urgence, en tous cas pour l’instant. La commune nouvelle peut conserver des territoires en lieu et place des communes, avec un conseil de territoire, un maire de territoire et une mairie de territoire qui garde le service d’état-civil, en un mot : tous les symboles. On augmente les indemnités des élus des communes nouvelles de 30% par rapport aux communes ordinaires, on diminue de 30% celles des élus des territoires, et on divise par 3 le nombre maximum d’adjoints dans les territoires sans toucher au nombre de conseillers. On aura pourtant sans doute des difficultés à les réunir dans les petites communes devenues territoires.
La principale compétence communale bascule vers la communauté
Le Maire du territoire a les mêmes pouvoirs que le Maire de la commune pour tous les actes délégués de l’Etat, il donne son avis sur toutes les autorisations du sol. Le conseil du territoire est informé de tous les projets d’équipement dans son périmètre. L’avant-projet de loi s’inspire en fait du modèle des mairies d’arrondissement en vigueur à Paris, Marseille et Lyon. Un peu d’encouragement financier complète l’invitation à entrer dans la modernité des communes nouvelles : la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera composée de l’addition de toutes les DGF des anciennes communes et de l’EPCI plus une majoration de 10%. Est-ce que cela suffira à séduire et à provoquer les regroupements souhaitables ?
Le projet comporte aussi une série d’articles qui renforce les communautés en facilitant le transfert des compétences (majorité simple au lieu de majorité qualifiée) et surtout l’élargissement de la définition de l’intérêt communautaire. Sur ce dernier point, la décision n’est plus soumise aux conseils municipaux dans l’avant-projet. Il y a également deux articles qui favorisent ouvertement la mutualisation des services, en autorisant même le partage de biens, ce qui représente un stupéfiant revirement par rapport au dogme juridique de l’exclusivité des compétences qui régnait encore en maître il n’y a pas si longtemps. Il est aussi question de mutualiser la DGF, mais l’avant-projet annonce plus une intention qu’un dispositif qui prendra corps dans la réforme annoncée de la fiscalité locale à l’horizon de la loi de finances 2010.
Les communautés de plus de 30 000 habitants auront d’office, 6 mois après promulgation de la loi, compétence pour établir les plans locaux d’urbanisme, voilà le plus tranchant. La principale compétence communale bascule ainsi dans le champ communautaire, cela règle le problème de l’implantation des logements, et notamment des logements sociaux. Le terrain a été déminé en faisant de l’Ile-de-France un dossier à part, dans les autres agglomérations cette disposition ne fera pas forcément plaisir à tous les élus UMP, mais ce genre d’arbitrage est sans doute déjà entériné hors du champ des caméras bien avant l’examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale. On peut se demander néanmoins pourquoi les plus petites communautés y échappent tant le laxisme en matière de péri-urbanisation est le fait des communes périphériques, tant cette situation constitue une épine dans le pied du développement durable, et tant les services de l’Etat lui-même y jouent un rôle anesthésiant.
Dédramatisation et garrot pour les résistants isolés
L’idée générale de cette loi est largement dominée par les préoccupations tactiques, on essaie de créer un processus évolutif. L’objectif d’intégration dans les communes « nouvelles » n’est pas dissimulé, mais on dédramatise. C’est une possibilité ouverte, et on met en avant un luxe de précautions, les conseils municipaux pourront se maintenir en conseils de territoire. On aide la mutualisation des services, et on encourage la fusion du côté des administrations locales. C’est moins polémique, alors que c’est sans doute beaucoup plus efficace. Le terme même de fusion a disparu, on efface toute provocation symbolique... Le second aspect de la tactique est moins glamour : on modifie les règles en faveur des communautés une fois que celles-ci sont instituées, on va modifier ainsi progressivement l’équilibre des pouvoirs en faveur des communautés, et on finira bien par se rendre à l’idée d’intégrer tout cela dans des communes nouvelles. Parallèlement on contraint les récalcitrants isolés à faire des communautés.
Pourvu que le tintamarre médiatique reste bien concentré sur la question hautement politique de la fusion des conseillers régionaux et généraux. Une fois que l’on aura permis la réduction du nombre d’administrations locales et leur rationalisation, la réduction du nombre de communes sera une question beaucoup moins préoccupante. Cette 3ème tentative pourrait être la bonne.
(1) voir l’article de Paul Cosquer
15 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









