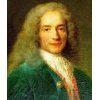Les indécis, clé du scrutin présidentiel
Cette élection se caractérise par une situation paradoxale. Le pourcentage d’électeurs encore indécis demeure proche de 30% à moins de trois semaines du premier tour. Dans le même temps, un nombre de Français très important (80% d’après certaines études) indiquent leur intention d’aller voter le 22 avril. Cette campagne électorale est devenue l’un des sujets majeurs de discussion dans la population, et rarement journaux et programmes audiovisuels n’ont eu un tel succès avec leurs sujets sur cette élection. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, et les éléments qui emporteront la décision chez ces indécis, qui détiennent dans leur vote le résultat final, sont complexes.

Nouveaux électeurs
L’une des raisons qui peut être à l’origine de ce fort pourcentage d’indécis est lié à l’évolution même du corps électoral. Un nombre important de Français s’est inscrit pour la première fois sur les listes électorales (certaines communes ont ainsi enregistré des augmentations d’inscription de 20 à 30% par rapport à 2002), et manifeste l’intention de participer à l’élection. Par nature moins politisée, moins habituellement curieuse du débat politique, cette population est donc logiquement plus indécise. Ce souffle démocratique salutaire, ce renouveau d’intérêt pour la politique est un élément très positif, mais il entraîne une difficulté plus importante à anticiper le résultat final. Ces nouveaux électeurs sont en effet à la fois exigeants sur les programmes des candidats mais encore peu informés sur les différents projets de société proposés. Ils ne s’inscrivent généralement pas dans un clivage classique droite-gauche qu’ils considèrent dépassé, et prendront donc probablement leur décision au dernier moment, en fonction de l’ensemble des éléments qu’ils auront pris en compte, plutôt que de se déterminer sur une base partisane.
Electeurs non sondés
Une autre raison, technique celle-là, de l’incertitude actuelle, est liée à la quantité croissante d’électeurs non sondés, car dépourvus de téléphone fixe, parmi lesquels de nombreux jeunes. Ces jeunes ont aussi été nombreux à s’inscrire sur les listes électorales, et on peut penser qu’ils seront plus nombreux qu’en 2002 à voter. Leur choix est aussi, de par leur moindre expérience politique, plus lié, sinon à l’instinctif, du moins à l’affectif, même si l’on sait qu’il se porte en général moins sur les extrêmes et plutôt à gauche. Néanmoins, certaines études ont aussi montré l’intérêt du vote Bayrou auprès d’un pourcentage non négligeable de jeunes, qui se retrouvent dans sa volonté de dépasser le clivage droite-gauche.
Trois vraies options
Enfin, la dernière raison est sans doute plus fondamentale : elle réside dans un choix plus ouvert que lors des élections précédentes. Alors que le clivage droite-gauche, qu’une grande majorité de Français rejettent, était encore l’option prédominante du choix proposé en 2002, et que les candidats principaux eux-mêmes s’inscrivaient dans la continuité des années précédentes (ce qui a pu expliquer la déperdition des voies vers les « petits candidats »), l’élection de 2007 offre à la fois des personnalités plus en phase avec leur époque et trois vraies options politiques différentes en plus des candidats « protestataires » ou « d’idées ».
Le choix final
Ceci nous amène à regarder les différents éléments susceptibles d’influencer la décision finale de ces électeurs indécis.
Traditionnellement, le choix des électeurs se détermine en fonction de trois grands critères :
- un vote de soutien à une idée, à un thème. Ce vote est plutôt lié aux choix pour les « petits » candidats, comme le vote écologiste, mais aussi altermondialiste par exemple.
- un vote protestataire, contre le « système » (typiquement le vote en faveur de Jean-Marie Le Pen, mais aussi, de façon moindre, le vote Bayrou cette fois-ci) ou contre un système libéral qui laisse certaines catégories sur le carreau (vote extrême gauche), voire contre l’immigration ou les musulmans (vote de Villiers ou Le Pen).
- Plus classiquement, un vote d’adhésion à l’un des deux modèles traditionnels de société, de gauche (Parti socialiste) ou de droite (UMP ou UDF pour les élections précédentes, pour les modérés pro-européens).
Mais ce triptyque classique n’est sans doute plus de mise pour de nombreux électeurs indécis en raison de plusieurs facteurs :
- le souvenir du 21 avril 2002, et l’absence de choix véritable au second tour, qui a laissé des traces dans l’électorat ;
- la présence d’un candidat qui souhaite dépasser l’opposition traditionnelle entre droite et gauche au profit d’un gouvernement de rassemblement plus large ;
- la personnalité même de certains candidats, qui suscite de fortes réactions, positives ou négatives.
Les indécis de 2007 choisiront ...
Jean-Marie Le Pen étant sans doute le candidat dont le socle électoral est le plus déterminé, il est peu probable qu’il constitue une option pour de nombreux indécis. De la même façon, cette élection semble peu favorable aux « petits candidats », qui, peut-être en raison du souvenir du 21 avril 2002, ne paraissent pas pouvoir capter une part importante des indécis.
Il est donc assez probable que ces derniers se détermineront, dans leur grande majorité, en fonction d’un choix assez simple :
- Voter en faveur de l’un des deux candidats des partis traditionnels, PS ou UMP. Ce choix a l’avantage d’une assez grande visibilité quant au gouvernement et au projet de société qui seraient mis en place.
Ou
- Risquer le vote en faveur de la proposition nouvelle défendue par le président de l’UDF, mettant en place un gouvernement de rassemblement. Si ce choix correspond bien au souhait d’une majorité, il comporte en revanche une incertitude sur sa réalisation, puisqu’il n’a plus été mis en œuvre en France depuis longtemps (contrairement à de nombreux pays européens).
... Ségolène Royal ?
Le vote pour Ségolène Royal comporte plusieurs atouts. Un projet d’inspiration socialiste traditionnelle dans lequel la candidate a inséré un certain nombre de spécificités personnelles, et le fait d’élire une femme à la magistrature suprême, élection qui n’est pas sans attrait pour de nombreux(ses) Français(es) et serait le signe d’une incontestable modernité. En revanche, cette candidature se heurte à deux écueils : la personnalité de Mme Royal, jugée parfois un peu « tendre » et inconstante, voire populiste, et un programme constitué d’une liste de promesses que beaucoup jugent irréalistes.
... Nicolas Sarkozy ?
De la même façon, le vote en faveur de Nicolas Sarkozy possède pour attrait : celui d’élire une personnalité à l’image dynamique, qui promeut le travail comme vertu principale, et détient une composante sécuritaire appréciée par de nombreux Français. Néanmoins, mis à part certains aspects de son programme qui peuvent apparaître comme privilégiant les catégories déjà les plus aisées, le personnage et sa méthode de travail suscitent aussi des réactions assez vives, qui sont perçues comme susceptibles d’entraîner des conflits sociaux à répétition et des affrontements entre diverses catégories de la population.
... ou François Bayrou ?
De façon opposée, ni le programme ni la personnalité de François Bayrou ne posent problème pour la majorité de ces indécis. Ils sont en effet généralement considérés comme consensuels et réalistes, tout en apportant une touche d’éléments réformateurs nécessaires. Là où le bât blesse, c’est bien dans la faisabilité d’un projet novateur, séduisant mais non testé, de gouvernement rassemblant un spectre large de personnalités politiques. Si les expériences allemande, néerlandaise, voire italienne (puisque le centre droit semble maintenant prêt à rejoindre la coalition de centre gauche dans ce pays) paraissent être couronnées de succès, ces exemples, peu connus des Français, se déroulent aussi dans des systèmes politiques différents. Le vote en faveur de François Bayrou consisterait donc, pour nombre d’indécis, en un pari sur l’avenir, à moins qu’il ne soit aussi un choix par défaut, de rejet des deux autres. Si les enquêtes d’opinion continuent en effet de suggérer, en dépit de la prudence qu’il faut accorder à ces sondages, que François Bayrou est le seul à pouvoir l’emporter au second tour face à Nicolas Sarkozy, ce dernier argument pourrait finalement s’avérer décisif dans l’isoloir.
Quel que soit leur choix final, il y a donc fort à parier que ce sont bien ces indécis qui détermineront le résultat de l’élection le 22 avril, et d’une certaine façon, le type de société dans laquelle nous vivrons au cours des dix prochaines années. Selon toute probabilité, ce choix se cristallisera tardivement, voire même au dernier moment, ce qui devrait relativiser les interprétations abusives des faibles variations observées dans les sondages d’opinion.
74 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









 vivement le 22 au soir qu’on les voit s’étriper joyeusement après lecture des résultats....
vivement le 22 au soir qu’on les voit s’étriper joyeusement après lecture des résultats....
 ,
,