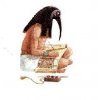Philosophie et politique
Avec la « politique de civilisation », concept emprunté à Edgar Morin, la philosophie est entrée de plain-pied dans le débat d’opinions. Mais dans ce XXIe siècle où l’idéologie semble reléguée à des temps immémoriaux, que peut encore faire la philosophie ?
La res publica, la chose publique, entretient des rapports ténus avec le monde des idées. Les Anciens ont fondé les idéologies à l’origine de nos systèmes politiques quand les Modernes les ont révolutionnés. Nous devons à John Locke l’émergence du parlementarisme et, aux Lumières, les concepts de liberté, d’égalité et de fraternité aux frontons des édifices publics. En cela, la Révolution française fut l’aboutissement de la pensée libérale et la vie publique hexagonale - par l’intermédiaire du droit et des institutions - s’en inspire largement. De même que la conception hégélienne du droit a cristallisé la doctrine française et un pan entier de la jurisprudence. Sur ce libéralisme triomphant, le marxisme a lui-même eu des répercussions ; que ce soit par l’édification d’un Etat providence ou par les acquis sociaux en découlant.
Avec la chute du Mur de Berlin, nos contemporains ont estimé que le temps des idéologies était révolu pour que l’emporte un pragmatisme technocratique. La "troisième voie" de Tony Blair a fait des émules partout en Europe jusqu’à la droite française qui, après des décennies d’un gaullisme circonspect, a invité l’ancien Premier ministre britiannique à la tribune du conseil national de l’UMP. Dès lors la politique de "ce qui marche" l’aurait emportée sur les derniers bastions partisans, relégués aux extrêmes gauche et droite. Ainsi, les philosophes contemporains auraient abandonné l’ordre du conceptuel pour la seule analyse factuelle. Autrement dit, la philosophie ne serait plus qu’une science académique, séparée des sciences politiques qu’étudient les élites en devenir de la nation dans leurs Instituts d’études politiques. Le triomphe de l’économie, de la sociologie et de l’histoire dans les années 1980 à 1990 sur les classes dirigeantes démontrerait cet état de fait.
Mais au-delà de ce constat pessimiste, colporté par les journaux, le monde des idées semble rejoindre à nouveau celui de la praxis. Toujours en quête d’idées, les acteurs publics de gauche comme de droite reviennent doucement à la philosophie politique.
Quoi que le concept de "politique de civilisation" ne soit pas entendu de la même manière par Edgar Morin et par Nicolas Sarkozy, il n’en demeure pas moins que la présidence édifie peu à peu sa doctrine. Lorsque Nicolas Sarkozy s’exprime ainsi lors des voeux aux Français (discours du 31 décembre 2007) : "Avec 2008, une deuxième étape s’ouvre : celle d’une politique qui
touche davantage encore à l’essentiel, à notre façon d’être dans la
société et dans le monde, à notre culture, à notre identité, à nos
valeurs, à notre rapport aux autres, c’est-à-dire au fond à tout ce qui
fait une civilisation (...)", les concepts de culture, d’identité et de civilisation sont alliés avec une philosophie politique. A ce propos, viennent les fameuses références de la nation française aux noms de Jaurès et Blum lors de la campagne électorale. Si le Parti socialiste a estimé qu’il y a eu prise illégale d’un héritage de Jaurès à Blum dont il est dépositaire, une certaine influence philosophique sur le sarkozysme se fait ressentir. Une influence philosophique propre au bonapartisme se basant sur le concept de nation, continuité des temps immémoriaux jusitifiant un exécutif fort et investi d’un destin national (si l’on en croit René Rémond).
A gauche, loin d’avoir abandonné la pensée marxiste, le Parti socialiste est partagé entre une rénovation de gouvernement à la Tony Blair et l’influence de l’altermondialisme dont on a vu les premiers sursauts lors de la campagne électorale de Ségolène Royal. Si le Parti socialiste est loin de vouloir instaurer la fameuse taxe Tobin, n’en demeure pas moins une critique du libéralisme pour la création d’un "contrat social" rappelant les heures heureuses du rousseauisme en France. Au-delà des ancêtres illustres de la pensée sociale et socialiste, d’autres voix s’additionnent sur plusieurs thématiques. Ainsi, la critique de la mondialisation tenue par la direction du PS rappelle celle de Bernard Stiegler, quand le propos sur la laïcité et les valeurs morales de l’Etat raisonne en écho avec la pensée de Régis Debray (tombée en disgrâce depuis lors dans la gauche française). On ne s’étonnera pas qu’un Bernard-Henri Lévy ait inspiré un pan entier des propositions émises par Ségolène Royal tout comme Michel Onfray impose sa réflexion altermondialiste. Réflexion qui perce peu à peu dans une extrême gauche traditionnellement trotskyste.
Cependant, si les idéologies ont encore un poids sur les acteurs publics et si les philosophes tendent à s’immiscer dans les questions de société, l’effectivité du pouvoir démontre la faiblesse conceptuelle des apports des Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Michel Onfray et autres intellectuels académiques et télévisuels. Autrement dit, le pragmatisme l’emporte sur les idéaux. Plutôt que de réfléchir sur une politique globale qui serait une représentation factuelle d’une philosophie, nos intellectuels développent une opinion sur un sujet restreint. Ainsi, la société d’opinion l’emporterait-elle sur la société des idées ? Il faut croire que le cas français est loin d’être généralisé. Outre-Atlantique, le philosophe et économiste Friedrich Hayek a profondément changé la matrice de pensée démocrate quand le slovène Slajov Žižek inspire les élites sorties de Yale et de Columbia. La philosophie n’a pas dit son dernier mot.
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON