Cannibale de Rouen : la prison, asile d’aliénés
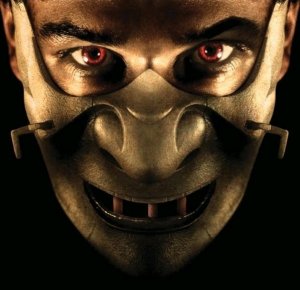
On pourrait de prime abord qualifier l’affaire de simple fait divers - certes particulièrement abominable : mercredi dernier a été retrouvé dans une cellule de la maison d’arrêt de Rouen le corps d’un homme portant une importante plaie au thorax, dont l’autopsie révèlera qu’en ont été prélevés une partie d’un poumon et deux muscles intercostaux. Son codétenu s’accuse immédiatement du crime et précise avoir mangé le coeur de sa victime. Au-delà de l’horreur des faits, cette histoire du cannibale de Rouen pose la question de la place des malades mentaux dans les prisons. Son avocat, maître Fabien Picchiottino, passe à l’attaque : « Je reproche à la maison d’arrêt de ne l’avoir pas placé en isolement, comme l’avait demandé un juge d’instruction, il y a un mois et demi. Mon client l’avait également demandé. Mais le directeur de la maison d’arrêt a certainement estimé que ce n’était pas nécessaire, donc ne l’a pas fait. Pour qu’un détenu demande un isolement et que ce soit conseillé par un juge, c’est assez exceptionnel ! » L’avocat fait état d’une expertise antérieure ayant diagnostiqué la schizophrénie, relève « des antécédents psychiatriques importants » et mentionne le fait que ses parents adoptifs, au sortir d’une précédente incarcération, avaient écrit à la préfecture « pour le faire interner ». Il en déduit logiquement : « C’est quelqu’un qui aurait dû être en psychiatrie. »
Discernement aboli, ou altéré ?
C’est en effet l’évidence même. Du reste, l’article 122-1 du code pénal énonce : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Un homme au profil du cannibale de Rouen n’aurait donc en aucune façon dû être déclaré responsable. Il est pourtant très loin d’être le seul malade mental incarcéré. La dernière étude sur le sujet, menée conjointement par la Direction générale de la santé et l’administration pénitentiaire, date de 2004 et ses conclusions sont effrayantes : un détenu sur quatre (24% exactement) souffre de troubles psychotiques, dont 8% de schizophrénie. Et avant leur entrée en prison, plus du tiers des détenus avaient déjà consulté et 16% avaient déjà été hospitalisés pour raisons psychiatriques. Comment en est-on arrivé à cette épouvantable situation ? « Depuis une vingtaine d’années, les gouvernements successifs ont fermé des dizaines de milliers de lits dans les hôpitaux psychiatriques, au nom - toute honte bue - de la "fin de l’asile", supprimé le diplôme d’infirmier spécialisé, réduit les crédits, sans pour cela créer les structures alternatives à l’hôpital en nombre suffisant, accuse dans Le Monde diplomatique de juillet 2006 Patrick Coupechoux, auteur d’Un monde de fous : comment notre société maltraite ses malades mentaux. C’est le constat du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, dans son neuvième rapport, remis au président de la République en 2003, poursuit-il, citant ledit rapport : « Alors que l’hôpital psychiatrique assurait un hébergement à long terme, y lit-on, il a (...) vu son rôle évoluer vers des séjours dont la durée est limitée à la seule prise en charge de la période de crise aiguë. Or (...) les personnes qui quittent l’hôpital psychiatrique sont toujours des malades, elles nécessitent des soins permanents (...) C’est cette carence qui est à l’origine de la souffrance des familles qui les hébergent, mais aussi de leur forte représentation dans les prisons et parmi les sans-abri. » Coupechoux incrimine ainsi « la politique du tout-sécuritaire » : « les comparutions immédiates envoient en quelques minutes un individu durant plusieurs mois en prison. L’expertise n’étant nullement obligatoire, et pratiquement jamais requise, nombreux sont donc les malades mentaux condamnés, alors que ni le juge ni l’avocat, souvent commis d’office, ne connaissent leur état réel. »
Punir plutôt que soigner
Le docteur Gérard Dubret, psychiatre à la prison d’Osny, accuse lui aussi la procédure d’urgence : « L’immense majorité sont jugés en comparution immédiate et ne voient même pas d’expert. Et pour ceux qui sont examinés, les diagnostics d’irresponsabilité ont été divisés par dix en dix ans », constate-t-il. Pire, la maladie est parfois détectée mais il est estimé qu’elle ne suffit pas à « abolir le discernement », ce qui implique l’irresponsabilité, mais seulement à « l’altérer » : « Eh bien, les peines sont alourdies au lieu d’être allégées », s’indigne-t-il. Dans son rapport Sur le respect effectif des Droits de l’homme en France de 2005, le commissaire aux Droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Alvaro Gil-Robles, écrit : « Au début des années 1980, le taux d’irresponsabilité pénale pour cause de maladie mentale était de 17% ; il est passé à 0,17% en 1997 et n’a connu depuis que peu d’évolution (...) Punir semble primer sur les soins, qui ne suivent pas toujours en prison. Ce constat avait déjà été établi par le rapport du Sénat en 2000, mais n’a eu aucun effet. Aucune conclusion sérieuse ne semble avoir été tirée depuis. Pire, d’après tous mes interlocuteurs, la situation se serait nettement dégradée », conclut-il. Joseph Minervini, psychiatre dans l’unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d’arrêt de Besançon, livre ainsi une anecdote édifiante : « J’ai suivi un jeune schizophrène condamné à quatre ans d’emprisonnement, après comparution immédiate, pour une tentative de braquage avec une arme ridicule. Il sortait d’un hôpital psychiatrique. L’expertise a conclu à sa responsabilité pénale. Nous avons demandé une contre-expertise, qui a donné un résultat contraire. Mais le magistrat s’en est tenu à sa première décision. » Le Comité consultatif national d’éthique, dans son avis sur La santé et la médecine en prison, rendu public mi-décembre, dénonce « l’incarcération de personnes atteintes de maladies mentales graves » : « Cette situation, déjà soulignée précédemment constitue l’un des problèmes éthiques majeurs concernant d’une part la confusion croissante entre les sens respectifs de la peine et du soin, et d’autre part le droit à la protection de la santé et à l’accès aux soins. Ces problèmes éthiques graves d’atteinte au droit à la protection de la santé et à l’accès aux soins impliquent à la fois le droit des malades à la meilleure prise en charge médicale psychiatrique possible de leur souffrance dans des conditions respectueuses de leur dignité, et le droit de leurs codétenus à la protection de leur santé mentale, mise en péril par une confrontation permanente à la "folie" ». La conclusion du Comité est implacable : « Une opinion publique, sensible aux seuls impératifs sécuritaires, finit par méconnaître le fait que la sécurité passe plus par un traitement carcéral digne des personnes que par l’indifférence, le mépris ou la vengeance. » Sur le banc des accusés, donc, le sentiment d’insécurité - et, par là, son amplification par l’exploitation politicienne qu’en font les amis du ministre de l’Intérieur (avec l’extrême droite). Mais n’oublions pas la vraie raison qui pousse à se débarrasser des malades mentaux en les jetant en prison, où la pénurie de moyens pour les traiter est patente. Elle est évidemment économique : une journée en détention coûte 150 euros et en hôpital psychiatrique, 480. Triste société.
77 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON
















