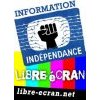Financements des universités : une réforme s’impose !
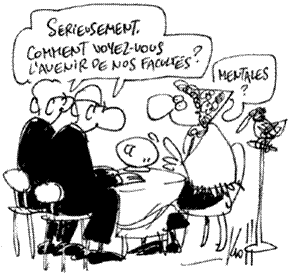
Aujourd’hui, il est couramment reconnu que l’enseignement supérieur français est sous-financé par rapport à celui des autres pays industrialisés. En effet, la dépense française par étudiant s’avère inférieure de 15 % à celles consenties par l’Allemagne ou la Grande-Bretagne, de même qu’à la moyenne de l’OCDE.
Dans un texte qu’elle a adopté lors de son récent colloque à Lyon, la Conférence des présidents d’université (CPU) a souligné la nécessité de porter la ressource par étudiant de 6700 à 9000 euros. Les coûts moyens par étudiant sont très variables selon les établissements de formation : ils sont deux fois plus élevés en classes préparatoires aux Grandes écoles (CPGE) qu’en université. En 2004, un étudiant effectuant une année dans une université publique coûte en moyenne 6700 euros à la collectivité nationale, une année en IUT revenant à 9160 euros, et une année dans une CPGE à 13 760 euros.
C’est ici que se situe toute la problématique. Le manque de financements joue alors sur les moyens pédagogiques (en termes de personnels, d’encadrements, de matériel) et sur les structures vieillissantes des universités.
Une partie de cet effort financier ne pourra pas se faire sans un réengagement pérenne de l’État dans le financement de l‘enseignement supérieur.
Les financements récurrents « critérisés » (la dotation globale de fonctionnement) ont vocation non seulement à apporter aux établissements le minimum nécessaire au fonctionnement, mais ils peuvent aussi contribuer à une certaine péréquation entre les universités, et rétablir entre elles une certaine égalité.
Cependant, les normes utilisées (normes SanRemo) ne permettent pas totalement d’atteindre ces objectifs. Il paraît indispensable d’augmenter significativement le niveau moyen de la dotation par étudiant.
Les financements correspondant à l’entretien des locaux universitaires ne suffisent plus : on observe ainsi une détérioration des bâtiments au fil des années (cf. Rouen l’année dernière, par ex). Ainsi, la partie logistique comprise dans les normes SanRemo ne prend pas en compte les bâtiments construits en hauteur, les contrats de plan Etat/région finançant une grande partie des structures universitaires se révèlent longs, compliqués et faibles en financement. Une des solutions consisterait à déléguer aux régions (avec les financements appropriés), l’entretien et la construction des structures universitaires. Plus proches des besoins réels, elles seraient aussi plus rapides que l’Etat, et permettraient une accélération du besoin de « rajeunissement » du parc universitaire. Pour éviter de trop grosses inégalités entre les établissements, l’Etat veillerait (par une évaluation biannuelle) au bon état des structures.
Les entreprises doivent également être associées au financement de l’enseignement supérieur.
Par exemple, au Québec, les entreprises (hormis les plus petites d’entre elles) doivent acquitter une taxe qui finance une « régie » (l’équivalent d’un compte spécial du Trésor public), lorsqu’elles embauchent des jeunes issus de l’université ; parce qu’on considère que c’est un service rendu aux entreprises, qui doivent alors contribuer au financement de l’enseignement supérieur.
Cette nouvelle source de financement ne peut être mise en œuvre que si elle s’accompagne de réformes de structures importantes : création d’un fonds national « spécifique », création d’un service pour la récupération des financements privés...
Des changements majeurs doivent avoir lieu, en volume mais aussi dans la nature même des ressources à mobiliser.
Contrairement à ce que l’on constate dans d’autres pays voisins, où cela fonctionne bien grâce à des incitations fiscales, le financement de l’enseignement supérieur et de la recherche par les entreprises demeure sous-développé en France.
Les ressources complémentaires dont ont besoin nos universités ne peuvent provenir que d’une combinaison de financements privés sous contrôle public.
Plusieurs possibilités doivent être étudiées : une taxe, ou des financements d’entreprises correspondant par exemple à des travaux de recherche réalisés. Les fonds seraient pour une petite partie versés à l’université (pour ne pas la décourager mais l’encourager à faire du démarchage auprès des entreprises) et le reste serait centralisé dans un fonds national permettant une redistribution plus juste de ces ressources aux universités. Ce système permettrait de ne pas accentuer les inégalités entre les universités selon qu’elles sont plutôt dans une région plus ou moins industrialisée, ou selon le type de filières (scientifiques ou non).
On constate des écarts considérables (de l’ordre de 1 à 8, par étudiant) entre la part de cette taxe qui revient aux universités et celle qui est orientée vers les écoles, les chambres de commerce et d’industrie et les organismes collecteurs sont d’ailleurs bien placés pour le constater.
Le montant de taxe d’apprentissage versé aux universités demeure faible.
En effet, bien qu’elle ait été réformée à la suite du Plan de cohésion sociale de Borloo, la répartition de cette taxe n’est pas des plus favorables aux universités et instituts. Ne pouvant pas dépasser 60 % de la taxe, elle est encore conditionnée à l’activité de l’entreprise.
Dès lors, si on peut jouer sur l’assiette de cette taxe, il convient surtout d’en revoir les modalités de partage.
L’argent des entreprises est nécessaire et celui de la taxe d’apprentissage versé aux universités est anormalement bas.
13 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON