Le CNRS se réforme, est-ce grave docteur ? I : de 1945 à 1990
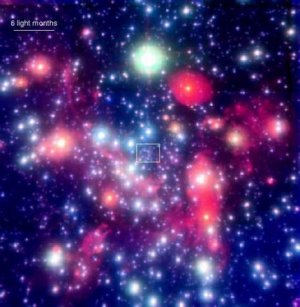
Voilà
des années que le CNRS, ce mal-aimé de la droite, est sur la sellette, dans le
collimateur des politiques qui veulent le réformer, alors que, depuis mars 2004,
une association influente et turbulente, sauvons la recherche, tente de
mobiliser l’opinion publique face aux menaces de réorientation du CNRS décidées
dans les cabinets ministériels, tout en manifestant contre le manque de moyens
et la faiblesse des recrutements, avec une précarité des jeunes chercheurs
n’incitant guère à s’engager dans la recherche, du moins pas en France. Le 4
mars 2008, pas moins de 600 chercheurs reconnus se sont réunis au Collège de
France pour débattre d’un avenir du CNRS qu’ils pressentent de plus en plus
sombre, avec des étapes de réorganisation projetées par la ministre Pécresse. A
terme, le fonctionnement du CNRS et surtout son identité, ses missions de
recherche fondamentale, sont menacés. C’est ce que pensent nombre de
chercheurs appartenant à cette prestigieuse institution. Pour l’instant, la
situation est des plus confuses, suite aux précédentes réformes, notamment la
création des ANR et ARES, si bien que le grand public ignore ce qui se trame
dans les milieux de la recherche et de l’université, elle aussi soumise à une
réforme dont on ne sait où elle mènera. Une mise au point s’impose. Elle
devrait permettre d’y voir une logique en œuvre qui n’est pas forcément
explicite lorsqu’on reçoit les informations brutes. Une logique qui s’est
dessinée lentement, par étape, notamment depuis les années 1990. Un rappel
historique n’est pas de trop pour bien saisir cette complexité des évolutions
et réformes conduites dans le champ de la recherche publique.
Les
riches heures du CNRS, de 1945 à 1990
Rappelons
l’entrelacs articulant enseignement supérieur, recherche et applications
technique. Un entrelacs déjà complexe auquel la manie administrative française,
ayant tendance à tout découper, assume la part maudite de la méthode
cartésienne puisque au bout du compte, les solutions du problème s’éloignent et
c’est d’ailleurs la méthode qui crée des problèmes et qui appelle alors une
méthode d’analyse et de découpage sur la méthode et ainsi de suite. Voilà du moins
ce qu’on comprend en observant l’organigramme où se positionnent trois grands
ensembles. Les grandes écoles scientifiques et économiques, les universités et
enfin le CNRS, auquel se greffent quelques organismes de recherches plus ou
moins célèbres, CEA, Inserm, Inra, Inria, Ifremer, BRGM et quelques autres. Laissons
de côté les grandes écoles. Elles fonctionnent bien et, tant qu’à faire, autant
préserver ce qui marche, même si la sélection paraît élitaire pour ne pas dire
élitiste. Si de moins en moins de fils d’ouvrier y entrent, ce n’est pas la
faute du système de sélection, mais une question sociale. Mais il est hélas
courant de tout mélanger et d’impliquer des institutions dans des rôles n’entrant
pas dans leur mission originelle. L’école en étant un exemple flagrant. On
voudrait qu’une artificielle égalité des chances serve de paravent voilant les
travers d’une féroce compétition des Français pour l’ascension sociale avec le
succès facilité de ceux qui ont plus de moyens, en argent (cours particulier)
et en culture (milieux intellectuels).
Des
deux institutions-clés de la recherche et de la transmission, c’est
l’université qui a vécu les crises et les bouleversements les plus percutants.
La raison est simple, l’université est articulée à la société, mal certes, mais
de manière évidente. Filles et fils de Français de toutes classes et origines
la fréquentent pour obtenir une formation et un diplôme. Certes, avant 1968, on
retient l’image de facultés accueillant plus spécialement les enfants de
classes aisées. En Mai-68, l’université a été le ressort d’une insurrection
portée au paroxysme, puis intégrée dans la réforme pour une nouvelle société. Mais
à partir des années 1980, dans le contexte d’une élévation économique sans
précédent, la massification a engendré d’autres problèmes que les gouvernements
successifs ont tenté de solutionner. Avec des controverses idéologiques bien
connues. Pas de sélection et gratuité de l’enseignement. On voit bien où le bât
blesse. Sans être taxé de réactionnaire, on peut quand même noter que ce libre
accès suscite une sorte de dilettantisme, de tourisme des amphis, de
désinvolture, alors qu’un étudiant qui, comme aux Etats-Unis, paye plein pot
son inscription, sera plus motivé. C’est comme dans un musée. Les jours de
gratuité, on y trouve beaucoup de badauds, mais quand il s’agit de payer, seuls
les amateurs d’art les fréquentent.
Rien
n’a été vraiment solutionné dans les universités, pour différentes raisons, de
positionnement, d’idéologie et de moyens. Car une chose est certaine. Si on
veut maintenir le principe de gratuité, il faut des moyens puissants car il
existe une déperdition importante, ne serait-ce qu’à travers tous ceux qui
sortent sans formation après avoir mobilisé le corps enseignant. Celui-ci
consacrant une partie de son temps à créer des enseignements et, surtout, à
imaginer comment noter les étudiants. Ce qui, parfois, peut dévoyer un savoir devenant
instrument de sélection au lieu d’être le contenu d’une formation ou d’une
transmission. Du coup, face à cette massification croissante, les autorités ont
tenté quelques solutions de rafistolage, visant notamment à assurer un
dispositif adapté aux années de premier cycle, les anciens Deug. Etant donné
que le niveau d’enseignement y est intermédiaire entre le bac et la licence,
des professeurs agrégés (Prags) ont été détachés du secondaire. Et, dans le même
temps, des incitations à multiplier les heures d’enseignements ont été mises en
place par Claude Allègre après 1988. Faut-il le préciser, un enseignant du
supérieur fait également de la recherche (192 heures en équivalent ED) et c’est
cette activité qui est déterminante pour sa carrière. Le ministre a cru bon de
détourner ceux qui préfèrent faire de l’enseignement (je décode, ceux qui ne sont
pas doués pour la recherche et qu’on peut attirer dans les salles de TP et
d’ED) en leur offrant des primes et un plan de carrière spécifique. Quant aux
Prags, ils n’ont pas vocation à faire de la recherche, ni le temps, puisqu’ils
doivent assurer 384 heures, le double d’un enseignant-chercheur statutaire,
mais loin du bagne, car en deçà du temps effectué par un prof en classes prépa.
Avec ce succinct panorama de la situation, on comprend aisément la crise
traversée par une université devenue sollicitée de tous bords, pour donner des
formations, ouvrir au monde du travail, dans un contexte de chômage massif des
jeunes, faire de la recherche, transférer les innovations, former des docteurs,
et faire évoluer les connaissances aussi. Bref, un enjeu trop lourd et surtout
trop coûteux auquel l’université n’a jamais été préparée si on lit dans son
passé, alors que, dans d’autres pays, States notamment, la situation est
radicalement différente, pour des raisons historiques bien connues.
Passons
maintenant au cas du CNRS. Statutairement, le CNRS est composé de laboratoires,
les uns de taille respectable, accueillant du personnel par centaine(s), les
autres plus petits, désignés comme unités, avec une à trois dizaines de
personnes. Le CNRS comprend deux corps, celui des chercheurs, chargés et
directeurs, celui des ITA, ingénieurs, techniciens, administratifs (équivalent
des ATOS de l’université). Le CNRS est une institution récente, crée en 1939 à
l’initiative de Jean Zay, puis après quelques tourmentes liées à Vichy, relancé
sur les rails notamment grâce à de Gaulle qui avait compris l’importance pour
la France de se doter d’une institution performante dans la recherche. De
Gaulle, visionnaire qu’il fût, avait certainement anticipé le devenir des universités, tout en faisant preuve d’intelligence stratégique, sachant qu’il
ne fallait pas compter sur l’université pour exceller dans la recherche
(François Ier avait fait le même
constat, nous léguant le Collège de France). Du coup, le CNRS s’est développé
de manière autonome, tout en accueillant en son sein des enseignants-chercheurs
pour une collaboration partagée où chacun y trouve son compte. L’université se
tient au courant des découvertes scientifiques auxquelles elle participe du
reste et qu’elle peut ensuite les transmettre aux étudiants. Le CNRS bénéficie
d’un surcroît de personnel chercheur de qualité car recruté après un doctorat, accueillant
les meilleurs étudiants pour se former à la recherche et renouveler, par la
voie du recrutement, le corps des chercheurs en accueillant les meilleurs
docteurs. Ce cercle vertueux a fonctionné jusque dans les années 1990. Ensuite,
une transition s’est opérée, lentement, avec des réformes apparemment anodines,
mais faisant qu’au bout du compte un transfert de pouvoir et de décision s’est
lentement opéré, préparant l’étape
actuelle, une de plus pour orchestrer une sorte de phagocytose du CNRS par les universités ainsi qu’une subordination croissante à des impératifs étatiques.
Il s’est produit également une sorte de tectonique des ensembles systémiques,
comme aurait pu le dire Luhmann, autrement dit une adaptation recomposition des
institutions avec à la clé un nouveau dessin des missions et des rapports de
pouvoir, de contrôle, de centralité décisionnelle ; un dessein ayant
bougé, modifiant les anciennes lignes et prérogatives. Et comme ressort
principal, cette fameuse mondialisation, sorte de folie compétitrice mettant
chaque structure et chaque individu sous la surveillance du « contremaître
évalutionniste » et sélectionnant les ensembles les plus performants.
Quel sera le devenir du CNRS dans ce contexte de transformations lentes, mais avérées ? Nous le saurons en examinant quelques faits et évolutions après 1990.
10 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









