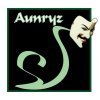Pourquoi la vidéo dans l’enseignement ?
Un des intérêts rarement (jamais ?) mentionné de la vidéo utilisée comme support de cours est dû paradoxalement à une de ses contraintes.
Mais avant de l’évoquer jetons un regard sur les outils traditionnels au service de l’enseignant.
L’écrit
Le document écrit se lit dans un temps (relativement) non contraint, puisque le lecteur peut (depuis quelques siècles) lire « sans les lèvres » en utilisant le canal intérieur, et par là même il s’affranchit de la durée imposée par la lecture à voix haute (qu’on ne peut accélérer sans dommage pour la compréhension)
Cette absence de contrainte permet « de lire sans lire » puisqu’on peut par exemple lire un roman dans lequel le nom du héros est K’rzpptymfr sans gêne excessive puisqu’il n’est pas nécessaire de le prononcer, il suffit de le reconnaître.
Elle permet également de survoler le texte pour en saisir le sens en utilisant cette faculté de « pari perceptif » qui permet d’intégrer à ce que nos sens nous apportent, ce que notre intelligence liée à notre mémoire « devine » ou croit deviner.
Ces « facilités », comme c’est le cas pour tout confort, ont des dérives et des inconvénients.
Le lecteur paresseux (nous le sommes tous), pressé (idem) ou à la recherche de la rentabilité maximale (une loi de l’époque) utilisera tous les moyens pour minimiser le temps consacré à cette tâche, parfois même lorsqu’il s’agit d’une lecture de loisir. L’usage fait toujours croitre ce type d’appropriation / détournement, et l’évolution des pratiques de lecture de l’élève face à un cours écrit n’y déroge pas.
L’enseignant observe donc chez ses élèves, année après année, un rendement décroissant de la lecture du cours et l’exprime sous la forme « Les élèves apprennent de moins en moins leurs leçons (ou de plus en plus mal) »
Le fait que d’autres médias soient apparus plus attrayant, plus dynamique, parfois plus interactifs n’a pu que renforcer cette baisse du rendement de la lecture pour l’acte d’apprentissage que « l’amélioration » de la qualité des manuels scolaires ou des moyens de reprographie des documents n’a pas réussi à enrayer.
Une des tentatives pour combattre la « fulgurance » de l’acte de lecture silencieuse a été, dans des documents projetés, de ne pas afficher le texte en une fois, mais par blocs ou même lettre par lettre, contraignant l’acte de lecture à dépendre à nouveau d’un temps contraint défini par l’auteur du document.
Ces tentatives ont fait long feu. Et c’est bien normal, l’effet pour le lecteur est entièrement négatif puisqu’il subit une contrainte sans contrepartie. Cette contrainte étant plus pesante encore puis que, contrairement ce qui se passe dans la lecture à haute voix, la vitesse de cette lecture lui est imposée (et toute norme en la matière ne peut convenir à personne).
Bien évidemment, l’élève obéissant lira toujours son cours plus ou moins en totalité et l’apprendra plus ou moins fidèlement. Mais pour l’élève moyen, ce mode de contact avec un contenu d’apprentissage est en décalage complet avec sa réalité quotidienne et lui demande un effort important (en plus de celui, incompressible et naturel celui-ci, en rapport avec le contenu).
Une conclusion s’impose : dans l’enseignement le recours à l’écrit doit être utilisé à bon escient et être combiné à d’autres modes de transmission de contenu.
La prestation vivante
Du côté du « LIVE », tout comme pour la transmission en écrit figé, le cours magistral est mis en difficulté par la tendance croissante à l’individualisme notamment chez les élèves qui n’ont pas encore été « dressés » à l’apprentissage en classes à grands effectifs dans lesquels le professeur n’est visiblement pas disponible pour chaque élève plus de 30 secondes par cours.
L’affirmation d’un antique pédagogue grec ( ? nom à retrouver) selon laquelle « si on ne s’adresse pas à quelqu’un en particulier on ne s’adresse à personne » est de plus en plus pertinente.
Immaturité croissante ou tendance naturelle en concordance avec les évolutions de notre société peu importe, chaque élève (notamment au collège) veut qu’on s’adresse à lui, qu’on réponde à sa question dans les délais les plus brefs, et ne peut écouter un message adressé au collectif qui excéderait une à deux minutes.
La vidéo
De ce qui précède, il semble que La vidéo, comme support de cours, par exemple dans le modèle de la classe inversée, puisse être l’outil permettant de satisfaire
- Le besoin pour l’enseignant de ralentir la fulgurance du temps de lecture, en réinjectant du temps contraint dans la prise d’information.
- Le besoin pour l’élève d’une intention dirigée vers lui, sur laquelle il a un peu de contrôle (lecture, pause, dans un temps et un cadre choisi)
A condition bien sûr que la vidéo ne soit pas asséchée des qualités qui la rende utile et attrayante, à savoir.
- La voix qui empêche ou rend difficile une « lecture en diagonale »
- Un aspect vivant : une certaine chaleur (qui suppose une présence, un personnage) , des registres variés (du numérique : l’information codé, texte et nombre, de l’analogique : des images animées, fixes, du bruit (calculé)
- Une scénarisation qui donne à cette vidéo la consistance d’un « projet en soi »
…
EN CONCLUSION
La vidéo , la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo …
vous dis-je !
Mais pas n’importe quelle vidéo.
Et bien sûr, s’articulant finement avec les autres vecteurs de transmission du savoir ou de sa mise en œuvre que sont
- Le document écrit (qui sert essentiellement de résumé ou de modèle)
- La séquence présentielle
- très courtes séquences magistrales servant à sensibiliser , mettre en place des acquis, synthétiser …
- Séquence de TP TD dans laquelle l’enseignant est dans une relation majoritairement individuelle avec les élèves de la classe
Réinjecter du temps contraint dans la rencontre entre un contenu et un élève, voilà la qualité qui fait de la vidéo un outil incontournable pour l’enseignant.
Mais comme toujours avec les nouveaux outils mis à sa disposition (voir l’exemple du cahier de texte en ligne) il ne faudra pas tomber dans le travers qui a fait des premières voitures des carrosses sans chevaux.
Pour cela, il suffit de regarder du côté des pays dans lesquels l’usage de la vidéo dans l’enseignement est une pratique commune, et par exemple vers les USA d’où nous vient cette année la Khan Académy et ses milliers de séquences (dont certaines ont été visionnées des centaines de milliers de fois) qui seront progressivement traduites en français tout au long de l’année.
-------
-------
17 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON