Sida, analyse d’une découverte annoncée comme majeure
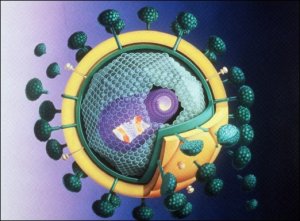
La communication est le nerf des
conquêtes, n’importe lesquelles, bref, on ne sera pas étonné de voir une
brochette d’organismes, dix au total, publics dont l’Inserm, le NIH,
et privés, comme Génome Canada et Génome Québec, annoncer une découverte
majeure sur le sida. Voir ce communiqué de presse dont l’amateurisme susciterait
l’ire des scientifiques du sérail. Mais, peu importe, la science se fait en
dehors des communiqués et sait elle-même trancher les découvertes qui comptent,
alors que ses revues permettent d’accéder aux résultats et aux réflexions
développées par les spécialistes de la chose. Tandis que les institutions
misent ensemble sur des poulains de la recherche, pour empocher la mise
médiatique dans le cas où une avancée jugée spectaculaire se dessine, ce qui
est le cas avec le laboratoire en question, dirigé par le Dr Sékaly. Jugée
spectaculaire ne veut pas dire grand-chose, car seul l’avenir à moyen terme
pourra décider de l’importance de ces résultats annoncés à grand renfort de
communiqués. Mais qu’il faut lire in the text dans la revue scientifique Nature Medecine où ils
ont été publiés (merci à S. Huet d’avoir mis en ligne l’article complet sur son blog).
De quoi s’agit-il ? D’une
investigation menée à partir de matériaux cellulaires prélevés sur trois types
d’individus. Les premiers sains, les seconds porteurs du virus HIV et suivis
par la trithérapie, les troisièmes, désignés EC, bêtement traduits par
contrôleurs élites au lieu de dire « résilients au virus ». Les
médecins ont en effet trouvé des sujets porteurs du virus mais qui, pour des
raisons jusqu’alors inconnues, ne développent pas la maladie, sans pour autant
être traités par la chimiothérapie anti-sida. Voilà pour ainsi dire du pain
béni pour la science car si ces sujets résistent, c’est que leur organisme
utilise des « mécanismes de résilience » que les autres n’ont pas.
D’où l’intérêt évident de faire quelques investigations comparatives. Ce qui
fut fait. Avec comme résultat un indice significatif. Une protéine, désigné FOXO3a,
est impliquée dans la résistance au virus.
Les mécanismes étant complexes (voir
schémas ci-dessous), une présentation synthétique s’impose. L’infection par le
HIV produit un effondrement des cellules T CD4+, T pour thymus, organe immunitaire
dont elles proviennent, tandis les cellules immunitaires B, pour bone marrow,
sont produites dans la moelle osseuse. Ces cellules CD4+ assurent une mémoire
immunitaire centrale. Leur disparition altère les défenses et produit le sida. Et
la protéine FOXO3a ? Eh bien dans une première étape, les équipes dirigées
par Sékaly ont montré son implication dans le maintien en l’état des cellules
CD4+. C’est en réalité assez complexe. Cette protéine existe sous deux formes,
l’une disons brute, l’autre phosphorylée. La phosphorylation des protéines
(addition d’un résidu phosphoryl, un peu comme un individu s’affuble d’une
casquette ou d’un tee-shirt siglé) est un processus cellulaire aussi universel
que la traduction des ARN en protéines. Il se trouve que la forme non
phosphorylée subit une translocation (étymologie, changement de lieu) et migre
dans le noyau après ouverture de pores dans la membrane nucléaire. Une fois
dans le noyau, cette protéine donne comme signal à la cellule de pratiquer
l’apoptose ; autrement dit, de se détruire. L’apoptose est un processus
maintenant bien connu. Certains l’associent à l’embryogenèse et à l’essence de
la vie. C’est le processus de mort cellulaire, indispensable dans la logique de
l’organisme. Les mécanismes sont très complexes. La protéine FOXO3a induit dans
le noyau des transcriptions de gènes favorisant l’apoptose. Et la résistance au sida ? Elle se traduit par une série de différences concernant les
circuits de communication intra et intercellulaire, impliquant au bout du
compte une différence significative au niveau de cette fameuse protéine FOXO3a
qui présente, chez les sujets réfractaires au sida, un phénotype distinct
faisant qu’elle se phosphoryle plus aisément, comme le montrent les différences
observées entre les sujets atteints et les réfractaires (EC). Ainsi, chez ces
derniers, l’armada des cellules
mémoires, les CD4+, est maintenue en bon état de marche.
Des études in vitro semblent confirmer
que cette protéine est liée à la survie et au maintien des cellules CD4+, et
que si, par quelques interférences artificielles, on inhibe les mécanismes de
production de la protéine FOXO3a, la survie de ces cellules mémoires n’en est
que mieux assurée. Mais cette étude complémentaire, décrite dans l’article, n’a
pas une grande importance. Sauf à dire que tout se tient et s’assemble en une
organisation cohérente, ajustée et viable. Je vais maintenant procéder à
quelques digressions et interprétations d’ordre scientifique plus personnelles.
----------------------
Comment comprendre ce mécanisme
d’apoptose ? Premier point. Dans le contexte des cellules immunitaire, la
métaphore informatique offre un éclairage certain. La mémoire est un
déterminant essentiel dans la fonction immunitaire. C’est en quelque sorte
le B. A.-BA de l’immunologie et ses applications courantes, le vaccin. Mais dans
le cas du sida et de la dépression immunitaire, on entre dans la salle des
machines et se dévoilent les secrets des mécanismes moléculaires impliqués, un
peu comme un observateur extra-terrestre découvre qu’un disque dur contient la
mémoire à long terme d’un ordinateur et que, par ailleurs, la DDRam assure une
mémoire à court terme. Le processus d’apoptose découvert dans les cellules CD4+
semble aller de soi. Dans un ordinateur, il existe des procédures pour vider la
mémoire mal utilisée et devenue inutile. Il y a tout lieu de penser que, dans le
champ de l’immunité, des mécanismes produisent l’autodestruction de cellules
qui n’ont plus vocation à garder la mémoire immunitaire trop longtemps (ou bien
à le faire en surnombre). D’ailleurs, c’est ce qui justifie, les rappels de
vaccination, contre le tétanos par exemple. La protéine FOXO3a a été identifiée
comme un des éléments responsables de ce processus naturel et vital de mise à
la « corbeille » de la mémoire immunitaire devenue inutile, un
mécanisme qui, dans le cas du sida, est substantiellement perturbé.
Second
point, la résilience endogène. Le fait que des sujets aient développé des
mécanismes de défense contre les effets du virus HIV semble être en faveur
d’une thèse de « l’intelligence moléculaire du vivant » qui, par on
ne sait quelles voies méta-biologiques, développe des moyens de résilience
adaptés aux menaces de l’invasion virale et ses processus délétères. Les
résultats consignés dans l’article le prouvent, le sort de cette mécanique
immunitaire permet de distinguer les sujets sains, les sujets atteints et ceux
qui, ayant le même sort que les sains tout en étant porteurs du virus, ont
trouvé, dans leurs cellules et/ou leurs gènes, les clés pour survivre
naturellement. Car la mécanique immunitaire des résistants est sensiblement
différente de celle des sujets sains, pour un même résultat au final, la santé
et la vie. Ces quelques lignes résonnent d’une implication philosophique
transcendant les normes de la compréhension scientifique. Sans doute y
a-t-il matière à réfléchir sur le développement de mécanismes adaptatifs qui, en
l’occurrence, n’ont pas un lien ténu avec l’environnement puisque, une fois le
virus intégré, la partie se joue entre cellules de l’organisme.
Troisième point. La mémoire. Et le
rôle des phosphorylations. Il se trouve que la protéine FOXO3a, impliquée dans
la mémorisation immunitaire, est placée dans un dispositif qu’on retrouve dans
le système nerveux à travers la protéine tau qui, selon le degré de
phosphorylation, induit la mort cellulaire par apoptose. Selon les informations
scientifiques disponibles, la protéine tau joue également un rôle dans la
destruction des informations qu’on peut penser inutiles, dans les mécanismes
neuronaux, notamment, les agencements synaptiques. Chez les souris, en
stimulant la production de la protéine tau, on induit une démence proche
d’Alzheimer. Ainsi, comme dans le cas du sida, il se produit des
dysfonctionnements du système et une altération de la mémoire dans des maladies
neurodégénératives comme la PSP et surtout Alzheimer. Le point commun de ces
pathologies, c’est une altération de mécanismes qui, en temps normal, pour un
organisme sain, jouent un rôle essentiel au niveau de la gestion de la mémoire.
Et l’autre point commun, sur le plan moléculaire, c’est ce rôle de la
phosphorylation qui, selon la situation, est interprété dans un sens ou dans
l’autre. Ainsi, une approche transversale permet de dessiner des similitudes
entre pathologies pourtant différentes, mais présentant trois caractéristiques.
Une perte de mémoire, immunitaire ou cérébrale, des processus cellulaires d’apoptose,
enfin, des protéines clés, FOXO ou Tau, impliquées (moyennant phosphorylation)
dans la mort des cellules censées maintenir la mémoire. Merveilleuse nature qui
a su dompter les outils moléculaires pour gérer les communications cellulaires
et édicter, autant qu’interpréter, ces signaux. Comme a su ensuite le faire,
par transcendance et transformation, l’être humain avec ses langages. Nous
voilà propulsés dans les mystères du prochain paradigme dont je n’ai livré que
de modestes clés à l’occasion d’une modeste, mais remarquable, découverte
scientifique.
Documents joints à cet article
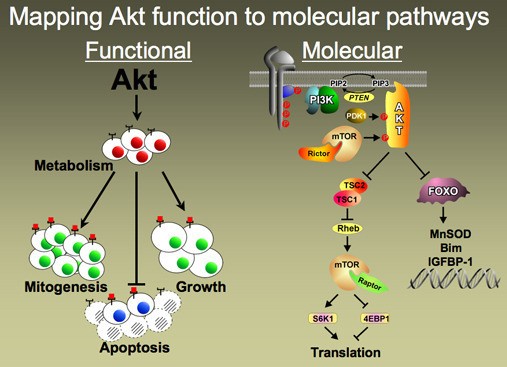
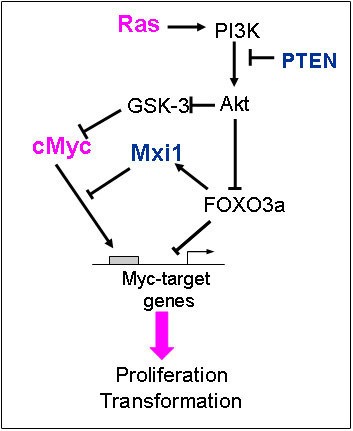
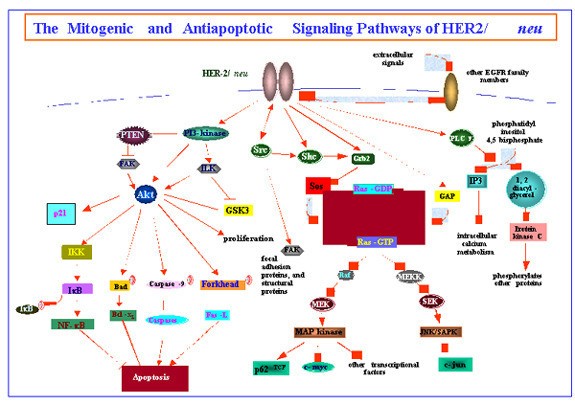
53 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










