Explication d’un texte d’Emile Durkheim sur la morale
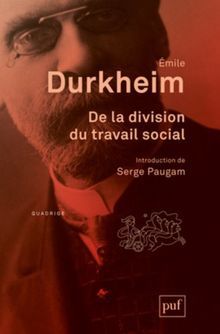
L'auteur :
David Émile Durkheim, né le 15 avril 1858 à Épinal et mort le 15 novembre 1917 à Paris, est un sociologue français considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. En effet, si celle-ci doit son nom à Auguste Comte à partir de 1848, c'est grâce à Durkheim et à l'École qu'il formera autour de la revue L'Année sociologique (1898) que la sociologie française a connu une forte impulsion à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Formé à l'école du positivisme, Durkheim définit le « fait social » comme une entité sui generis, c'est-à-dire pour lui en tant que totalité non réductible à la somme de ses parties. Cette définition lui permet de dissocier l'individuel du collectif et le social du psychologique, et de fonder logiquement les conditions de possibilité d'une action contraignante de la société sur les individus. « Extériorité, étendue et contrainte caractérisent le fait social » : cette thèse fit de lui le véritable fondateur de la sociologie en tant que discipline autonome et scientifique. Durkheim est à l'origine de plusieurs termes qui sont aujourd'hui très connus, comme anomie et conscience collective. L'apport de Durkheim à la sociologie est fondamental, puisque sa méthode, ses principes et ses études exemplaires, comme celle sur le suicide ou la religion, constituent toujours les bases de la sociologie moderne. Toutefois, l'apport de son œuvre va bien au-delà de cette discipline et touche presque toutes les disciplines dans les sciences humaines, dont l'anthropologie, la philosophie, l'économie, la linguistique, et l'histoire. (source : Wikipédia)
L'œuvre :
De la division du travail social a été publié en 1893 par Émile Durkheim, sociologue français, considéré comme le père fondateur de la sociologie française. Cet ouvrage, issu de son travail de thèse, est encore aujourd’hui une référence dans le champ de la sociologie. À l’origine de ce texte, une inquiétude – qui parcourra l'ensemble de l’œuvre de Durkheim – sur la cohésion sociale dans nos sociétés modernes en cette période d’industrialisation et d’urbanisation. Durkheim constate, fin XIXe siècle, que les individus sont de plus en plus différenciés, que les consciences individuelles s’autonomisent de façon croissante. Comment, dans ce contexte de montée de l’individualisme, la cohésion sociale peut-elle être préservée ? Dans cette thèse sur le lien social, Durkheim s’attache à répondre à ce questionnement et, dès l’introduction, il avance une amorce d’explication : dans le même temps que les individus se différencient de plus en plus, la division du travail progresse et ce, dans toutes les sphères de la vie sociale (économie, administration, justice, science, etc.). La spécialisation, la différenciation accrue des individus entre eux les rend de facto interdépendants. La division du travail est en réalité source de solidarité sociale, de cohésion sociale : dans le même temps qu’elle différencie les individus, elle les rend complémentaires et c'est pourquoi, selon Durkheim, elle est morale – elle contraint les individus à vivre ensemble. Avec l’accroissement de la division du travail, on assiste à une transformation du lien social et de la solidarité sociale qui accompagne. (Source : Wikipédia)
Le texte :
"Chaque peuple a sa morale qui est déterminée par les conditions dans lesquelles il vit. On ne peut donc lui en inculquer une autre, si élevée qu'elle soit, sans la désorganiser, et de tels troubles ne peuvent pas ne pas être douloureusement ressentis par les particuliers.
Mais la morale de chaque société, prise en elle-même, ne comporte-t-elle pas un développement indéfini des vertus qu'elle recommande ? Nullement. Agir moralement, c'est faire son devoir, et tout devoir est fini. Il est limité par les autres devoirs ; on ne peut développer à l'excès sa personnalité sans tomber dans l'égoïsme.
D'autre part, l'ensemble de nos devoirs est lui-même limité par les autres exigences de notre nature. S'il est nécessaire que certaines formes de la conduite soient soumises à cette réglementation impérative qui est caractéristique de la moralité, il en est d'autres, au contraire, qui y sont naturellement réfractaires et qui pourtant sont essentielles.
La morale ne peut régenter outre mesure les fonctions industrielles, commerciales, etc., sans les paralyser, et cependant elles sont vitales ; ainsi, considérer la richesse comme immorale n'est pas une erreur moins funeste que de voir dans la richesse le bien par excellence.
Il peut donc y avoir des excès de morale, dont la morale, d'ailleurs, est la première à souffrir ; car, comme elle a pour objet immédiat de régler notre vie temporelle, elle ne peut nous en détourner sans tarir elle-même la matière à laquelle elle s'applique."
Emile Durkheim, De la Division du travail social (1893)
"Chaque peuple a sa morale qui est déterminée par les conditions dans lesquelles il vit" : pour Durkheim la morale n'a rien d'abstrait, il n'y a pas de morale universelle, mais seulement des morales particulières adaptés aux particularités d'un peuple et qui reflètent ces particularités.
Il n'y a pas une seule morale, la même pour tous, mais autant de morales que de peuples. Comme disait Pascal, à la suite de Montaigne : "Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà". Le mot "morale" vient du latin mores et signifie les mœurs, les coutumes, les habitudes. On ne peut pas et on ne doit pas séparer la morale de la vie, des mœurs, des coutumes et des habitudes d'un peuple.
La morale n'a rien d'abstrait et on ne peut pas remplacer impunément une morale par une autre : "On ne peut pas lui en inculquer une autre, si élevée soit-elle, sans la désorganiser, et de tels troubles ne peuvent pas ne pas être douloureusement ressentis par les particuliers" : on peut penser aux "conversions forcées" opérées par les missionnaires catholiques en Amérique du Sud, du temps de Christophe Colomb, conversions qui ont été dénoncés par Bartholomée de Las Cases. On peut penser à la colonisation et à l'idée que l'occident allait apporter aux autres peuples "les lumières de la civilisation". On peut penser aussi à la collectivisation forcée des terres en URSS et à la déportation des paysans libres (koulaks).
La morale confondue avec les mœurs dans les sociétés traditionnelles est très contraignante, vu de l'extérieur, sauf que ces contraintes ne sont pas ressentis par les acteurs qui les trouvent conformes à la nature, sauf si ces sociétés ont connu une ouverture sur l'occident et sont revenus ensuite aux critères d'une société traditionnelle (théocratique en l'occurrence) comme en Iran. Elle prescrit la façon de s'habiller, les relations entre les sexes, les habitudes et les interdits alimentaires et de façon général les comportements dans les moindres détails. Les individus savent exactement ce qu'il doivent faire selon la place qu'ils occupent dans la société.
"Mais la morale de chaque société, prise en elle-même, ne comporte-t-elle pas un développement indéfini des vertus qu'elle recommande ?". Nous nous posons une telle question car nous nous faisons une idée élevée de la morale, coupée de ses racines sociologiques. Pour nous, la morale est une affaire de perfectionnement individuelle et non une réalité sociale. Durkheim nous ramène à la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. La morale n'est pas une affaire de perfectionnement individuel. "Agir moralement, c'est faire son devoir et tout devoir est fini" : la société ne nous demande pas d'être parfaits, elle laisse l'idée de perfection morale à la religion, mais simplement de faire notre devoir.
La morale, pour Durkheim n'est ni déontologique, à la manière de Kant, bien qu'elle s'appuie sur le devoir, ni conséquentialiste, elle ne cherche pas "le plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre", ni aristocratique, ni hédoniste. La vie n'a pas pour pour le bonheur ou le plaisir comme chez les philosophes de l'antiquité. La morale n'est pas fondée sur le culte de l'individualité, mais elle a un contenu précis et elle consiste à accomplir sa tâche au sein de la division du travail afin d'assurer la solidarité et la cohésion sociale. A une morale individuelle, Durkheim veut substituer une morale collective, fondée sur la solidarité.
Durkheim distingue implicitement entre les devoir stricts que nous imposent la société et les "devoir larges" de la religion ou de la charité. Entre les devoirs stricts et les devoirs larges, il ne doit pas y avoir conflit, accomplissement des uns au détriment des autres.
Il ne s'agit pas d'un devoir abstrait à la manière de Kant, exprimé à travers des impératifs catégoriques et applicables dans n'importe quelle situation : "Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une législation universelle" ; "Agis comme si la maxime de ton action devait par ta volonté être érigée en loi de la nature" ; "Agis de façon à traiter l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne des autres, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen".
Peu importe pour Durkheim que l'on ait l'illusion d'agir de façon désintéressée, par pure obéissance à la loi morale, au devoir (impératif catégorique) ou que l'on agisse par intérêt (impératif hypothétique), pourvu que l'on accomplisse son devoir vis-à-vis de la société.
Ce devoir n'est pas abstrait et ne s'impose pas d'abord à une conscience personnelle, il a des contenus précis et une dimension essentiellement sociale. Le titre de l'ouvrage de Durkheim dont ce texte est extrait est De la division du Travail social. Se comporter de manière morale, c'est essentiellement collaborer dans la société à sa place au sein de la division du travail qui se développe à l'époque où Durkheim écrit ce texte. Selon lui, l'individualisme induit par la société moderne comporte des germes de désagrégation sociale. Il faut donc remplacer les anciennes solidarités traditionnelles par la solidarité des différents acteurs de la société dans le cadre de la division sociale du travail, l'ingénieur et l'ouvrier par exemple. Durkheim conçoit la société à la manière d'un organisme dont toutes les parties collaborent harmonieusement à la survie et au maintien du tout. Cette conception diffère de la vision marxiste d'une société divisée en classes sociales antagonistes.
Note : La division sociale du travail existe à l'intérieur des sociétés aussi bien humaines qu'animales (chez les abeilles et les fourmis par exemple). Elle constitue l'un des principes fondamentaux de leur organisation. Publié en 1893, La Division du travail social étudie la répartition des activités productives, entre des groupes spécialisés dans des activités complémentaires. Pour Émile Durkheim, la division du travail est un phénomène social plus qu'économique. Durkheim distingue :
Les sociétés traditionnelles où se manifeste une solidarité mécanique car fondée sur la ressemblance entre les membres ; la conscience collective y est forte et la tradition produit les normes et détermine la culture du groupe ; les activités sociales sont peu diversifiées et donc peu spécialisées.
Les sociétés modernes où la combinaison des phénomènes d'urbanisation, d'industrialisation et d'extension du salariat favorise la multiplication des activités sociales et des métiers : le « travail social » est donc fortement divisé. Les individus se libèrent de la pression du groupe et c'est désormais la loi qui régit la vie en société et non la coutume. La solidarité subsiste cependant, mais elle relève désormais davantage de la gestion ou de l'encadrement des interdépendances entre individus et groupes sociaux. Durkheim parle alors de « solidarité organique ».
La division sociale du travail se traduit par la répartition des rôles et des fonctions (politiques, économiques, religieuses, sociales, etc.) entre les membres de la société. Chacun est ainsi spécialisé dans une fonction, un rôle qui le rend complémentaire des autres et crée ainsi du lien social. La véritable fonction de la division du travail est de créer entre les personnes un sentiment de solidarité, de contribuer à l'intégration générale de la société et d'être un facteur essentiel de la cohésion sociale.
L'intégration sociale peut se définir comme une situation ou un processus d'insertion au cours duquel un individu ou un groupe d'individus trouve sa place dans un même ensemble, ce qui aboutit à la formation d'un ensemble harmonieux.
Le développement excessif de sa personnalité comme le font les esthètes comme Baudelaire, Brummel ou Oscar Wilde est plus dangereux qu'utile pour Durkheim et doit demeurer marginal. Certains poètes romantiques qui protestaient contre les débuts de la société industrielle se comportaient de façon égoïste.
D'autre part, l'ensemble de nos devoirs est lui-même limité par les autres exigences de notre nature. Nous avons des devoirs, certes, vis-à-vis des autres, mais ces devoirs ne sont pas infinis comme le veut par exemple Emmanuel Levinas, ils sont limités par les exigences de notre nature. L'homme est un animal comme les autres, bien qu'il soit aussi un animal social, il a des besoins : manger, boire, dormir, se reproduire, s'abriter, se protéger. Parmi les exigences de la nature humaine, il y a notamment le droit de propriété. L'homme a naturellement besoin de posséder des biens et il en a le droit.
"Il est nécessaire que certaines formes de la conduite soient soumise à une réglementation impérative, il y en d'autres qui y sont naturellement réfractaires" : Autrement dit, nous sommes tenus de nous soumettre à la loi pour certaines actions formellement autorisés ou interdites, mais il existe des actions qui échappent à la loi, dans lesquelles le législateur n'a pas à intervenir.
La morale ne peut pas réglementer les fonctions industrielles, commerciales et elle ne le doit pas. Elle n'a pas à interférer dans ce domaine non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'au contraire, il est vital pour la société. Emile Durkheim soutient ici la liberté d'entreprendre.
"Considérer la richesse comme immorale n'est pas moins funeste que de voir dans la richesse le bien par excellence". On peut penser à la fable des abeilles de l'économiste Bernard Mandeville qui a d'ailleurs inventé l'expression "division du travail".
La fable des abeilles est une fable politique de Bernard Mandeville, parue en 1714. Elle est bientôt devenue célèbre pour son attaque supposée des vertus chrétiennes. La signification réelle reste controversée jusqu’à aujourd’hui. Friedrich Hayek vit en lui un précurseur du libéralisme économique tandis que Keynes mit en avant la défense de l’utilité de la dépense.
La Fable des abeilles, développe avec un talent satirique la thèse de l’utilité sociale de l’égoïsme. Il avance que toutes les lois sociales résultent de la volonté égoïste des faibles de se soutenir mutuellement en se protégeant des plus forts. Sa thèse principale est que les actions des hommes ne peuvent pas être séparées en actions nobles et en actions viles, et que les vices privés contribuent au bien public tandis que des actions altruistes peuvent en réalité lui nuire.
L’Angleterre y est comparée à une ruche corrompue mais prospère et qui se plaint pourtant du manque de vertu. Jupiter leur ayant accordé ce qu’ils réclamaient, la conséquence est une perte rapide de prospérité, bien que la ruche nouvellement vertueuse ne s’en préoccupe pas, car le triomphe de la vertu coûte la vie à des milliers d’abeilles.
Mandeville soutient qu'une société ne peut avoir en même temps morale et prospérité et que le vice, entendu en tant que recherche de son intérêt propre, est la condition de la prospérité.
Emile Durkheim ne va pas si loin que Bernard Mandeville. Il ne dit pas que les vices privés profitent à la société, mais que la vraie morale consiste à lui être utile. On peut également rapprocher son point de vue de celui du sociologue Max Weber dans son ouvrage : L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904 et 1905).
Weber démontre que « l’esprit » du capitalisme est issu de motifs religieux. Les puritains se référent aux Evangiles et à l'apôtre Paul, pour affirmer que l’homme doit travailler pour assurer son salut. Dans cette logique, le travail est, selon la volonté de Dieu, une fin en soi de la vie humaine. Le travail et l'enrichissement est le signe que Dieu nous accorde sa grâce. Le travail et le bénéfice matériel qui en résulte constituent le but même de la vie, tel que Dieu l’a fixé. La répugnance au travail est le symptôme d’une absence de la grâce.
Il peut y avoir des excès de la morale, par exemple une condamnation absolue des richesses qui est nuisible à la société tout entière. La morale est la première à souffrir des excès de la morale, parce que la morale consiste en un juste milieu entre deux extrêmes : la condamnation des richesses et le fait de voir en elles le bien par excellence. La condamnation des richesses conduit à un ascétisme fanatique à la façon d'un Savonarole et le fait de voir en elles le bien par excellence à la la thésaurisation forcenée, à la manière de l'usurier Gobseck dans la Comédie Humaine de Balzac.
La morale a pour objet immédiat de régler notre vie temporelle et non notre vie spirituelle (chez Max Weber, les deux sont liés) et ne peut pas nous en détourner sans tarir elle-même la matière à laquelle elle s'applique : la morale ne concerne pas le royaume des fins ou les devoirs inconditionnels que nous aurions vis-à-vis de Dieu (Emile Durkheim est agnostique) ou de notre prochain, mais uniquement la vie terrestre, temporelle, sociale.
Ce texte de Durkheim pose davantage de problèmes qu'il n'en résout. Pour Durkheim, la division du travail constitue la seule solution pacifique à la vie en commun dans les sociétés modernes industrialisées. Cependant, certaines formes de division du travail peuvent présenter des traits pathologiques et anormales Elles résultent d'une spécialisation de plus en plus grande des individus et de l'insuffisance de règles susceptibles d'assurer la régulation nécessaire à la cohésion sociale (anomie).
La division du travail ne produit donc pas automatiquement des relations pacifiques entre les membres de la société moderne, pas plus que "la main invisible du marché" ne régule tous les problèmes économiques et sociaux.
La morale pour Durkheim consiste au fait d'accomplir son devoir au sein de la division sociale du travail et peu importe qu'on le fasse par pur respect de l'impératif catégorique ou par intérêt. Durant la crise du COVID, le personnel soignant, les caissiers et caissières de supermarché, les éboueurs, les enseignants, et tous ceux qui accompli leur devoir social, à leur place et selon leur vocation ont été des "héros" de la morale sociale parce qu'ils ont empêché la société de s'effondrer.
Durkheim insiste sur le fait qu'il y a des "pathologies" qui s'opposent à la collaboration pacifique et harmonieuse au sein de la division du travail. On peut penser aujourd'hui aux inégalités sociales et aux disparités régionales, au chômage de masse, aux faillites, aux délocalisation, à l'accroissement de la pauvreté, à l'immigration incontrôlée, à tout ce qui a débouché sur la crise des gilets jaunes.
Le chômage n'est pas une simple "variable d'ajustement", mais une véritable maladie sociale parce qu'il exclut toute une partie de la population de la division du travail social et donc de la moralité. Non pas que les chômeurs soient "immoraux" ou qu'il soit "immoral" d'être au chômage, mais parce le chômage interdit au chômeur d'être pleinement moral en exerçant une solidarité active avec les autres membres de la société au sein de la division sociale du travail.
Selon Pascal Bailly, le développement de l'individualisme qui a accompagné la société moderne a privilégié les valeurs de liberté et de travail. La forte croissance économique des "Trente Glorieuses" relayé par la montée du salariat et de la protection sociale a permis une augmentation du niveau de vie pour un grand nombre d'individus. Les inégalités engendrées par le système étaient atténuées par des institutions comme l'Etat garantissant ainsi une forte cohésion sociale. Pourtant depuis les années 1970, on voit apparaître de nombreux dysfonctionnements (le chômage de masse, la montée des inégalités, les disparités sociales et régionales) qui remettent en cause l'efficacité du système. Comme le pressentait Durkheim, la solidarité organique de notre société moderne ne parvient pas à se mettre en place de manière suffisamment forte pour permettre un fonctionnement harmonieux de la société. Le lien social cède parfois la place à une exclusion aux conséquences humaines désastreuses..."
57 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









 Ce doit bien être la première fois. Saluons l’événement. Champagne. (Virtuel bien sûr et à consommer avec modération)..
Ce doit bien être la première fois. Saluons l’événement. Champagne. (Virtuel bien sûr et à consommer avec modération)..

