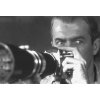Into the Wild : Sean Penn rompt le contrat social
Personnalité parmi les plus anticonformistes et intéressantes d’Hollywood, récemment désigné président du prochain Festival de Cannes, l’acteur et cinéaste Sean Penn, sept ans après The Pledge, ressuscite avec Into the Wild un mythe vieux comme l’Amérique : le retour aux sources par le voyage. Il signe un manifeste très personnel, parfois naïf, pour le retour à la nature. Le film est inspiré par une histoire vraie, celle de Christopher Johnson McCandless, jeune homme de bonne famille qui partit à la découverte des grandes espaces américains au début des années 90 (histoire contée par le journaliste et écrivain Jon Krakauer dans le livre éponyme). Très inégal, maladroit, trop long, d’un idéalisme qui fera rire doucement les cyniques de tout poil, Into the Wild engage néanmoins des réflexions passionnantes sur l’Amérique d’aujourd’hui et, plus généralement, sur la société contemporaine et son rapport avec la nature.
Le retour à la terre
Le paradigme d’Into the Wild : un grand trip solitaire en lisière du monde policé, par un jeune idéaliste. C’est l’histoire d’un mec qui vit sa vie en deux ans (voir le découpage en cinq chapitres, de la naissance à la sagesse), qui se jette à corps perdu dans les bras de la nature, quitte à y risquer sa vie. Un mec cultivé, vaguement poète, qui suit le chemin que tant ont voulu prendre : le retour à la nature, à la terre qui nous a engendrés, dans un mouvement de refus de la civilisation. Comme dans la chanson de Lou Reed, Chris veut « Take a walk on the wild side ». Même s’il est inspiré d’une personne réelle, le personnage peut se lire comme un autoportrait à peine voilé du cinéaste, Sean Penn, militant et artiste à la marge. Chris (formidable Emile Hirsch, animal, fragile, humain) veut rompre le contrat social qu’il a été forcé de signer à la naissance pour retourner au monde sauvage, paradoxalement plus rassurant pour lui qu’une société américaine aseptisée et étouffante. Le symbole même de cette idéologie destructrice et vorace, ce sont les Etats-Unis, bien sûr. Pourtant, Chris ne cherche pas à les quitter pour des contrées plus authentiques, comme beaucoup de contestataires l’ont fait. Non, il va chercher la nature dans son pays même (l’Alaska, cela reste les Etats-Unis). C’est un véritable pied de nez à l’Amérique que d’aller chercher en son sein même ce qui lui reste de nature et de beauté non pervertie, que d’aller chercher en son sein même sa propre négation. Les paysages américains, froids de l’Alaska comme brûlants du désert texan, sont sublimes (au sens fort du terme, impressionnants et écrasants). On peut simplement regretter la façon assez académique qu’a Sean Penn de les filmer, un peu à la manière « carte postale », comme si l’on avait besoin que la caméra nous explique la beauté qu’elle nous met sous les yeux. C’est l’aspect que je trouve le plus raté dans le film, semblant le réduire parfois à un manifeste écolo bien pensant. Mais finalement, force est de constater que le propos n’est pas celui-là : on ne voit pas tellement la nature, sa simple présence, tout autour, suffit au personnage. Cet amour de la nature est celui d’auteurs tels qu’Henry David Thoreau (cité à plusieurs reprises), l’un des précurseurs des mouvements environnementalistes, végétariens et de la contre-culture en général. Into the Wild est finalement un film écologiste au sens noble du terme, au sens politique : on sent l’aspiration à un retour à l’état de nature qui a été perverti par l’homme moderne, rationaliste, qui veut selon la formule de Descartes, « se rendre comme maître et possesseur de la nature ».
Romantiques, beatniks et hippies
On a beaucoup parlé de Sur la route, de Jack Kerouac, pour qualifier le ton et le propos de Sean Penn ici. Mais chez Kerouac, le retour à la nature n’était pas un projet en soi et, surtout, le voyage ne se fait pas seul, mais entre potes. Je pense donc plutôt au romantisme, comme en témoigne d’ailleurs la citation de Lord Byron en exergue du film. Le romantisme, anglais en particulier, chérit ce thème du retrait dans une nature protectrice, comme refuge vis-à-vis d’une société malade. Le lyrisme du film est de cet ordre-là. Car Chris cherche aussi dans la nature ce « dérèglement des sens » (Rimbaud), ce vertige qu’il ne trouve pas dans son monde bien rangé. Ces références littéraires sont faciles à établir, tant le film se plaît (se complaît ?) à citer de grands auteurs : Byron, Tolstoi, London, Thoreau... sans donner jamais la référence la plus évidente : la beat generation. Malgré les objections quant à Kerouac, on retrouve un peu de cet esprit marginal et contestataire qui se concrétise dans le voyage sans réel but ni fin. La différence majeure reste que Chris est sage comme une image : ne boit pas, ne fume pas, ne baise pas (même lorsqu’une fille jolie comme un cœur s’offre à lui). Pour un trip « je me fous de tout », on peut penser que c’est encore un peu soft. Mais de la même manière, le fait qu’un itinéraire de vie de jeune occidental puisse se passer de consommation et de sexe a quelque chose de rassurant. Into the Wild est à la fois un road movie classique (des rencontres successives, des emmerdes, beaucoup de méditation) et un récit initiatique profondément original, jusque dans son issue même, qui sera tout sauf un épanouissement (à moins que... ?). Romantique et beat à la fois, Chris est un littéraire dans l’âme. La musique joue également un rôle considérable. La BO folk (un peu facile) regorge de titres sympas qui font l’éloge de la route (le fameux King of the Road). Entre autres, Goin’ up the Country de Canned Heat, morceau emblématique du festival de Woodstock. Des romantiques aux hippies, il n’y a qu’un pas. Le courant hippie est omniprésent dans le film, notamment à travers les personnages de Jan et Rainey. Son idéal de retour à la nature, de contestation de l’ordre social et de l’establishment, se retrouve à plein dans Into the Wild. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que le mouvement hippie s’est construit lui aussi principalement dans la contestation d’une Amérique expansionniste cherchant à imposer son mode de vie au monde entier. Symbole de ceci, les manifestations, concerts, etc., contre la guerre du Vietnam dans les années 60. Du Vietnam à l’Irak, l’histoire ne fait peut-être que se répéter, et l’engagement personnel de Sean Penn contre les méthodes de Bush junior à l’étranger va dans le sens d’une interprétation politique du film, beaucoup de pied au cul de l’Amérique bushiste, matérialiste et dévastatrice. La quête de la nature est ici un beau symbole du refus d’une société formatée. Mais tout ceci ne reste-t-il pas vain, comme la fameuse « illusion lyrique » ? La nature, comme la société, finira par engloutir l’individu. En tout cas, à la croisée de tous ces mouvements (romantisme, beat generation, courant hippie), c’est leur élan commun vers la liberté qui donne son mouvement au film.
Des grands espaces au néant et au vide
À l’instar de bon nombre de road movies, Into the Wild donne envie de voyager, de prendre le temps de la rencontre et de la contemplation. En revanche, il risque probablement de décourager les audacieux aventuriers qui rêvent de se retrouver seuls au milieu d’une nature accueillante et paradisiaque. Car, et c’est certainement là qu’on peut être reconnaissant à Sean Penn, le film n’est jamais une apologie hébétée de la nature. Celle-ci est incompréhensible, dangereuse, impitoyable, elle regorge de pièges. Chris doit tout à la fois se fondre dans elle (la nature englobe l’homme) et lui faire face (l’homme se construit en opposition avec elle). Pour cela, il emmène avec lui tout ce qui fait l’homme et la civilisation : la technique (un fusil), le savoir (des livres de botanique), l’art (littérature en tout genre) ; ce dernier étant l’inutilité par excellence, mais aussi ce qui fait qu’il reste malgré tout un homme. Même dans le retour à un état de nature supposé, il ne peut nier son humanité : c’est le sens du journal qu’il tient (comme le faisait Robinson sur son île), qui le rattache à la société. C’est là que réside toute la complexité du propos qui se révèle, si on s’y attarde un peu, d’une intelligence profonde dans son hésitation même. Ainsi, le film n’est jamais meilleur que dans des scènes de confrontations, de dialogues où le personnage de Chris est mis face à ses contradictions. Sean Penn a la délicatesse de prendre en compte sans fausse honte la possibilité que son héros se fourvoie complètement. Car finalement, à la vue de ce final désespéré et désespérant, on comprend que la quête éperdue de l’état de nature n’équivaut peut-être au bout du compte qu’à un désir de néant.
Dialogue, confrontation, contestation
Ce qui compte avant tout, et que tous les road movies, road books, etc. ont raconté depuis la nuit des temps, c’est la rencontre de l’autre. Le dialogue, mais aussi l’échange informulé d’une chanson, d’un geste tendre. L’une des réussites du film réside dans le traitement des personnages rencontrés par Chris sur sa route. Il croise des braves gens qui ont fait ou non les mêmes choix de vie que lui. Bel hommage à l’Amérique profonde. De beaux personnages, tous un peu paumés, un peu délaissés, un peu tristes. Je pense notamment à ce petit vieillard attendrissant interprété à merveille par Hal Holbrook. Le schéma psychologique de Chris est moins réussi, un peu simpliste : on apprend que la raison du départ de Chris est qu’il ne s’entend pas avec ses parents. Mais là est justement la contestation : le meurtre du père et de la mère (et de l’oncle Sam ?), en quelque sorte, que ce soit le père de famille ou la mère patrie, qui s’évertuent à détruire dans l’oeuf tout désir de différence et d’émancipation chez ses enfants. Les Etats-Unis modernes n’offrent à leurs jeunes que des perspectives matérialistes, conformistes et étouffantes. Chris, comme Sean Penn dont il semble être le double, installe une défiance à l’égard des valeurs dominantes. Certains des gestes et des décisions du héros, utopistes et anticonformistes, semblent faire tache dans le conformisme ambiant : il brûle ses dollars, rejette les bras ouverts d’une jeune fille. Auparavant, il avait refusé qu’on lui offre une nouvelle voiture, ce qui avait provoqué une réaction de mépris chez son père. D’où la fuite, hors de ce monde de désirs formatés, qui finissent par s’abolir dans le seul désir de consommer. Into the Wild constitue donc une éloge salvatrice de la fuite, même si le retour au contact humain sera finalement jugé nécessaire par Chris : « Le bonheur ne vaut que s’il est partagé », écrit-il entre les lignes d’un roman. L’important, c’est la rencontre ; ce que le héros ne comprendra que trop tard. Cette désillusion finale dit la nécessité de l’autre. Ceci est d’ailleurs illustré par la forme même du film qui fait de chaque rencontre une étape dans la vie du personnage.
Grand film malade
Into the Wild n’est pas une réussite parfaite, loin s’en faut. C’est un film hésitant, qui tarde trop à nous livrer sa substance. Il faut bien admettre également que l’ennui est souvent au rendez-vous, ceci étant dû à une longueur démesurée que rien ne justifie réellement. L’impression d’inachèvement est permanente. La notion de « grand film malade » est la première qui me vient à l’esprit pour comprendre la nature d’Into the Wild. Je laisse quelques instants la parole à François Truffaut : « Si l’on accepte l’idée qu’une exécution parfaite aboutit le plus souvent à dissimuler les intentions, on admettra que "les grands films malades" laissent apparaître plus crûment leur raison d’être. Observons aussi que, si le chef-d’œuvre n’est pas toujours vibrant, "le grand film malade" l’est souvent, ce qui explique qu’il fera, plus aisément que le chef-d’œuvre reconnu, l’objet de ce que les critiques appellent un "culte" ». Into the Wild est pour moi l’application parfaite de ce passionnant concept de grand film malade. La voix off de la jeune sœur du héros, un peu trop explicative, casse parfois la complexité du propos, mais fait partie de ces éléments qui concourent à nous faire ressentir le film comme une urgence. On sait que le projet de raconter l’histoire de Christopher Johnson McCandless lui trottait dans la tête depuis très longtemps. Et, en effet, c’est comme si Sean Penn avait livré sa vie, son être dans ce film fragile et maladroit. Comme si, jamais vraiment sûr de lui, dans un élan de désespoir et de folle humanité, il avait voulu appeler chacun à vivre sa vie, en dehors des chemins tracés par une société mortifère. Je ne fais pas partie de ceux qui lui voueront un culte (suis-je trop cynique ?), mais il est déjà possible de voir qu’Into the Wild, notamment dans la jeune génération, marquera les esprits. Son souffle idéalise, naïf, lyrique et bouleversant exerce un pouvoir de fascination considérable. Pour un film qui invite à se libérer et à se détacher d’une société qui se nie elle-même dans le délire consumériste et matérialiste, ce constat ne peut que rassurer.
5 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON