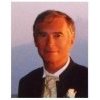La genèse et l’inflation romantique à tous les temps
En cette fin de XVIII
ème siècle, les idées révolutionnaires furent un embrasement qui se
répandit sur toute la terre. Ses sources, et les artificiers de génie
qui présidèrent à sa mise à feu, au siècle des lumières brillèrent de
mille feux.
L’un d’eux parmi les plus influent en matière de sédition, Jean-Jacques Rousseau , fut sans doute le plus paradoxal, le plus attachant, le plus radicalement révolutionnaire, et pourtant le rêveur le plus impénitent d’un monde qui se meurt.

« Cependant une voix s`était élevée si mâle et si forte qu`elle couvrit tout le bruit du XVIIIe siècle. [...] et c`était un pauvre enfant de Genève qui avait été un vagabond, un mendiant, un laquais ! »
Dans l`Histoire socialiste de la Révolution française Jean Jaurès voit en Rousseau « le premier germe du socialisme français » et plusieurs publications marxistes lui attribuent un pareil rôle fondateur. Son histoire de vie est suffisamment atypique pour constituer un cas exemplaire d`une vie d`écrivain marquée par une humble extraction sociale..
La conception qu’a Rousseau de l’état de nature est complexe : l’homme est naturellement bon mais rapidement la société le corrompt, jusqu’à ce que chacun agisse bientôt égoïstement en vue de son intérêt privé. Le contrat social, tel qu’il est théorisé dans " Du contrat social ", a pour but de rendre l’homme souverain, et de l’engager à abandonner son intérêt personnel pour suivre l’intérêt général. L’Etat est donc créé pour rompre avec l’état de nature, en chargeant la communauté des humains de son propre bien-être. Le contrat social rousseauiste ne charge pas un tiers de la sauvegarde de la vie ou de la liberté et de la propriété de chacun, mais charge les citoyens eux-mêmes de cette sauvegarde par le principe de la volonté générale. Le contrat rousseauiste est un pacte d’essence démocratique, dans lequel le contrat social n’institue pas un quelconque monarque, mais investit le peuple de sa propre souveraineté.
L’aimable, le doux, le tendre, l’humble, le douloureux Jean-Jacques décrit ici une arme de guerre redoutable qui tuera le père, décapitera le roi de France détenteur de l’investiture canonique, le roi de droit divin. Dieu sur la terre en quelque sorte.
A sa maman spirituelle et maitresse Mme de Warens, il rend grâce des efforts qu’elle fit pour le "civiliser" :
A peine à ses regards j’avais osé paraitre,
Que, ma bienfaitrice apprenant mes erreurs,
Je sentis le besoin de corriger mes moeurs.
J’abjurai pour toujours ces maximes féroces,
Du préjugé natal fruits amers et précoces,
Qui, dés les jeunes ans, par leurs âcres levains
Nourrissent la fierté des coeurs républicains.
J’appris à respecter une noblesse illustre,
Qui même à la vertu sait ajouter du lustre.
Il ne serait pas bon dans la société
Qu’il fût entre les rangs moins d’inégalité.
...
Cest à toi de juger, ami, sur ce modèle
Si je puis, près des grands implorant de l’appui,
a la fortune encor recourir aujourd’hui.
De la gloire est-il temps de rechercher le lustre ?
Etrange vocabulaire pour l’auteur du contrat social ! Le paradoxe de la complétude.
J.J. Rousseau est à la recherche d’une fusion avec un idéal. Il veut dépasser ses limites, tout être. C’est un idéaliste aux aspirations multiples. Son excitation mentale provoque un élan, un enthousiasme pour les idées novatrices. Il se passionne, c’est la flamme amoureuse. Il verbalise ses émotions, explique, s’emballe. Son humilité, à l’instar d’un volcan gris, contient la puissance qui en un moment soudain modifie la carte géopolitique du monde. C’est l’inflation des désirs, le ferment du Romantisme.
En amont de la révolution française il traversera le vivier du rationalisme et de l’anticléricalisme de la philosophie des lumières, alimentera la cause révolutionnaire de 1789, pour se retrouver en esprit errant entre la restauration 1814-1830 et la monarchie de Juillet 1830-1848, en réaction à la rigidité du classicisme.
Les visionnaires traversent les siècles allègrement et se jouent du temps linéaire.
Le romantisme est avant tout plusieurs choses, une période de l’histoire littéraire, le début du XIXème siècle (1814-1848), une révolte contre l’ordre établi, les classiques, une insolence, une exaltation, un désir d’émancipation, une place importante aux sentiments, sentiments de soi, de la nature, une flamme de jeunesse. Le romantisme a exalté en nous et jusqu’à aujourd’hui des sentiments parfois contradictoires. Le terme de romantisme désigne donc à la fois une période de l’histoire littéraire mais également un certain nombre de caractères qui continuent à faire la sensibilité de chacun d’entre nous comme par exemple le sentiment de notre individualité, notre sentiment sur la nature, sur notre désir d’émancipation.
Le romantisme est à l’image d’un souffle, une aspiration à la vérité, à la profondeur de l’être. Enigmatique, le héros romantique est porté vers l’avenir, il s’inscrit dans le temps, le prend en compte autant que son environnement, la foule. Le romantique est un être de désirs. Il aime, il souffre, il est seul. Le romantique à l’opposé du classique ne peut maîtriser des sentiments par la raison.
Ainsi parlait J.J. Rousseau au terme de son existence terrestre dans les rêveries du promeneur solitaire :
Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit parr un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m’attachent à eux. J’aurais aimé les hommes en dépit d’eux même. Ils n’ont pu qu’en cessant de l’être se dérober à mon affection.
C’est l’état paranoïde, la mort du cygne d’un authentique romantique.
Léo Ferré en contre poids, dans un poème tendre et joyeux évoque les romantiques et l’inflation des désirs.
Ils prenaient la rosée pour du rosé d’Anjou
Et la lune en quartiers pour Cartier des bijoux
Les romantiques
Ils mettaient des tapis sous les pattes du vent
Ils accrochaient du crêpe aux voiles du printemps
Les romantiques
Ils vendaient le Brésil en prenant leur café
Et mouraient de plaisir pour ouvrir un baiser
Et regarder dedans briller le verbe "aimer"
Et le mettre au présent bien qu’il fût au passé
Ils ont le mal du siècle et l’ont jusqu’à cent ans
Autrefois de ce mal, ils mouraient à trente ans
Les romantiques
Ils ont le cheveu court et vont chez Dorian Guy
S’habiller de British ou d’Italiâneries
Les romantiques
Ils mettent leurs chevaux dans le camp des Jaguar
En fauchant leur avoine aux prairies des trottoirs
Avec des bruits de fers qui n’ont plus de sabots
Et des hennissements traduits en "stéréo"
Ils mettaient la Nature au pied de leurs chansons
Ils mettent leur voiture au pied de leurs maisons
Les romantiques
Ils regardaient la nuit dans un chagrin d’enfant
Ils regardent l’ennui sur un petit écran
Les romantiques
Ils recevaient chez eux dans les soirs de misère
Des gens "vêtus de noir" qu’ils prenaient pour leurs frères
Aujourd’hui c’est pareil mais, fraternellement
Ils branchent leur destin aux "abonnés absents"
Référence : La poésie des romantiques de Bernard Vargaftig Librio
Chateaubriand, Folio classique Atala
15 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON