La langue n’est pas sexiste
La langue n’est pas sexiste, d’une intelligence du discours de féminisation de Patrick Charaudeau Éditions le bord de l’eau ; collection Clair & Net 16€ 165p
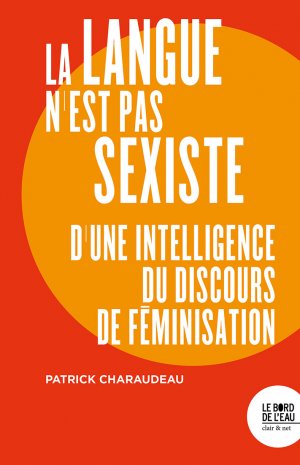
La thèse de ce livre est claire : la langue est un outil à la disposition de tous et s’il y a sexisme, ce ne peut être que chez le locuteur qui l’emploie. Une langue ne saurait être sexiste par elle-même, dans son essence.
Une langue comporte trois dimensions : elle est un système, elle est une norme, elle est le lieu du discours (p18).
La langue-système relève de l’usage permanent et des récurrences que l’on y rencontre, elle porte sur la nomenclature et l’organisation des mots. La langue-système propose des moyens pour décrire les êtres et leurs actions, les idées abstraites… dans un réseau lexical et un réseau sémantique… On peut en faire une description ou (inclusif), en établir des normes, fixer un peu les usages. La langue-norme se pratique de toute façon : « ce qu’il faut dire » fait l’objet d’un contrôle spontanée de l’entourage ; il y a des usages reconnus, il existe aussi des accents, des mots locaux, des mots ou des tournures à la mode, des jargons professionnels… Enfin, le discours est le lieu de la réalisation des actes de langage : parler à, parler de et parler pour… la langue comme discours est dans la personne qui parle.
Dans cette conception « tripartite », une langue ne saurait être sexiste, ou non, que dans son usage singulier, la parole. La féminisation de certains noms de métiers et de fonctions, devenue nécessaire par l’heureuse progression de la place des femmes dans la société peut prendre plusieurs modes, dont l’écriture inclusive en certains cas (p160), cela ne fait pas problème. Fait problème l’extension de cette évolution, et de quelques autres, à l’ensemble de la langue française, sur la base de déterminations volontaires, défavorisant les femmes.
La grammaire, descriptive et prescriptive, édicte les règles d’une langue, nécessaires à l’enseignement notamment. Patrick Charaudeau fait une histoire de l’apparition du français, par dérivation du latin, et de la construction d’une grammaire à la charnière du XVIIIème et XIXème siècle ; il y mêle des comparaisons avec les autres langues latines qui ont la même origine latine, l’italien, l’espagnol et même le portugais.
Le genre des mots est l’objet d’un litige politique intense. On ne sait pas le sexe d’une personne, ni d’une girafe… (féminins grammaticaux). Une table est un meuble… etc. Les relations entre les genres grammaticaux sont complexes et ne peuvent être réduits à cette formulation ancienne, et plutôt délaissée dans les classes selon laquelle le masculin l’emporte sur le féminin.
La raison historique est parfois invoquée, par les féministes, dans deux sens contraires : la prédominance du masculin vient de loin et l’accord de l’adjectif avec le mot le plus proche prend de la valeur également parce qu’il a été pratiqué il y a longtemps. Le sexe et le genre désignent deux choses distinctes et liées : le réel sexuel et le traitement sociétal de l’existence de deux sexes par le symbolique ; ce que ne fait pas le mot anglais « gender ». Le français n’a pas de forme portant le neutre (étymologiquement ni l’un ni l’autre). Il en résulte que le féminin grammatical, appliqué à un groupe ne parle que du féminin réel, le masculin ne spécifiant pas le sexe. Dans un groupe de randonneuses, il n’y a que des femmes, on ne sait pas les sexes d’un groupe de randonneurs. D’une certaine façon, le masculin est un genre non marqué (p69, l’auteur citant Daniel Elmiger). Une idée importante de Patrick Charaudeau est que « le genre peut être neutralisé » par la parole du locuteur (p69). L’auteur insiste sur ces procédures de neutralisation discursives (chapitre 4) ; le contraire, laisser jouer la distinction sexuée étant possible : C’est donc bien au niveau du discours que se situe le processus de neutralisation, c’est-à-dire au moment de l’acte de langage, moment où le sujet parlant fait ses choix pour exprimer ses intentions. (p70). Charaudeau abonde en exemples ayant été dit ou écrit, du type : « je suis députée, les députés ont délibéré de… ». Le premier « députée » nécessite de signifier qu’une femme parle, le deuxième est un masculin neutralisé englobant députées et députés.
Patrick Charaudeau apporte un éclairage linguistique sur un objet sociétal clivant, c’est-à-dire sans terrain de débat, donc sans terrain d’aménagement, de compromis, d’évolution concertée et réfléchie, d’entente. Son opposition à des formes nouvelles par trop imposées et pas forcément justes tend à créer ce terrain de réflexions communes et à ce titre, il est d’une grande utilité.
12 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










