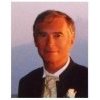La Terreur du Mystère et le père Hugo,
« Homme, veux-tu trouver le vrai ? cherche le juste.
Mais quant au dogme, neuf et jeune, ou vieux et fruste,
Quant aux saints fabliaux, quant aux religions
Inoculant l’erreur dans leurs contagions,
Semant les fictions, les terreurs, les présages,
Quant à tous ces docteurs, à ces essaims de sages
Qui vont l’un maudissant ce que l’autre a béni,
Qui, volant, bourdonnant, harcelant l’infini,
Feraient abriter Dieu sous une moustiquaire,
Quant au daïri roi, quant au pape vicaire,
Quant à tous ces Corans que chaque âge inventa,
Edda, Veda, Talmud, King ou Zend-Avesta,
Ce n’est qu’une confuse et perverse mêlée ;
En les étudiant, ô pauvre âme aveuglée,
Tu n’apprendras pas plus le réel qu’en cherchant
A composer, avec des insultes, un chant ! »
Victor Hugo, Religions et religion.

Faut-il rappeler qu'à l'époque romantique, qu'il traversa avec panache et courage, le ton qui prévalait n'était pas l’areligiosité mais l'anticléricalisme. Le mystique qu'il était, dans sa clairvoyance et son humanité sensuelle voire même lubrique, respectait la foi et la spiritualité. Ainsi tout religieux ou spirituel authentique ne s'y trompera pas. Mais proclamait-il :
« C'est un tort de s'absorber dans la loi divine au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine. La mort n'appartient qu'à Dieu. De quel droit les hommes touchent-ils à cette chose inconnue ? »
Les Misérables Tome I (1890)
Les enfants ne s'y trompèrent point. Pourquoi Victor Hugo ? Sans doute pour son rapport au vivant, à l'imaginaire, à l'enfance. Bonhomme à la barbe sibylline, espèce de grand-père bienveillant de la nativité. Dans les petites classes qui sentaient autrefois la craie, l'encre et l'autorité du maître. École d'hier, hélas révolues, pour les enfants vieux devenus. Victor Hugo trôna au milieu de tous les modèles. Universalité aux libres métaphores, complaisance bonhomme pour l'humble condition humaine. Tempête sous un crâne, affrontant les croyances, les systèmes, dénonçant leurs dérives. Grand-père de légendes et d'histoires renouvelées éveillant les cœurs des petits et des grands. La naïveté des enfants qui nous émerveillent, mais aussi celle des aînés qui sont aussi des enfants, mais qu'on ne voit n'y n'écoute plus aujourd'hui. Eux, les anciens se souviennent, pour les plus sensés, que la jeunesse se love précieusement au fond de l'âme et qu'elle se cultive. Ainsi, certains parmi nous se souviennent du père Hugo et entretiennent son empreinte culturelle multiforme, cosmique, étoilée, déraisonnable. Bien sur contestée par l'intellectualité qui « pense ». Celle des empêcheurs d'aimer en rond...les athées par exemple, mais existent-ils vraiment ? enfin le « croient-ils ».
« Bien que Hugo ait lui-même qualifié de "philosophiques" certaines de ses œuvres - de Littérature et philosophie mêlées publié en 1834 au long poème intitulé « Philosophie » dans Religions et religion (1880) - il ne va pas pour autant de soi que l'on puisse véritablement parler d'une philosophie de Victor Hugo. Nietzsche estimait même, pour sa part, que "ce qui frappe chez Victor Hugo, qui a l'ambition de vouloir passer pour un penseur : c'est l'absence de la pensée". Faut-il être aussi sévère ? On serait certes en peine de trouver chez Hugo un enchaînement rationnel des idées, une argumentation en bonne et due forme ou la construction d'un système cohérent, voire des idées philosophiques entièrement originales. Mais l'omniprésence, dans sa poésie comme dans son oeuvre en prose, de thèmes tels que Dieu, le mal, la mort, le droit et la morale, l'histoire et le progrès, la fatalité et la liberté témoignent de préoccupations authentiquement philosophiques, si l'on admet que la philosophie ne prend pas nécessairement une forme conceptuelle, mais peut revêtir une forme vivante et s'incarner dans des images. »
Victor Hugo et la philosophie – L'Express
Victor Hugo, dans sa pensée, est alors proche de la vision empirique d'Aristote, qui précède, complète et enrichit souvent celle du rationnel et déductif Platon. Comme Hugo, Aristote observe plus qu'il ne contemple. d'abord Aristote s'est attaché très spécialement à réfuter la théorie des Idées ; il constate, pour commencer, que Socrate, inventeur de la méthode dialectique, n'a jamais considéré les choses autrement que dans leur nature, qu'il a fait des inductions et cherché des définitions générales, mais sans jamais attribuer la réalité aux termes généraux séparés des choses. J'imagine bien l'auteur de « Notre Dame de Paris », « La Tragédie des siècles », « Les Misérables » se substituant à Aristote sur le tableau de Raphaël, « l'École d'Athènes » drapé dans sa toge antique, étendant majestueusement, geste horizontal, paume vers la terre, finalité immanente à la vie de l'humanité qu'il a tant aimé et qui au fond lui rend bien. Devant les malheurs dantesques qui l'accablèrent, sa personnalité faustienne décupla de ressources et de créativité. Ainsi naquit l'engouement des tables tournantes. Exilé à Jersey, il fit ressusciter Léopoldine, sa fille aimée, morte noyée, dans une séance de spiritisme. Durant deux ans, Victor Hugo et sa famille « dialoguèrent » avec les esprits de Chateaubriand, Dante, Eschyle et Jésus-Christ... et Hugo se laissa dicter des vers par Shakespeare.
En d'autres temps Aristote clame que « l'astrologie la plus propre et la plus intime philosophie des sciences mathématiques. Elle fait la théorie de l'être à la fois sensible et éternel ». Une tradition venue de l'antiquité la plus reculée et transmise à la postérité sous le voile de la fable nous apprend que « les astres sont des dieux et que la divinité embrasse toute la nature. » Victor Hugo ne prétend pas d'avantage, il est simplement plus proche de la pensée populaire, celle que l'on met en image, en action.
« Homme, veux-tu trouver le vrai ? cherche le juste. »
A travers les Misérables, son œuvre la plus traduite et adaptée, il ne cesse d'émerveiller sans jamais se départir d'un sentiment religieux. Climat de paix et de correspondance qui s'instaure dans notre imaginaire. Peut être que les plus chanceux parmi nous ont connu un papa, une maman qui furent des passeurs de message. Ainsi nos ancêtres participent à une grande fête invisible et pourtant bien réelle dans l'amitié et la complicité. Ils s'animent toujours sous le regard bienveillant du conteur paternel de notre enfance, ô combien subjectif. Nous emportent dans des récits historiques, culturels et fantasmatiques aux tiroirs magiques à l'infini. Mélange de contes et d'histoires qui proliférèrent hors du temps. Ce qui n'exclue pas l'histoire sérieuse à l'époque d'Hugo. Celle du premier empire, de l'envolée prométhéenne de l'aigle, à sa chute, des cafouillages politiques, des embrasements, jusqu'au siècle finissant et « la mort de Dieu » nietzschéenne. Chronologie qui tient du divin et pourtant tellement humaine. Le grand chambardement romantique aux facettes multiples a porté ce chaos. Il semble à ce propos que Goethe ait pu dire un jour :
« Les romantiques sont des classiques malades ! »
À chacun ses trésors pour la méditation heureuse, ses moments paisibles de bonne solitude. En toute saison, la correspondance, l'analogie, la métaphore et surtout, la synchronicité. Pour ce dernier vocable, C.G.Jung nous en parlera au siècle suivant.
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent...
Correspondances, les Fleurs du mal, Baudelaire
Dans notre quotidien de surface, les coïncidences les plus courantes ont été banalisées. L'on entend pourtant les marques du phénomènes dans des expressions familières « La loi des séries », « La providence », « La loi de Murphy »... Dans l'attitude philosophique et dans la vie qu'elle initie, on s'interroge. Les synchronicités peuvent être très banales : A l'occasion d'une recherche, on retrouve un tableau, par hasard dans un ouvrage d'art et se superpose avec bonheur Victor Hugo, poète prophétique sur la célèbre icône philosophique d'Aristote...viennent alors des réponses foisonnantes.
Jean Valjean, un des épicentre, dont la seule évocation réchauffe le coeur et nous invite au voyage. Dans l'induction hugolienne, l'arbre ne cache pas la forêt,
Jean Valjean est semblable à Héraclès dans la mythologie, par sa force, son courage et ses exploits. Sa rencontre avec un serviteur de Jésus, Monseigneur Myriel va hâter en lui la métamorphose spirituelle d'essence évangélique. Mais c'est un personnage mythique aussi fantastique que Quasimodo. Contrairement à l'Albatros, prince des nuées de Baudelaire, ses ailes de géant se déploient librement et même dangereusement. On fait dire à Javert, son antonyme légaliste, « Valjean va toujours contre, contre le courant, contre l'ordre, contre la loi, contre son propre intérêt même. » « Homme, veux-tu trouver le vrai ? cherche le juste. » Nous dit son créateur. Habité par le fantastiquement vrai et beau des poètes épris de justice. Il magnifie la réalité, l'exalte, l'amplifie. Quoi de plus naturel, qu'à travers le roman et toutes les adaptations théâtrales et cinématographiques de notre temps, il fut et demeure l'un de nos secrets amis, nous qui sommes tous en quête d'un en-de-ça et d'un au-delà.
...L'oeil tourné vers le ciel, je marchais dans l'abîme ;
Bien souvent, de mon sort bravant l'injuste affront,
Les flammes ont jailli de ma pensée intime,
Et la langue de feu descendit sur mon front.
Mon esprit de Patmos connut le saint délire,
L'effroi qui le précède et l'effroi qui le suit ;
Et mon âme était triste, et les chants de ma lyre
Étaient comme ces voix qui pleurent dans la nuit…
Extrait de l'ode 14, cinquième livre des contemplations.
Évocation de Jean dans l'Apocalypse. À la fin de sa vie Victor Hugo entretenait l'intense conviction d'être l'incarnation de l'évangéliste de Patmos.
Jean (Valjean), (osons l'imaginaire) est une incarnation romanesque de la vision envisagée par Victor Hugo de l'apôtre que Jésus aimait.
Jean, l'aigle des cimes selon l'icône, la part de spiritualité et de religiosité du poète et Valjean, (Jean du val) le Jean terrestre en prise avec le réel des Misérables.
L'emprunt du nom de la compagne de Jésus, « Madeleine » autre patronyme évocateur de l'inspiration évangélique qui accompagne le poète.
Fauchelevent, personnage, terrestre, certes, mais aérien, transparent, immatériel, symbolique, malgré son imprégnation rustique paysanne. Actif comme le vent avec lequel il se coltine. La finalité imposée par la faux, mythologique et religieuse, préfigurant la destinée et par la même occasion la mort.
En quelque lieu qu'il aille, ou sur mer ou sur terre,
Sous un climat de flamme ou sous un soleil blanc,
Serviteur de Jésus, courtisan de Cythère,
Mendiant ténébreux ou Crésus rutilant,
Citadin, campagnard, vagabond, sédentaire,
Que son petit cerveau soit actif ou soit lent,
Partout l'homme subit la terreur du mystère,
Et ne regarde en haut qu'avec un oeil tremblant…
Le couvercle, les fleurs du mal de Baudelaire
Les phonèmes retentissent dans tous les états de conscience populaire et enseignent toute âme sensible qui s'abandonne à l'intelligence du coeur, pas celui des romantiques, mais notre centre, qui fait écho au divin.
« Mettez un aveugle au soleil : il ne le verra pas, mais il le sentira. Tiens, dira-t-il, il fait chaud. C'est ainsi que nous sentons, sans le voir, l'être absolu. Il y a une chaleur de Dieu. »
Victor Hugo fut déiste mais rejeta le dogme.
« L’intuition, comme la conscience, est faite de clarté directe ; elle vient de plus loin que l’homme ; elle va au delà de l’homme ; elle est dans l’homme et dans le mystère ; ce qu’elle a d’indéfini finit toujours par arriver. Le prolongement de l’intuition, c’est Dieu. Et c’est parce qu’elle est surhumaine qu’il faut la croire ; c’est parce qu’elle est mystérieuse qu’il faut l’écouter ; c’est parce qu’elle semble obscure qu’elle est lumineuse. »
Victor Hugo, Proses Philosophiques
Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange,
Il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange ;
La chose simplement d'elle-même arriva,
Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.
Cette épitaphe énigmatique est une fin mystique qui transcende la violence des réalités humaines en général et celles distillées dans les Misérables. Ce poème dépouillé, en forme de conte, suggère l'effacement de l'individualité. Ode apaisante évoquant la simplicité de la métamorphose dans le grand mystère du retour au divin.
Joyeuses fêtes et bonne route à tous
13 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON