Le 9ème art : Histoire et géographie
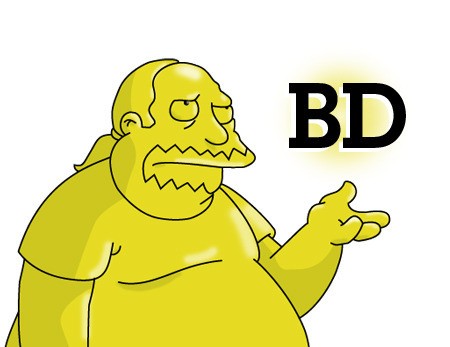 De tous les arts développés durant l’ Histoire, le dernier en date, le 9è, est en France le moins considéré de la société, des penseurs et des médias.
De tous les arts développés durant l’ Histoire, le dernier en date, le 9è, est en France le moins considéré de la société, des penseurs et des médias.Pourtant, il poursuit un essor absolument insolent malgré la crise économique qui frappe le pays. En 2009, le nombre de bandes dessinées francophones a encore progressé de 2,4 %. Le chiffre est inférieur à 2008 mais c’ est la dixième année consécutive de hausse de vente et de production. Année record, 2008 avait vu les éditions progresser de 10 % par rapport à 2007.
En terme d’édition, la bande dessinée représente près de 8 % du marché du livre. Le chiffre d’affaire estimé tourne autour de 320 000 000 euros. A l’heure ou les exploitants de salle crient misère face au téléchargement illégal sur Internet, ou les éditeurs de livres « sérieux » envoient des dizaines de milliers d’exemplaires du dernier « événement littéraire de la Rentrée » au pilon pour mévente, ou les dirigeants des chaînes nationales voient leur audience s’ effriter et avec elles les recettes publicitaires, on peut s’interroger sur les raisons d’une telle vitalité...
Et d’un tel mépris de la « bonne société »...
Mais d’abord, qu’est-ce que la bande dessinée ?
Une Bd est un ensemble. Une juxtaposition volontaire de dessins formant une suite, un récit cohérent. L’histoire classique retient 1894 et la parution du « Yellow kid » dans Truth magazine comme date de naissance officielle.
Mais un simple examen des documents historiques nous montrent qu’en réalité, la BD est un art beaucoup plus ancien.
Ainsi, la tombe d’un scribe egyptien du XIVè siècle avant JC, Menna, est connue pour être ornée d’une fresque en bon état, que l’on peut qualifier de première bande dessinée.
Elle est visible ici : http://blueoryx.ifrance.com/nobles.htm
Elle se lit à partir du bas à gauche, puis en remontant en zig-zag à chaque changement de ligne. Elle décrit une scène de récolte du blé, du premier coup de faucille au paiement de l’impôt.
Certains exégètes estiment même que certaines peintures rupestres entrent dans le cadre de la définition.
Dans la même veine, on peut citer les codex mayas, ainsi que la Colonne de Trajan ( à Rome). Même la célèbre tapisserie de Bayeux répond à la définition moderne.

C’est sans doute la base du mépris affiché par les intellectuels de tous bords.
L’image est un moyen parfait pour éduquer l’enfant. Un simple regard sur le contenu des livres suffit pour comprendre la démarche intellectuelle. Au premier âge, le dessin est roi. Ensuite, le texte, le mot apparaît, et s’associe à l’image pour une meilleur compréhension. Et plus l’age de l’enfant croît, plus le livre qui lui est destiné comporte de textes et de moins en moins de dessins, jusqu’au moment ou seul le texte est présent.
Dans cette optique, le littéraire pur et dur ne peut comprendre l’intérêt d’un ouvrage comportant uniquement des dessins. Il l’associera par réflexe à un ouvrage pour enfant, et ce quelque soit l’histoire contée.
Cela explique aussi le relatif silence des grands médias. A part en janvier ou les journaux parlent d’Angoulème et de son festival, pas un mot ou presque sur l’actualité BD, ou alors en termes très succins et souvent erronés... Qui a entendu Laurence Ferrari parler du festival de Roquebrune, qui se déroule en général en septembre, et qui réunit autant d’auteurs et un public aussi vaste qu’ Angoulème ?
L’avantage premier de la BD sur les autres médias de création et de distraction, est sa capacité à ne demander que peu d’investissement au départ. Une BD a besoin d’un scénariste, un dessinateur, si besoin est un coloriste. Ces fonctions pouvant être assumées par une seule personne ou un studio de cinq. Le matériel se résume au papier, aux crayons et aux couleurs (sachant que ce dernier poste n’est pas automatique, la colorisation pouvant se faire au moment de l’impression, si elle se fait...).
Pour exemple, le prix d’une planche pour un dessinateur débutant tourne autour de 250-300 euros la planche, avant impots. Un album comportant en moyenne 48 ou 64 pages, on a un minimum de 12 000 euros, sachant qu’il faut en moyenne un an ou presque pour réaliser le travail dans le cadre d’un artiste solitaire. Même en ajoutant le prix de l’impression, de la colorisation et de la distribution, on reste loin des 400 millions de dollars de « Avatar ». Pour un résultat parfois encore supérieur. Ceux qui auront lu le « cycle de Cyann » de François Bourgeon ou même « Lanfeust de Troy » de Carrère et Arleston me comprendront.
Très peu d’artistes, dans très peu de médias, peuvent avancer un coût de production aussi faible. Même la télévision française n’est pas capable de produire un épisode de fiction à moins de 150 000 euros. Même « plus belle la vie », qui utilise pourtant des moyens minimaux, coute 85 000 euros par épisode.
Le cout de production est également amorti par le tirage parfois conséquent des albums des séries phares. Le dernier « Titeuf » est sorti avec un premier tirage de 1 800 000 exemplaires. Le livre cosigné BHL-Houellebec, présenté comme étant un gros coup littéraire, est sorti à 150 000 exemplaires en première édition.
Un album de gags comme la série « Titeuf » est vendu un peu plus de 9 euros en neuf. Je vous laisse faire le calcul du gain potentiel...
Bien entendu, il s’agit là d’un extrême. Une BD a un tirage moyen de 15 000 exemplaires. Un livre édité est lui tiré en moyenne à 8-9 000 unités en première édition. Avec les variables provenant de la célébrité de l’auteur ou du potentiel espéré et calculé par le service commercial.
Avec un tel potentiel, il n ’est pas étonnant de voir des éditeurs autrefois strictement littéraires mettre un orteil dans un bain qu’ils méprisaient jusque là. C’est ainsi que Actes Sud, Denoel, Gallimard et Grasset ont rejoint Glénat, Dargaud, Dupuis et autres. Mais l’honneur est sauf car ils ne font pas de la Bande Dessinée, mais du « Roman Graphique ». Nuance...
Reiser avait une expression qui convient bien à la situation : la différence entre la BD et le Roman graphique tient plus du « trouducutage de noblaillon » que d’autre chose... Mais passons.
Nous voyons que nous avons un média de divertissement accessible facilement au plus grand nombre, et d’une production au cout relativement modique par rapport aux autres concurrents.
On peut rajouter le spectre incroyablement large du domaine couvert par la BD.
L’imagination est la seule limite. Un rayon de BD comporte des ouvrages portant sur l’humour, l’aventure, la réflexion, la sensualité, la pornographie même. La découverte et l’exploration ne sont pas oubliés. Tous les lieux, toutes les époques sont couvertes. De la préhistoire lointaine aux mondes de demain. Du village d’à coté à la galaxie lointaine, très lointaine. L’amateur trouvera forcément un ouvrage sur un lieu ou une époque qui lui est chère pour une raison ou pour une autre. A moins de s’abonner à des chaines très spécialisées, la télévision n’offre pas cela. Et le cinéma est également chiche en ce qui concerne par exemple le monde mongol du XIIIè siècle. Cela tombe bien, Glénat a une série de fiction à ce sujet...

A quand remonte la dernière émission grand public sur l’empire Mongol ?
On peut s’y aventurer avec autant de confiance qu’hormis en ce qui concerne les séries humoristiques (et encore...), dessinateurs et scénaristes effectuent un impressionnant travail de documentation en amont afin de restituer au plus juste les décors et le quotidien des personnages. Jacques Martin, l’auteur de séries comme « Alix » (le monde romain antique), « Jhen » (l’europe médiévale), "Osiris" (L’ Egypte pharaonique), était connu pour aller sur les lieux de fouilles pour coller au plus près de la réalité. Ses ouvrages de la série « les voyages d’Alix » tiennent la dragée haute en terme de reconstitution et de véracité historique face aux ouvrages universitaires les plus austères et les plus sérieux.
Même le monde du travail est désormais mis à contribution : les éditions Bamboo ont investi un créneau quasiment inutilisé, l’humour porfessionnel. Vétérinaires, informaticiens, professeurs, gendarmes, sportifs de tout poils, routiers, ont creusé le sillon commencé par les « Femmes en blanc »... Seul manquent encore les éboueurs et les branleurs de dindons. S’il y a des amateurs...
Cette petite incursion dans ce monde quelque peu dénigré et méconnu n’est que le début du voyage. La BD, tout comme la littérature, est présente dans tous les pays. Toutefois, on remarquera que trois grands courants techniques et économiques se dégagent, chacune issue d’un continent différent : l’Europe, l’ Amérique du Nord et l’Asie, plus particulièrement le Japon.
Si les bandes américaines et européennes de la fin du XIXè siècle se ressemblent trait pour trait, une césure va rapidement apparaître dans la production. De son coté, le Japon va lui profiter de son art séculaire des estampes pour donner naissance à son propre genre de BD.
Ces trois grandes écoles sont d’autant plus différentes qu’elles se basent chacune sur un modèle économique et de production différent.
L’ Europe
Le modèle européen, qualifié généralement d’école franco-belge en raison de la prépondérance des auteurs belges et français par rapport aux italiens, espagnols ou aux allemands, est basé sur un modèle très proche de l’artisanat en ce qui concerne la conception.
Dès le départ, le modèle s’appuie sur une propriété individuelle des personnages et des séries. Le dessinateur (et le scénariste s’ils est une autre personne) est propriétaire des droits de sa création. Il crée un personnage, il en est le seul bénéficiaire financier tout au long de sa carrière, à moins qu’il ne cède volontairement ses droits à un studio ou à un éditeur, ce qui arrive souvent en fin de carrière.
Le grand avantage de cette propriété exclusive est que cela permet de garder une cohérence sur toute la série.
Le gros inconvénient, c’est que cela ne garantit qu’une parution d’aventures au mieux annuelle.
Le second inconvénient survient en cas de décès ou de retraite (inopinée ou non) du créateur au beau milieu d’une aventure. Dans ce cas, deux issues existent.
Le créateur a clairement spécifié ce qu’ il devrait advenir de son personnage : l’arrêt simple (Tintin) ou la reprise (Blake et Mortimer, Alix, Thorgal, Astérix quand le moment sera venu) par une autre personne ou une équipe désignée en général par le créateur.
Le créateur n’a pas eu le temps de clarifier l’avenir de ses personnages ou de sa série avant de mourir. Dans ce cas, sa famille ou ses ayants droits décident eux-même de ce qu’il en sera. L’éditeur, s’il n’est pas héritier des droits, ne peut rien faire et les fans non plus. C’est ainsi que l’excellente série « Gil Jourdan » s’est arrêtée à la mort accidentelle de son concepteur, Maurice Tilleux. Au grand dam des fans, la famille a décidé que personne ne pourrait reprendre la série. Seules des rééditions sont permises.
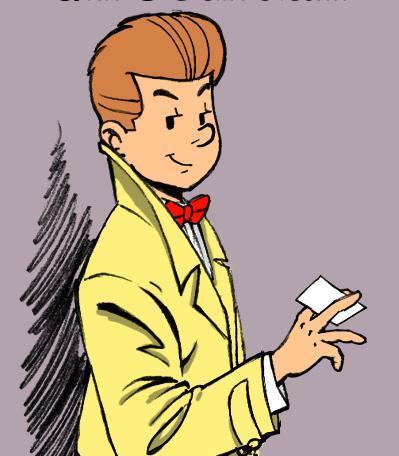
Grand succès public et critique, Jourdan est dans les tiroirs depuis la mort de son créateur. Son intégrale, enrichie de récits courts inédits en albums convaincra t-il les ayants-droits de laisser Jourdan revenir des limbes ?
La diffusion se faisait dès l’origine par voie de presse. Si une série connaissait un grand succès, l’éditeur pouvait alors la sortir en album, un ouvrage ayant une bien plus grande longévité que le périodique.
Mais les années 60 et 70, qui avaient vu les kiosques remplis de périodiques de prépublication, sont bien loin. Si Spirou et Mickey sont toujours de ce monde, Tintin, Pilote, Métal Hurlant, (A Suivre), Pif Gadget ont fini par mettre la clé sous la porte, victimes d’un modèle économique dépassé qu’ils n’ont pas su adapter pour survivre : le jeune public avait changé. Il n’était plus question pour eux de devoir se contenter de deux planches par semaine de leurs héros favoris. La demande était claire : une aventure, dans les années 60 70, était diffusée en kiosque sur plus de 8 mois avec une parution hebdomadaire. Le délai avait progressivement été ramené à moins de 2 mois, augmentant à chaque fois la dose de pagination. Cela obligeait les journaux à prévoir plus de séries (et donc plus de frais) pour remplir leurs pages, tout en les mettant à la merci d’un retard de l’auteur qui pouvait décaler les épisodes de plusieurs semaines, voir plusieurs mois : lors de la livraison hebdomadaire de « QRN sur Bretzelburg », Franquin, au beau milieu de l’aventure, sombra dans la dépression et « Spirou » ne parut pas dans son propre journal pendant plus d’un an...
Certains journaux tentèrent d’abandonner les histoires à suivre au profit de courts récits. Mais cela bridait les capacités scénaristiques et la qualité baissa de façon drastique, provoquant un engrenage vicieux qui aboutissait en général au dépôt de bilan.
Tout n’est pas noir heureusement. De nouveaux périodiques ont depuis faits leur apparition, comme Lanfeust Mag, Jade, BoDoï. Mais les tirages sont loin du niveau des années 70. Lanfeust tire en moyenne à 40 000 exemplaires quand Pif gadget, dans ses grandes années, tirait à 500 000 exemplaires, avec à deux reprises une pointe à 1 000 000 !
La diffusion elle se fait désormais en grande majorité directement en albums. Un procédé qui permet de toucher un large public mais couteux, qui limite les prises de risque et donc enferme le genre dans un modèle assez conventionnel. Seuls quelques éditeurs acceptent de miser un gros tirage sur un débutant qui apporte un travail novateur.
Ce modèle connait actuellement, malgré ses limites, un grand succès.
Il se base sur
- une visibilité accrue : les grands magasins ne considèrent plus la BD comme un sous-genre, relégué en bout de rayon. Des enseignes comme la FNAC ou Virgin leur consacrent même des espaces entiers, ou l’on peut tester sur place et se laisser conquérir par l’histoire ou le dessin.
- des locomotives : des séries à grands succès public, qui garantissent aux éditeurs des rentrées régulières lors de la sortie de nouveautés ou de rééditions. L’argent récolté permet de financer des projets plus audacieux ou des auteurs plus confidentiels. Si Glénat a lancé sa collection Manga avec « Dragon Ball », c’est pour bénéficier de l’aura de la série alors diffusée sur TF 1 et pour pouvoir lancer ensuite des oeuvres de plus grande qualité, mais moins connues ou plus difficiles d’accès.

Sangoku, au début de la saga "Dragon Ball". Oeuvre grand public, il a permit la diffusion d’ouvrages plus matures tels que "Quartier lointain" de Taniguchi, ou "Gon".
L’Amérique du nord
Le modèle nord-américain est lui radicalement différent. Il est même double en fait, selon que l’on parle du comics ou du comics strip.
Le comic-strip
Le comic-strip est un genre à part. Héritier le plus proche des premières bandes européennes, le strip est un gag qui se déroule sur une simple bande, parfois une demi page. Il s’agit d’historiettes complètes, parfois à suivre d’un jour sur l’autre. La parution est en générale quotidienne par voie de presse. Le dimanche, les séries les plus populaires ont droit à une demi-page chacune, en couleur.
Les dessinateurs en sont les propriétaires, sauf exception ou cession de droits lors de la retraite. Leur diffusion dans la presse se fait selon le système de la syndication. Un auteur qui adhère à un syndicat de diffusion voit son oeuvre publiée dans plus d’une centaine de quotidiens sur tout le territoire des USA, et même au-delà : il n’est pas rare de voir les strips diffusés dans plus de 50 pays abonnés. Il est recommandé pour ces derniers d’avoir produit quelques semaines de strips d’avance, pour pallier à un imprévu afin de ne pas interrompre la diffusion : les places sont chères et un auteur trop peu productif peut facilement être mis sur la touche...
Le plus gros syndicat américain est le King Features Syndicates. Crée en 1915, il a permit la diffusion de séries comme Beetle Bailey, Denis la Malice, Popeye, Mandrake.

Beetle Bailey fait le maximum pour en faire le moins possible sur la base américaine en Allemagne ou il est affecté depuis les années 50. Il est le dernier Strip (ou presque) à être dessiné par son auteur d’origine de cette époque !
Le comic-book
Plus connu et plus diffusé en Europe, le Comic est une série ( en général avec des histoires à suivre ) qui met en scène un personnage particulier ou un groupe. Sa diffusion se fait sous forme de fascicules, en général 24 ou 36 pages mensuelles. Pendant longtemps il n’a pas existé d’albums reprenant des histoires complètes mais la hausse qualitative du genre a poussé les éditeurs à proposer de plus en plus souvent les plus grandes aventures sous cette forme après leur parution en kiosque.
Le genre est actuellement surtout connu par sa déclinaison super-héroïque, très populaire aux USA. Mais il existe également depuis l’origine des comics basés sur les histoires d’horreur, le policier, le comique, l’aventure, le western, et même la romance (des séries d’un mielleux qui feraient passer la collection Harlequin pour de la pornographie la plus extrême en comparaison...).
Les premiers comics sont apparus dès les années 30. Ils ont connus un grand succès immédiat, renforcés durant la période 1941-1945 car pour soutenir l’effort de guerre, les plus grands héros prenaient les armées nazies et japonaises pour cible. La fin du conflit a porté un coup fatal à nombre de séries et de maisons d’éditions qui n’ont pas su se renouveler. Le genre est quelque peu entré en sommeil avant que Stan Lee ne sonne le réveil dans les années 60 avec la fondation de Marvel.

Spider-man est assez overbooké avec entre deux et quatre séries (selon les époques) à son nom depuis les années 60 ! Le 600è épisode de la série première a été publié en 2009 aux USA. De quoi en faire rêver plus d’un !
La différence avec l’Europe est qu’aux USA, ce n’est en général pas le dessinateur qui est le propriétaire d’un personnage, mais l’éditeur. Il peut faire travailler une équipe créative pendant un moment puis en changer. Tout dépend du niveau des ventes, de la qualité produite mais aussi parfois de l’évolution que l’éditeur veut donner à la série et qui ne convient pas forcément à l’équipe en place.
La production mensuelle est largement supérieure à ce qu’un auteur européen peut faire. Cela est possible par l’organisation en studio : le dessinateur, une fois qu’il a le scénario et le synopsis, réalise le crayonné d’une première page. Une fois achevée, il commence le crayonné de la seconde alors que la première est encrée par un autre dessinateur. Un lettreur place alors les textes et passe ensuite la page à la personne chargée de la mise en couleur. Sauf accident, ou dessinateur très lent (tel que Mark Millar...Monsieur « je livre mes pages mensuelles tous les trois ou quatre mois parfois... ») , une telle équipe peut produire de la série à la chaîne.
En France, les séries sont diffusées au sein de magazines thématiques, regroupant en général des personnages évoluant dans la même mouvance. Il existe un décalage de 10 mois entre la parution américaine et la traduction française, ce qui est bien pratique pour amortir les soucis causés par les délais de livraisons parfois fantasques des équipes artistiques...
Le Japon
Le troisième continent est celui qui a la culture BD la plus développée au monde. La raison en est que contrairement à l’Europe, l’image n’a pas été un sujet de dénigrement au bénéfice des mots, mais un complément tout aussi important selon les élites littéraires locales.
Le terme « manga » ( « images dérisoires ») existe depuis le XVIIIè siècle. Il servait à cette époque a désigner les caricatures, les petits dessins préparatoires ou réalisés sans y penser. Aujourd’hui, il désigne en général une BD asiatique, qu’elle soit japonaise ou non. Un puriste parlera de Manhwa pour une BD coréenne mais le terme est peu usité.
La restauration Meiji a forcé le Japon a sortir de son isolement politique, culturel et commercial. La presse s’y est développée selon le modèle américain et les premiers comics strips y font leur apparition dès 1902. Les artistes locaux s’en inspirent et proposent leurs productions locales qui ont rapidement beaucoup de succès.
Signe de l’influence de ce nouveau média, le gouvernement militariste japonais n’oublie pas de mobiliser les auteurs lors de la Guerre. Cela, ainsi que la forte censure, n’empêche cependant pas des artistes de livrer des oeuvres à fort caractère pacifiste avant le déclenchement du conflit. Norakuro, de Suiho Tagawa, fait ainsi des siennes au sein de l’armée du Mikado avant 1941 et revient en force dès 1945. Ce personnage est toujours actif par ailleurs, car il sert aussi de mascotte à la Force de Défense japonaise, seul corps armé que le Japon est encore autorisé à posséder.

Norakuro est publié depuis les années 30. Il a connu la consécration d’une adaptation télé dans les années 80. La retraite, ce n’est pas pour lui !
La révolution intervient cependant dans les années 60. Ozamu Tezuka est le premier mangaka à briser les conventions théâtrales des productions locales, influencé par les comic-books américains qui déferlent sur le Japon.
Le pays, à ce moment là, n’ayant plus le droit de produire des oeuvres violentes, y compris en fiction, se concentre sur l’aventure, les explorations lointaines et la comédie. Tezuka en profite pour diffuser une oeuvre empreinte d’un grand humanisme. Le « Roi Léo » (qui sera un peu pompé par Disney pour « le roi lion », suffisamment en tout cas pour que les cabinets d’avocats en soient alertés) dénonce le néocolonialisme et le paternalisme occidental tout autant que la cupidité des explorateurs qui ne pensent pas aux conséquences de leurs découvertes sur les populations locales parfois complices. « Astro Boy » permet de rêver à un futur ou la technologie est au service de l’humanité malgré les dangers de l’ Atome, un thème récurrent au pays d’Hiroshima et de Nagasaki. Dans un autre genre, « L ’histoire des 3 Adolf » permet à l’auteur de critiquer la dictature militaro-impérialiste en dénonçant les privations des droits élémentaires des citoyens japonais, ainsi que la terreur politique et sociale qui en découlait.
Dès les années 60, le manga au Japon se répand d’autant plus rapidement que par tradition, le dessin était souvent utilisé pour expliquer et illustrer des notions et des exemples dans tous les domaines. Que ce soit en cuisine, en métallurgie, en mécanique, en physique ou en mathématiques, vous pouviez trouver un manga à ce sujet. Beaucoup à usage professionnel ou même scolaire, bien entendu. Pour le lecteur japonais, se voir proposer des murs entiers de périodiques diffusant des mangas allait donc de soi.
Le schéma économique employé au Japon est un genre de mélange entre les systèmes européens et américains. Les artistes sont en général propriétaires du personnage ou de la série, mais en cas de succès, un éditeur a le pouvoir de forcer le créateur à prolonger une série même si ce dernier estime que l’histoire est finie. Akira Toriyama n’a pas eu le choix et il a du prolonger « Dragon ball Z » bien au dela du raisonnable, selon les fans de la saga.
Pour tenir un délai de parution parfois hebdomadaire, un dessinateur travaille en studio, les assistants étant spécialisés selon le genre : un dessinateur mettra les décors en place, un autre les personnages secondaires ou les figurants, le dessinateur principal gardant les personnages principaux pour son propre pinceau. Inutile de préciser que les vacances sont rares... Mais la série qui a du succès en librairie peut connaître l’honneur d’une diffusion en albums de luxe, et même d’une exploitation télévisée ou cinématographique. Dans ce cas, c’est le jackpot !
En france, les premiers Manga grand public (hormis certains fanzines tirés à 100 exemplaires...) furent les adaptations télévisées de « Great UFO Mazinger » que l’on connait mieux sous son nom occidental de Goldorak. Candy, Cobra, Lady Oscar, Albator et d’autres n’ont pas tardé à suivre. Le premier contact avec les jeunes auquel ces programmes étaient destinés fut un succès tel que des intellectuels commencèrent à hurler à l’invasion culturelle et à dénoncer un danger largement imaginaire sur l’intellect d’enfants qui risquaient selon eux d’être plus traumatisés par un robot qui explose plutot que par un ogre Perraultesque qui égorge et mange des petites filles en toute liberté depuis le XVIIIè siècle...

De saines lectures pour des enfants sains !
La polémique se renforça lorsque le Club Dorothée passa des oeuvres plus dures et plus matures, pas forcément destinées à un jeune public. Si les « Chevaliers du Zodiaque » sont largement à la portée d’un enfant de 8 10 ans, il n’en va pas de même pour « Ken le survivant » !
Le manga fut en fait victime du syndrome « dessin animé = truc pour enfants » qui a longtemps régné dans les mentalités françaises. Le Japon avait muri plus rapidement sur ce point et considéré que l’animation était une technique cinématographique comme une autre, sans rapport avec l’ histoire qui illustrait son utilisation.
Une fois les réglages affinés, la polémique s’apaisa et Glénat misa sur les premières valeurs sûres pour ouvrir le marché du Manga papier en France. Son premier essai avec Akira avait été concluant même si des problèmes de santé ont forcé Katsuhiro Otomo à livrer le dernier volume avec plus d’un an de retard.
Le lancement de la version papier de « Dragon Ball » et de « Ranma 1/2 » ont définitivement fait sauter le dernier verrou et le manga, qu’il soit japonais, coréen, chinois ou même français représente aujourd ’hui 26 % du marché de toute la BD en France.
Nous verrons par la suite, sous forme d’exemples, une parfaite illustration de ce que la BD apporte à la société en terme d’image sur certains points. Alors, restez à l’écoute !
Et pour ceux qui ne peuvent attendre la mise en ligne de la suite, je ne peux que conseiller l’excellent ouvrage de Scott Mc Cloud, « l’art invisible ».
L’ouvrage est une BD, qui parle de la Bd. Son histoire, mais également et surtout sa technique et ses mystères.
Preuve de la supériorité du 9è art sur les autres, essayez-donc, après la lecture de cette BD, de me trouver un opéra traitant de l’opéra... Vous comprendrez à quel point cet art est plus profond qu’il en a l’air...
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









