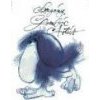Shutter Island, un film didactique brechtien ?
Il se pourrait que le dernier film de Martin Scorsese, Shutter Island, ne soit pas aussi dépourvu d’intérêt qu’il n’y paraît de prime abord. Une invitation, certes pessimiste, est faite à se positionner éthiquement.
 « Vaut-il mieux vivre en monstre ou mourir en homme de bien ? » C’est sur cette alternative que se conclut le film Shutter island adapté du roman de Dennis Lehane. L’intrigue, reconnaissons-le, n’est pas des plus fines. Le coup de théâtre est attendu : l’inspecteur Daniels qui vient enquêter sur une disparition dans un hôpital psychiatrique est en fait un patient qui hallucine son histoire. L’intérêt véritable de ce film réside ailleurs et il se pourrait qu’il y ait une leçon à tirer – qui tient presque d’un didactisme brechtien. Que choisirons-nous, car il faut choisir : vivre en monstre ou en homme de bien ?
« Vaut-il mieux vivre en monstre ou mourir en homme de bien ? » C’est sur cette alternative que se conclut le film Shutter island adapté du roman de Dennis Lehane. L’intrigue, reconnaissons-le, n’est pas des plus fines. Le coup de théâtre est attendu : l’inspecteur Daniels qui vient enquêter sur une disparition dans un hôpital psychiatrique est en fait un patient qui hallucine son histoire. L’intérêt véritable de ce film réside ailleurs et il se pourrait qu’il y ait une leçon à tirer – qui tient presque d’un didactisme brechtien. Que choisirons-nous, car il faut choisir : vivre en monstre ou en homme de bien ?Au fond, de quoi est-il question dans Shutter island ? Très logiquement, d’isolement : des patients enfermés dans un hôpital sur une île, des malades que les délires et les hallucinations rendent inaccessibles aux sains d’esprit. Mais également de trous et d’obturateurs que l’on se trouve pour les boucher – c’est bien le sens de « shutter ». Une vieille psychiatre trouvée au fond d’une grotte, des trous de mémoires, des énigmes… et le délire comme moyen de combler tout cela, de faire sens : la théorie du complot qui se décline en paranoïa à thèmes de persécution, de contrôle de la pensée, d’empoisonnement de la nourriture… On peut reconnaître vaguement le référentiel théorique qui sert de support à l’intrigue : un freudisme à l’américaine (coloré entre autres par les conceptions qu’Anna Freud développa dans son livre Le Moi et les mécanismes de défense). Le psychotique serait quelqu’un qui aurait des mécanismes de défense (délire, hallucination) moins élaborés, moins efficaces qu’un névrosé (sublimation, rationalisation…). Je crois reconnaître dans le bureau du psychiatre un portrait d’un analyste célèbre – n’est-ce pas Ferenczi ?
Il est un enjeu qui parcourt le film : deux tendances thérapeutiques se distinguent. Le psychiatre de l’île, le docteur Cowley, est partisan d’une utilisation minimale de psychotropes et d’une tentative de comprendre le délire du patient afin de l’aider à l’en sortir. A l’opposée : les tenants d’une psychiatrie plus invasive et de la lobotomie systématique. Si le docteur Cowley parvenait à guérir Daniels de son délire, à lui faire accepter qu’il n’est nullement un inspecteur chargé d’une enquête au sein de l’hôpital mais un patient souffrant, alors le recours à la lobotomie pourrait être évité à l’ensemble des patients. On apprend ainsi que cette histoire d’enquête s’est déjà répétée de nombreuses fois, et chaque fois, Daniels a refusé la vérité de sa condition de malade halluciné. Car s’avouer son délire, ce serait aussi avouer une insupportable vérité : il n’a pu sauver ses enfants de la folie meurtrière de sa femme qu’il a ensuite lui-même tuée ; cette terrible vérité qui le conduira à la folie.
Alors qu’enfin Daniels accepte pour la première fois sa condition de malade, il semble retourner à son délire d’enquête policière dans un second temps, comme s’il avait tout oublié. Et se tournant vers son thérapeute référent qu’il croit être son coéquipier, tandis qu’il se dirige sereinement vers sa lobotomie, il lui adresse ces mots : « vaut-il mieux vivre en monstre ou en homme de bien ? ». Ces propos sybillins attestent d’une chose : ce fou ne l’est pas tant que ça. Aussi délirant soit-il, il a pris bonne note de sa condition précaire. Il sait que son angoisse, il ne la tient à distance qu’au prix de ses défenses psychiques. Aussi, en un sens, est-il en bonne voie de guérison, lui qui feint presque à présent sa maladie. C’est donc que le docteur Cowley a su faire émerger du fond du délire de Daniels une conscience du pathologique. A dire vrai, pourtant, je ne suis pas sûr que le monstre soit vraiment où on le croit : si par « vivre en monstre », Daniels entend vivre en meurtrier de sa femme et de ses enfants, alors oui, sans doute vaut-il mieux marcher vers une lobotomie qui fera de lui un homme qui n’aura plus le sens de cette culpabilité intenable, un homme de bien, un inspecteur de police… C’est faire, au fond, le choix de la moindre souffrance en sacrifiant un morceau de cerveau et de conscience. Si au contraire on réalise que faire ce choix de « vivre en homme de bien », comme s’il était policier, c’est condamner du même coup tous les autres patients à une lobotomie certaine, sans que la méthode de Cowley ne puisse en aider aucun, alors il faudra bien se résoudre à ce que son choix est bien le choix du monstre égoïste qui sacrifie les autres pour s’assurer une bonne conscience virtuelle.
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON