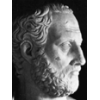Roland-Garros : la malédiction de l’attaquant
C’est devenu un lieu commun de le rappeler : depuis le quasi-hold-up de Yannick Noah en 1983, non seulement aucun Français, mais surtout aucun attaquant pur jus n’a réussi à s’imposer à Roland-Garros. Le terme de quasi-hold-up pourra choquer, tant cette victoire est devenue mythique en France, mais il reflète bien que le vainqueur fut cette année celui que personne n’attendait, non seulement par son inconstance (pas d’autre exploit majeur dans sa carrière, surtout pas à Wimbledon, pourtant censé correspondre davantage à son style de jeu), mais aussi par l’attaque à outrance pratiquée alors, servie il est vrai par un incroyable culot et une volonté de gagner exemplaire.

Mais le fait que, cette année-là, Noah attaqua sans relâche durant toute la quinzaine, s’emparant athlétiquement du filet dès que l’occasion s’en présentait, n’empêche pas de se poser la question sur ce qu’est réellement un attaquant. Les puristes tennistiques considèrent d’emblée que l’attaquant, c’est celui qui monte à la volée. Depuis l’avènement du « tennis-pourcentage », avec Björn Borg chez les hommes et Chris Evert chez les femmes, le jeu de volée n’a cessé de reculer, excepté sur les courts en gazon. Ces derniers sont eux-mêmes en perte de vitesse, à la fois par la difficulté de leur entretien, et notamment leur dégradation au cours d’un tournoi (un terrain pelé aux rebonds inconstants, en fin de quinzaine, n’a plus grand-chose en commun avec la belle pelouse du début) et le raccourcissement excessif des échanges. Ainsi, parmi les tournois dits « du grand chelem », seuls les internationaux de Grande-Bretagne se cramponnent à la tradition, ceux d’Australie (une nation de grands volleyeurs, pourtant) ayant depuis deux décennies (1988) préféré tourner la page au profit d’un quick similaire à celui de l’US Open.
Mais le jeu d’attaque, ce n’est pas seulement la volée. Comme on le disait déjà à l’époque de Borg, qui assénait ses lifts implacables avec une régularité de robot, une technique novatrice à l’époque, il existe des attaquants de fond de terrain, qui ne se contentent pas de remettre la balle en jeu, mais recherchent le point gagnant ou la faute provoquée sans prendre le risque de se faire transpercer au filet. Mais en cas d’opposition de deux joueurs de fond de terrain, lequel peut se prévaloir d’un jeu d’attaque par rapport à l’autre ? Il est toujours plus noble d’être considéré comme un attaquant, censé allier panache et technique, que comme un défenseur, dont l’opiniâtreté et la volonté sont assimilées à celle d’un charognard attendant la mort de sa proie. D’ailleurs, il y a quelques décennies, les « renvoyeurs de fond de terrain » étaient appelés des « crocodiles » (En fait, à l’origine, les joueurs de terre battue étaient ainsi désignés en référence à leurs chemises Lacoste, mais dans l’imaginaire des gens, l’étreinte inlassable de la mâchoire de l’animal à sang froid tendait à se substituer au chic de la marque légendaire).
Plus qu’un style de jeu, l’attaque, c’est donc avant tout la prise de risque. Et donc, du fond de court, la prise de risque, c’est la recherche du changement de rythme, du placement ou de la surprise, en exécutant un coup inattendu tel qu’une volée à contretemps ou une amortie (le risque étant alors qu’en général, pour que le coup ne puisse être anticipé, sa préparation n’est pas académique). D’une façon ou d’une autre, l’attaquant cherche à abréger l’échange, tandis que le défenseur recherche l’épuisement tant qu’il est surclassé en vitesse. Selon la surface ou, tout simplement, son adversaire, le style d’un joueur s’orientera vers une tactique ou l’autre. Dans la finale à laquelle nous avons assisté dimanche dernier, les rôles étaient clairement définis pendant au moins les deux premiers sets, à la suite desquels l’attaquant s’est petit à petit étiolé, laissant même son adversaire prendre en charge l’échange.
Il est impératif pour l’attaquant d’abréger la rencontre, non seulement lorsque l’endurance de son adversaire est intrinsèquement supérieure, comme c’était le cas avec Nadal, mais aussi et surtout parce que l’attaquant dispose d’un nombre limité de munitions. Toute importante prise de risque nécessite un ponctuel mais considérable surplus d’innovation, d’influx nerveux et d’adrénaline, pendant que son adversaire reste concentré sur un but unique : l’attente. Le jeu de volée, en particulier, qui nécessite des changements de rythme très violents, devient difficilement tenable en fin de match marathon : la vitesse moyenne des deux joueurs baisse nettement par rapport au début de la partie, mais la vitesse de pointe passe en dessous d’une limite à partir de laquelle les chances de succès de l’attaquant tombent nettement en dessous du seuil de rentabilité. A cause de cet effet de seuil, la « filière courte » devient inopérante, tandis que, même ralentie, la « filière longue » fonctionne encore.
Les exemples de cet effritement sont légion au cours des finales de Roland-Garros. La plus représentative en est peut-être la première victoire de Mats Wilander, en 1982. Durant un peu moins de deux sets, Vilas, conquérant mais gaspillant toute son énergie, lamina son adversaire en attaque de fond de terrain. La perte malgré tout du deuxième set l’obligea à accepter un jeu d’usure, dans lequel son jeune adversaire s’avéra le plus endurant. L’année suivante, Noah surprenait tout son monde en pratiquant le service-volée durant toute la quinzaine, prenant bien soin de gagner autant que possible tous ses matches en trois manches, et notamment la finale, qui ne se conclut que difficilement au 3e set, dont la perte eût pu embarquer Noah dans un marathon dont il ne se serait pas remis. Une leçon que ne médita pas suffisamment McEnroe l’année suivante, qui, face à Lendl, laissa échapper le 3e set de peu mais n’eut plus jamais par la suite les ressources nécessaires pour imposer le tennis flamboyant qu’il pratiquait alors, à son apogée. Plus tard encore, ce fut Edberg qui plia face à Chang dans les mêmes circonstances, sans parler de la défaite en finale de Leconte face à Wilander.
A partir de ces deux derniers joueurs, il n’y eut plus de réel volleyeur en finale à Roland-Garros. Le rôle de l’attaquant étant toujours tenu par le plus fougueux des deux. Ainsi d’une finale Agassi-Courier, tous deux d’excellents cogneurs, mais remportée par le second, pourtant moins talentueux mais plus solide à ce moment. Constat inverse lorsque le même Courier s’usa les dents sur Bruguera, qui faisait retrouver à l’Espagne son statut d’experte ès-crocodiles, perdue depuis la lointaine époque d’Orantès et Higueras. Même dans les confrontations hispano-hispaniques, telles qu’avec le surprenant Berrasateguy face au même Bruguera, la terre battue de Roland-Garros a toujours préféré la patience à la fougue.
Bien sûr, les « défenseurs » d’aujourd’hui n’ont
plus rien à voir avec les crocodiles d’antan, et même les Hispaniques et autres Latino-Américains sont, tel Carlos Moya, vainqueur en 1998, tous de redoutables
cogneurs de fond de court. Mais même si le distinguo entre attaquants et
défenseurs s’est clairement rétréci, la balance penchera toujours en faveur de
celui qui saura le mieux gérer son usure tout en prenant des risques aux
moments opportuns. Roger Federer semble avoir bien pris la mesure des
difficultés techniques particulières que lui pose le coup droit ultra-lifté de
gaucher de Nadal, mais au vu de la similitude de ses trois défaites à
Roland-Garros, il ne semble pas encore avoir appris à ne dépenser son influx
qu’à bon escient (une seule balle de break remportée sur 17 dimanche dernier).
Il lui faudra pourtant en passer par là pour remporter ce seul tournoi du
grand chelem qui manque à son palmarès, mais qui reste à sa portée vu l’immense
étendue de son talent. Qui sait, l’inspiration lui viendra peut-être de celui
qui lui remettait le trophée du finaliste dimanche : Gustavo Kuerten, qui,
malgré un physique bien éloigné de celui d’un bûcheron de fond de terrain, sut
à trois reprises utiliser son toucher pour trouver le subtil dosage d’attente,
de placement, de travail d’usure et d’accélérations que nécessite le tennis de
terre battue.
10 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 , je préfére le foot ,mais la similitude est que je préfère nettement le jeu d’attaque à l’anglaise que le jeu défensif qui nous donne des France -Suisse chiants à mourrir .alors , au tennis ,j’aime naturellement voir de la prise de risque
, je préfére le foot ,mais la similitude est que je préfère nettement le jeu d’attaque à l’anglaise que le jeu défensif qui nous donne des France -Suisse chiants à mourrir .alors , au tennis ,j’aime naturellement voir de la prise de risque