Espionnage : Chine championne olympique
Dans le cadre des RDV de l’Agora, nous vous présentons ci-dessous le dernier ouvrage du journaliste Roger Faligot, « Les Services Secrets chinois, de Mao aux JO », une somme dans laquelle l’auteur a rencontré de nombreux spécialistes, experts du renseignement, diplomates, hommes politiques, principalement en Chine.
S’appuyant sur des services secrets actifs dans tous les domaines, la Chine conjugue l’art ancestral de l’espionnage, le tout répressif de la sécurité d’État et les nouvelles technologies. Avec ce livre, Roger Faligot n’a pas fait seulement œuvre de journaliste d’investigation, il nous emmène dans une aventure digne des plus grands livres d’espionnage.
L’auteur est en ligne, aujourd’hui mercredi 18 juin, pour réagir à vos commentaires
.
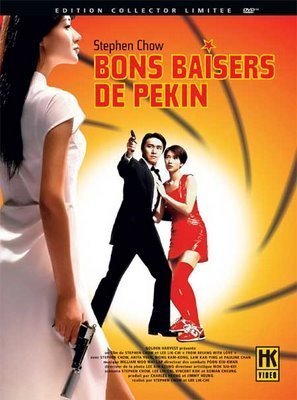
S’il n’y avait pas eu de soulèvement ni d’émeutes au Tibet en mars dernier, parlerions-nous des services secrets chinois ? Probablement pas. Pourtant, il ne faut évidemment pas se leurrer, ceux-ci existent et nous surveillent bel et bien.
C’est vital pour l’Empire du Milieu qui se rêve en superpuissance mondiale. Ne rien voir, ne rien dire, mais tout entendre. La Chine n’a pas attendu d’organiser le show sportif le plus populaire au monde pour ouvrir tout grand ses oreilles. D’après Roger Faligot, c’est en 1921, c’est-à-dire au moment de la bataille de Shanghai que commence cette histoire.
Roger Faligot, journaliste d’investigation, est l’auteur de 33 ouvrages documentaires sur l’histoire contemporaine (et particulièrement sur l’espionnage). Il vient de publier Les Services Secrets chinois, ouvrage dans lequel il explique la stratégie chinoise en matière de renseignement, des origines jusqu’à aujourd’hui, c’est-à-dire jusqu’à l’avènement des hackers, en passant bien sûr par le soulèvement de Tiananmen, il y a presque vingt ans, où nous gardons tous en tête cette image symbolique d’un homme seul contre un char, d’un citoyen face à l’appareil policier d’un des Etats les plus répressifs au monde.
De nos jours, les émeutes tibétaines ont déclenché un immense mouvement de solidarité mondiale, perturbant, à chacune de ses escales sur le globe (à l’exception de la Corée du Nord), le passage de la flamme olympique.
Dès le départ de cette flamme en Grèce, l’association Reporter sans frontière, par la voix de Robert Ménard, avait lancé le débat sur le boycott ou non des JO de Pékin.
Plus de soixante ans après les JO de Berlin, quarante ans après le poing levé de Tommie Smith et de John Carlos aux JO de Mexico, trente-six ans après les Jeux de Munich, plus personne ne peut affirmer que les JO ne sont pas aussi un enjeu politique.
Alors, faut-il ou non boycotter les JO de Pékin ? Si vous répondez oui, sachez que le gouvernement chinois a débloqué 1,3 milliard de dollars pour les anti-JO, mais également les athlètes et tous ceux qui graviteront autour, comme les journalistes par exemple. Souriez, vous êtes filmés !
« Nous voulons des renseignements ». Ainsi commence Les Services Secrets chinois de Roger Faligot dont nous vous proposons un extrait ci-dessous. Et les renseignements, les services secrets chinois ne se contentent pas de les vouloir, ils les obtiennent !
Extrait des Services Secrets chinois, de Mao aux JO, par Roger Faligot
Ce qu’il me dit, je l’ai déjà entendu, mais dans la bouche d’experts occidentaux. « Nos services travaillent par cercles concentriques. Et le rapport australien que vous me citez est proche de la réalité : la France est l’un des pays où il est le plus facile de gagner des “amis pour la Chine”, ce que vous appelez agents d’influence, sources, “honorables correspondants”. Mais pour nous, comprenez bien, ce n’est pas de l’espionnage… »
Y a-t-il une grande différence avec ceux que le KGB appelait du temps de la guerre froide les « idiots utiles », compagnons de route, sympathisants, agents d’influence recrutés souvent par naïveté ? La différence, si elle existe, réside dans le manpower considérable dans le cas des Chinois…
« Nous pouvons jouer sur bien des cordes sensibles. Et toutes sonnent agréablement à des oreilles françaises… » M. Li détaille l’éventail des champs d’opérations sur lequel ses services ont agi depuis les années 1970. L’affaire Boursicot-Shi Peipu était à la fois extraordinaire par son cadre, ses personnages, son évolution, par la confusion des sentiments et cependant terriblement banale.
L’appel du sexe, les « nuits câlines », l’érotisme chinois sont évidemment des ressorts habituels du recrutement. Et si les Français y sont plus sensibles que d’autres, ils ne sont pas les seuls. Le « stratagème de la belle » – de sexe opposé ou pas – reste très efficace en direction notamment des hommes d’affaires et autres VRP de toutes nations.
Pour les Français, les Chinois ajoutent qu’ils trouvent un terrain d’entente dans la convivialité autour de la bonne chère et de la boisson, aussi attirantes, et parfois indissociables, de l’érotisme à la chinoise. »
2e extrait
« En 1995, lorsque internet a vraiment pris son envol au Japon et dans le monde sino-coréen, il y a seulement quelques milliers d’universitaires qui veulent maintenir des liens avec des collègues étrangers. Ils doivent se faire enregistrer auprès du ministère des Postes et Télécommunications qui gère le lien China-Pack avec la toile mondiale.
À cette époque, le contrôle initial est dévolu au Bureau d’information du Conseil des affaires d’État, dirigé par Zeng Jianhui, un spécialiste de la propagande et notamment éditeur du secteur international de l’agence de presse Chine nouvelle (Xinhua). Après avoir étudié de près les techniques de contrôle d’internet à Singapour, il cède sa place en 1996 à l’ancien ambassadeur en Grande-Bretagne et vice-ministre de l’Information, Ma Yuzhen.
Dix ans plus tard, on est parvenu à un système très élaboré de surveillance. C’est ainsi que le Bureau d’information publique du Bureau de la Sécurité publique (Gonganju) de Lhassa a mis au point un système de contrôle visant tous les internautes. Ce n’est sans doute pas un hasard si le Tibet sert de laboratoire pour la surveillance informatique, en attendant de généraliser ces méthodes à d’autres régions de la Chine.
Au début de 2004, les habitants chinois et tibétains de Lhassa qui veulent avoir accès à internet, dans un cybercafé, reçoivent un numéro d’enregistrement associé à un mot de passe, qu’il s’agisse d’aller surfer sur des sites ou d’échanger des courriels. L’internaute peut alors acheter une « carte de navigation » peu coûteuse, mais à condition de remplir une « fiche d’identification citoyenne » (shenfen zheng).
Ces cartes sont distribuées par le Bureau d’information publique (BIP) du Gonganju, le Bureau régional de la Sécurité publique à Lhassa que dirige « Luobu Donzhu » (de son vrai nom tibétain Norbu Dondrub). Le BIP est également responsable des licences des cybercafés.
« Lutter contre le crime qui se commet sur internet », tel est l’objectif de ces services techniques, mais, à l’évidence, l’agence jumelle, le Bureau de Lhassa de la Sûreté de l’État (Guoanbu), chargée d’opérations de contre-espionnage offensif sur l’Inde, espère aussi effectuer un monitoring sur d’éventuels courriels codés qui pourraient s’échanger entre le « Centre de recherche et d’analyse » (RAC) du Dalaï-Lama à Dharamsala et les réseaux de la résistance tibétaine.
Ce système de surveillance semble très efficace puisqu’il impose un enregistrement de l’individu et non plus du système de l’ordinateur employé. Si la répression s’agence intra-muros, à l’intérieur de la Muraille de Chine virtuelle, elle ne rechigne pas à utiliser l’aide complaisante de systèmes extérieurs prêts à pactiser avec le Parti communiste chinois, du moment qu’ils peuvent s’implanter dans l’eldorado chinois sur le plan commercial.
Des cyberdissidents ont été emprisonnés, qui plus est avec l’aide de complices étrangers à l’appareil d’État chinois, tel le moteur de recherche Yahoo, mis en cause dans leur arrestation pour avoir fourni au Gonganbu leur adresse e-mail et IP. Les cas les plus célèbres à ce jour sont Wang Xiaoning, condamné en septembre2003 à dix ans de prison – et deux de privation de ses droits civiques – pour « incitation à la subversion du pouvoir de l’État » car il était l’auteur de « journaux en ligne » diffusés par courriel, prônant l’ouverture démocratique de la Chine.
De même, Shi Tao, rédacteur en chef d’un journal économique dans le sud de la Chine, condamné en avril 2005 à dix ans de prison. Motif ? Il aurait diffusé des secrets d’État en postant sur la toile une consigne du gouvernement chinois aux médias leur interdisant de célébrer l’anniversaire de la répression du mouvement prodémocratique sur la place Tiananmen. En 2007, l’association Reporters sans frontières comptabilise plus d’une cinquantaine de reporters internautes embastillés dans le Laogai, le goulag chinois. »
© Nouveau monde éditions
L’auteur est en ligne, aujourd’hui mercredi 18 juin, pour réagir à vos commentaires.
Crédit image : AsieVision
26 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









