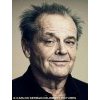Ah, la folie suite 2
(Histoires vécues d’un infirmier suite)
Le mystère qui entoure la « maison de fous » ou comme la plupart des gens l’appelait l’asile psychiatrique, garde toujours ses secrets, ses tabous ; sauf pour ceux et celles qui y ont travaillé, et qui ont contribué à soulager les malades.
Voici donc la suite
L’histoire qui suit se déroule lorsque j’étais en 1ère année de formation (1979).
La formation des infirmières psy consistait à passer une semaine à l’école de l’hôpital, puis trois semaines au travail, dans les pavillons, aux côtés de nos anciens qui nous enseignait la pratique des soins « sur le tas ».
Monsieur S, professeur de mathématiques dans un lycée, était hospitalisé depuis plusieurs années. Il était diagnostiqué comme psychotique ; il était totalement mutique, personne parmi le personnel soignant n’avait jamais perçu le son de sa voix. Très discret, voire même absent, il se tenait toujours à l’écart des autres, patients et soignants compris. Cet homme qui eut pu être mon père, souffrait en silence ; quand il était couché sur son lit pendant la sieste, les bras le long de son corps, cela me faisait penser à la position d’un cadavre à la morgue !
Cet homme était très intelligent et aussi très sensible, d’après mes observations. Sachant qu’il jouait au jeu d’échec, moi pas ; après plusieurs sollicitations, il accepta d’être mon professeur d’échec. Le courant est alors passé entre nous et à l’insu de tous, nous nous retrouvions devant un échiquier à l’abri des autres.
C’est à l’occasion de ces parties ponctuées par cet humour que je distillais avec parcimonie au début, ensuite avec une dose de provocation dans mon langage tout en prenant des défaites bien méritées lors de ces joutes cérébrales. Monsieur S était très fort à ce jeu, et il était très sensible à l’humour, et aussi à l’autodérision dont j’usais sans compter. Lors d’une partie plutôt acharnée, à un moment très important, son fou prend ma reine et ma réaction provocatrice fût celle-ci : Cette conne de reine, elle s’est encore faite niquée par ton fou, qui n’est pas si fou que ça, etc… Voilà le type de propos dont j’usais souvent pour lui soutirer un sourire, puis ensuite des éclats de rire.
Enfin il me parlait ; un jour Sylviane, infirmière cadre, en clair ma chef directe, qui passait par là a entendu une voix qu’elle ne connaissait pas. Surprise, elle me demanda qui avait parlé, je lui répondis que c’était Mr S ; stupéfaite, elle n’en croyait pas ses oreilles.
Un peu plus tard, convoqué dans son bureau, je lui affirmait qu’il s’agissait de la voix de Mr S. Elle me suggéra de lui proposer des sorties en dehors de l’hôpital (piscine, cinéma, etc…) ; faite d’argent, de personne, le cadre supérieur à refusé de cautionner ce projet pour Mr S !
Quelques mois plus tard, Mr S sort de l’hôpital sans suivi ambulatoire, il était livré à lui-même. Quelques mois plus tard Mr S mit fin à ses jours en consomment des amanites phalloïdes, ce en une semaine !
Mon gentil professeur d’échec qui m’avait tant donné n’était plus là ; mais il m’avait fait le plus beau cadeau que l’on ne m’ait jamais fait, et depuis je pense toujours à lui lorsque j’utilise les échecs dans des activités thérapeutiques pour aides des malades à sortir de leur souffrance morale.
Par la suite, utilisant ce médiateur (les échecs), il m’a été facile d’entrer en contact avec des malades qui prenaient du plaisir lors de ces rencontres fraternelles lors desquelles les liens thérapeutiques se renforçaient, avec au final le respect mutuel et nous amenait à des rapports privilégiés et surtout très fructueux pour nous tous. Après chaque partie, quelle que soit le gagnant, ou le perdant, nous nous serrions la mains, satisfaits d’avoir pris du plaisir à travers ce jeu.
Pour la suite, les patients sortaient un peu de leur bulle et le travail thérapeutique était plus facile car nous pouvions nous parler sans crainte.
Mes trois partenaires de jeu n’ont jamais raté une seule séance de cette activité, car cela se terminait toujours dans la bonne humeur. La revalorisation de l’autre et surtout l’humour dont je n’étais pas avare et la décision que j’utilisais sans compter, les patients se la transmettaient entre eux.
A ce moment là, la partie était gagnée !
Nous étions à égalité, il n’y avait plus de soignant dominant et de soignés dominés, le but était atteint ; les problèmes qui causaient leur souffrance morale se trouvaient dilués.
Ils savaient que j’étais leur allié et pouvaient compter sur moi ; le lien était fait, la confiance s’était installée entre nous et ils ne se sentaient plus isolés.
Lors d’une partie très disputée, Mr de S ayant très bien joué perdit la partie de justesse, qu’elle ne fût pas sa réaction ! Il tapa du poing sur la table et fit semblant de pleurer ; il jouait un rôle, tout comme un acteur, rentrant dans son jeu, je lui lance un torchon qui traînait dans la pièce, il s’en saisit et continue son psychodrame. En fait il était mort de rire, ce qui provoqua chez les autres patients un « fou » rire général. Mr de S était très satisfait de l’effet qu’il a provoqué sur nous tous, et nous avons rigolé de bon cœur après cette farce. Cette pratique du jeu que ce soit avec le support des échecs ou de toute autre activité thérapeutique, la décision représente pour moi un véritable outil de communication avec ceux qui sont retranché dans leur monde.
Appliquant cette technique de soin, il m’a été possible de sortir un patient enfermé en chambre d’isolement, puis qu’il retrouver une vie presque normale à l’extérieur de l’hôpital.
Voici maintenant l’histoire d’Ahmed. M, jeune ingénieur, très intelligent que j’allais voir plusieurs fois par jour, seul alors qu’il eut fallu que je sois accompagné par deux collègues.
Lors de ces visites, Ahmed m’a posé une question très précise : « Explique moi la signification d’un syllogisme ? »
Ceci était une sorte de test, il voulait savoir à qui il avait à faire, ce qui est légitime.
La démonstration de syllogisme de Socrate fût la réponse qui le rassurât. Ensuite le respect s’instaurât entre nous ; j’avais réussi à passer le test qu’il m’avait imposé.
La démonstration du syllogisme de Socrate fût la réponse qu’il attendait de moi. Dés lors le courant positif passait entre nous, et nous nous sommes retrouvés devant un échiquier, hors de cette pièce contondante, dans le bureau infirmier ; et sans avoir l’accord de ma hiérarchie.
Les risques que je pris m’étaient imputables, et tout s’est bien passé.
Après chaque partie, il acceptait volontiers de retourner dans cette chambre fermée sans problème, ceci était convenu entre nous.
Au fur et à mesure, il prenait de plus en plus de plaisir à nos rencontres extra-isolement, et cela à conduit les psychiatres à lui accorder un élargissement de ses conditions d’hospitalisation difficile à supporteur pour Ahmed et pour moi aussi.
Lorsqu’il s’est retrouvé dans une chambre classique, comme les autres patients, malgré cette peur de l’autre qui l’habitait en permanence, il avait toujours besoin de se rassurer au travers de l’activité échec.
Dés lors ces rencontres nous ont permis d’aller plus loin dans cette relation de confiance ; petit à petit le jeu d’échec devint pour lui un défouloir.
La provocation, l’humour et la dérision portait ses fruits, et la plupart du temps, Ahmed et moi étions totalement hilares.
Par la suite, le support de communication de ce jeu d’échec n’était désormais plus nécessaire, nous passions à une autre étape ; Ahmed pouvait me parler de tout, à quelque moment que ce soit, et sa paranoïa n’était plus du tout prédominante. Il retrouvait un peu la confiance en lui qui l’avait abandonné et il fallait l’encourager dans ce sens. Bien sûr, il n’était pas guéri, cependant il avait compris qu’il pouvait utiliser ses qualités et de ce fait, il était moins submergé par sa paranoïa et savait qu’il était capable d’utiliser, de se servir de cette personnalité paranoïaque à son profit.
Quelle satisfaction cela ma donné de constater qu’il lui était désormais possible de se contrôler, car il avait repris confiance en lui.
A travers toutes ces parties de ce jeu magique, je garde le souvenir du plaisir que cela a donné à tous.
Nous avions des fou-rires, d’ailleurs il arrivait souvent que les patients les provoquent ! Le rire semble être une véritable thérapie.
Il est important pour moi de parler d’une activité qui a pris une grande partie de mon temps de travail. Ce sont les interventions d’urgence intra ou extra-hospitalières, dans d’autres pavillons, à la prison, aux urgences du CHU, etc…
Les situations difficiles étaient hyper stressantes pour tous les protagonistes.
En cas d’intervention à l’extérieur de notre pavillon, nous savions que pendant 1 ou 2 heures, nos collègues infirmières, aides-soignantes et « techniciennes de surfaces » resteront faire mon boulot, sous-effectif et en danger ! Un dimanche après-midi, il m’est arrivé de me passer que 2 heures dans mon pavillon à cause de multiples appels en renfort dans les autres services de hospitalité ! Le tout sans avoir le temps de manger…
Retour en arrière, dans les années 80, il y a eut un passage entre la psychiatrie asilaire et l’inverse, l’anti-psychiatrie. Les infirmiers qui avaient été formés par ceux de l’asile ont ensuite été des infirmiers formateurs pour ceux de ma génération. Ils ont partagé leur expérience professionnelle avec nous ; comment nous protéger dans des situations dangereuse ; eux savait se comporter devant des agressions, ou des bagarres entre 2 ou plusieurs patients. Après avoir tant appris à leur côté, je les remercie très sincèrement ; beaucoup sont partis au fur et à mesure, et n’ont pas été remplacés (retraite, cancer, etc…)
Notre génération d’infirmiers s’est retrouvée sans aînés protecteurs et il a donc fallu inventer une nouvelle technique de soins. A force d’expériences le dialogue et la communication orale permettent d’apaiser de fortes tensions par l’angoisse qui monte ce que pousse les patients vers des réactions souvent violentes, simplement parce qu’ils ont peur et ne savent pas de quoi ils ont peur ?!
Tous mes collègues portaient la blouse blanche, moi pas et cela ne m’a pas empêché d’apparaître tel que je suis, pas besoin d’emballage blanc. Pour les patients, il me semble que le contact passait mieux, étant considéré comme bienveillant à leur égard, avec qui le dialogue est possible et la confiance peut s’instaurer ; privilégier ce type de relation avec les malades m’a paru efficace.
Par exemple, cet appel urgent pour aller chercher quelqu’un au CHU après qu’il ait fait un malaise sur la voie publique, suivit d’une agitation lors de son réveil, nécessitant l’intervention des policiers (6 en tout). A notre arrivée au CHU, nous étions deux infirmiers , un aide-soignant et l’ambulancier et un policier était présent à côté du patient qui avait été attaché sur un brancard, baignant dans son urine… ! Dans ce type de situations particulièrement délicates, le premier contact est décisif, à la fois avec le patient et aussi avec les policiers qui l’ont appréhendé. Le jeune homme qu’il fallait prendre en charge faisait au moins 100 kilos et environ 1.90 m de taille, ses épaules dépassaient du brancard ; ça fait réfléchir !
Le fait de le libérer de ses entraves pour le changer de brancard et de lui distiller des paroles rassurantes, m’ont permis de me présenter comme quelqu’un qui était là pour l’aider. Insistant sur les causes de sa présence aux urgences, c'est-à-dire du malaise qui entraîna la mobilisation des forces de l’ordre, il fût plus facile de faire une sorte décalage pour retenir son attention. En lui faisant part de mon inquiétude pour sa santé, il répondait aux questions que je lui posais, parlant de lui, sa vie etc…
Pendant le transfert vers l’HP, nous avons eut le temps de parler, le plus important étant l’écoute, et tenter de trouver des réponses adaptés, pas facile ! Dans ce genre de situation, il faut rester calme afin de trouver des réponses adaptées à ses justes interrogations. Lui expliquant qu’il était impératif de passer des examens spécifiques pour trouver la source de son mal, et que l’hôpital où nous le conduisions était le plus habilité à lui donner ces réponses.
Ensuite, après une douche, une mise en pyjama, de manger et surtout d’accepter la chambre d’isolement parce que la confiance s’était installé il n’a pas posé de problèmes pour prendre les médicaments juste prescrit par le psychiatre de garde.
Au lieu de finir mon travail à 21h30, j’ai quitté l’unité d’accueil de l’hôpital pour rejoindre l’unité de soins de mon service vers 22h30.
Pendant une période de travail de nuit, il me fallut intervenir dans un autre pavillon suite à un appel au secours de deux infirmières. Un patient étant dans une chambre d’isolement menaçait de se suicider et avait refusé son traitement médicamenteux. Situation très anxiogène pour ces deux infirmières, il y avait URGENCE.
A l’arrivée dans ce pavillon, après un bref entretient avec les infirmières qui connaissaient bien le malade, nous avons organisé l’intervention. Les deux infirmières étaient chargées de lui apporter le repas pour l’une et les médicaments pour l’autre ; par ma part j’adaptais une attitude désinvolte du genre « même pas mal ».
Après avoir mangé, nous avons fumé à la fenêtre puis il a pris son traitement médicamenteux, le lien était créé ; après mon intervention positive, je lui donnais rendez-vous le lendemain matin à 6 heures du matin pour le petit déjeuner et les médicaments et bien sûr quelques cigarettes.
Cette deuxième rencontre, qu’il n’imaginait pas probable, se révéla riche en émotions, nous avions échangé quelque chose de l’ordre de l’humain, il avait presque oublié ses idées noires. Lorsque je suis retourné dans mon service, j’ai éprouvé une grande satisfaction personnelle, voilà pourquoi j’aime ce métier.
Toujours dans le même registre, intervention dans un autre service de l’hôpital, mais dans le cas qui va suivre lorsque nous sommes arrivés sur place, mon collègue Jacky et moi constatons qu’un infirmier était déjà présents depuis ½ heure face à un patient récalcitrant que nous ne connaissions pas. ½ heure de palabres qui n’ont servir à rien, ils ont montré au patient qu’ils avaient peur d’intervenir physiquement, cela eut la conséquence d’augmenter l’angoisse du patient et donc une agressivité latente contre nous tous et surtout contre lui-même et se mettait en danger.
Mon collègue très expérimenté devant ce type de situation très délicate m’a lancé un regard furtif et de concert, sans plus attendre nous sommes intervenus pour maîtriser le patient sans violence aucunes.
Après quelques paroles rassurantes pour l’apaiser et ce devant ces cinq collègues sidérés, impuissants, interdits. Après son installation dans la chambre d’isolement, nous sommes restés longuement à ses côtés pour l’écouter, le rassurer. Il a alors compris que nous étions là, pour le protéger contre lui-même, puis il a pleuré dans nos bras, comme un enfant malheureux.
Avant de regagner notre pavillon, au moment de lui dire « bon courage… » et de refermer la porte de la chambre à clef, il nous a chaleureusement remercié de notre sollicitude à son égard !
Ne pas communiquer sa propre angoisse, c’est difficile, mais cela s’apprend avec l’expérience ; il suffit juste de se connaître soi-même et d’accepter de changer certaines petites choses pour y arriver, non changer de personnalité mais plutôt évoluer, se bonifier avec le temps, comme le bon vin.
D’autre part, nous apprenons tous les jours et pendant toute la vie ; ceux qui considèrent tout connaître, tout savoir parce qu’ils ont un diplôme en poche sont des imbéciles. A l’heure où j’écris, 55 ans au compteur, « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien » disait Socrate. Ceux qui ont la certitude de m’avoir plus rien à apprendre se trompent et en subiront les conséquences, je compatis d’avance à leur douleur future.
Après vingt années à travailler de nuit, la cadre supérieure du service me propose de travailler à Duclair dans un « hôpital de jour » ; très réticent au début, mais n’ayant pas le choix, j’accepte. Ce fût une nouvelle expérience qui s’est avéré très enrichissante.
A cette époque, pendant les années 90, ce type de structures extra-hospitalières permettaient d’éviter des hospitalisations très coûteuses, mais surtout de prodiguer des soins tant psychiatriques que psychologiques à proximité des patients.
C’était un outil formidable qui permettait d’imaginer le soin d’une toute autre façon ; une sorte de liberté d’imaginer et de réaliser des actes infirmiers thérapeutiques comme adapter les ateliers à chaque patient en fonction de ses envies ; tous les six mois, il pouvait arriver que nous changions les activités psycho-thérapeutiques en fonction d’une ou plusieurs patients. Malheureusement l’effectif soignant est passé de quatre infirmières à deux ! Et cela veut dire deux fois plus de travail pour ceux qui restent.
Cela ressemblait au début d’une fin annoncée des hôpitaux de jour et de proximité pour les malades, quel dommage !
Malgré tout ce tracas administratifs, ce fût un réel bonheur d’y avoir travaillé pour être utile à sauver des vies.
Quelle expérience humaine, on en prend plein la tête ; il arrive parfois dans ce métier de faire des rencontres fascinantes, que l’on reçoit comme autant de cadeaux. Pendant les trois années passées à Duclair, beaucoup de rencontres m’ont enrichir, comme avec Gilles, que l’on appelait, à sa demande Gilou, de même qu’avec Catherine, Cathy pour les intimes.
Cathy m’a accueilli chaleureusement, nous nous étions rencontrés lors d’une hospitalisation quelques années plus tôt. Elle était rejetée par les soignantes et celle le ressentait, ce qui est très dur à supporter ; pour ma part, je suis toujours été avec elle pour écouter, encourager, aider et aussi répondre à ses angoisses.
Une histoire d’amour est née entre Cathy et Gilles à l’hôpital de jour de Duclair ; aujourd’hui ils vivent ensemble, ils se font du bien et veillent l’un sur l’autre. Quel plaisir ce fut pour moi ; merci à vous deux. Encore une expérience qui nous permet d’apprendre, ce qui nous encourage à continuer dans ce sens, la vie à tout prix.
A tout seigneur tout honneur, commençons par Gilles. D, jeune homme brillant : deux années de FAC de psycho, un diplôme de maître nageur sauveteur, éducateur auprès de jeunes activité à Paris, artiste peintre.
En résumé, c’est quelqu’un de très intelligent, très cultivé, toujours à l’écoute des autres, le cœur sur la main. Avant que l’on ne débarque à Duclair, mon épouse y avait travaillé en tant qu’infirmière psy ; elle me parlait souvent de Gilles car elle avait besoin de partager la souffrance de me pouvoir répondre c'est une autre souffrance, celle de Gilles.
Lors des entretiens infirmiers qui duraient environ une heure, il observait un mutisme total, il communiquait par la gestuelle, le mine et par écrits qui étaient abondants mais confus.
Gilles avait besoin de savoir à qui il avait affaire, il me testait en permanence, ce que j’acceptais volontiers, car ce jeu me permettait d’être, avec le temps, invité dans son monde, dans sa bulle protectrice ,un peu plustard utilisant ce formidable médiateur qu’est l’humour et dont il était friand, nous sommes arrivés à nous faire confiance et enfin pouvoir se parler ; le déclic, le catalyseur était déclenché pour la communication verbale. Lui suggérant plusieurs activités dans le cadre d’une prise en charge psycho-thérapeutique, une fois par semaine nous allions à la piscine avec d’autres patients, nous faisions des parties d’échec, toujours à plusieurs, ce pour l’encourager à ouvrir encore un peu plus la petite fenêtre qui donne accès à sa bulle dans laquelle il était enfermé.
Après tous ces tests et cette ouverture sur le monde extérieur, il m’était permis d’aborder les sujets délicats comme la sexualité, il m’a tout raconté, ce qui lui fit le plus grand bien.
Pouvoir se confier à quelqu’un a permis à Gilles de retrouver sa confiance en lui, pour la première fois le monde s’ouvrait à lui, par la suite il s’est autorisé à n’en faire qu’à sa tête, enfin libre ; à cette époque, Gilles et Cathy se sont rencontrés et aimés.
Quel bonheur pour le soignant que je suis de voir maître une si belle histoire d’amour ; encore merci à vous deux.
L’histoire de Cathy a commencé par des hospitalisations à répétition, dont une m’a permit un premier contact soignant avec elle. Son comportement, ses demandes multiplie, ou plutôt son besoin d’être rassurée en permanence, l’ont amenée à se faire rejeter par la majorité du personne soignant.
Pour ma part, ce n’était pas le cas, je passait beaucoup de temps pour elle, travaillant de nuit, c’était plus facile. Les nuits paraissent très longues quand on n’arrive pas à trouver le sommeil, réveillée en pleine nuit par des cauchemars générés par ses angoisses. Ces moments de détresse qu’elle supportait très mal étaient canalisables ; étant toujours disponible pour elle, nous passions de longs moments à parler de ses angoisses, de sa solitude, de ses problèmes familiaux avec ses sœurs, etc…
Lors d’une sortie « définitive » de l’hôpital, elle fut prise en charge par l’équipe de médecins psychiatres, psychologues, infirmières de l’hôpital de jour de cette charmante petite ville de Duclair.
Cet hôpital de jour fur le premier à ouvrir ses portes en 1976, l’administration n’était pas au courant et fut mise devant le fait accompli, à cette époque, c’était un acte révolutionnaire ! a Duclair, il était possible d’avoir du temps et la liberté d’initiatives, créer des activités soignantes adaptées à des groupes restreints de patients motivés ou bien seulement intéressés parce qu’on leur proposait.
Parfois, parce que de nouveaux patients nous étaient proposés par le médecin psychiatre, l’activité proposée n’était pas adaptée et nous en changions souvent en fonction des désirs exprimés par les patients. Il arrivait souvent qu’ils m’aident à la création d’une autre activité en groupe, ce qui les impliquait et les motivait pour venir à l’hôpital de jour ; ne serait ce pas ce que l’on appelle la dynamique de groupe, grâce à cette technique de soin, les échanges entre soignés et soignants étaient riches et variés, la liberté de parole était de mise pour tous, l’objectif c’était de faire communiquer les malades entre eux.
La richesse des échanges entre patients créait une complicité entre eux, ce qui les rehaussait dans l’estime d’eux-même. Des biens se tissaient entre eux, la communication s’avérait possible et se renforçait dans le temps, les enrichissant mutuellement. Un peu plus tard, ils s’entraidaient, se soutenaient et se respectaient.
Au travail ou dans le privé, l’humour, la dérision et l’autodérision dont j’abusai étaient dés lors contagieuses, mais il régnait entre nous tous un respect de l’autre, les confits n’avaient plus lieu d’être et nous avancions tous ensemble.
Parmi les activités qui furent réalisées, citons : cuisine, piscine, chorale, revue de presse (avec le support du journal local), bien sûr échec, jeux de société, activités artistiques diverses, massages et relaxation.
Les sorties en groupe étaient très appréciées de tous, par exemple : restaurent et cinéma ensuite, les sorties en bord de mer plus restaurent bien sûr, des promenades en forêt étaient aussi proposées ; toutes ces sorties s’avérèrent très fructueuses. Une fois, le groupe s’est égaré en forêt, et ce fut un patient (Alain) qui a orienté le groupe pour sortir de cette galère !
Tous sont restés très calmes, pas d’angoisse, chacun rassurant l’autre avec une pointe d’humour, « même pas peur » ! Et qu’elle rigolade à notre retour à l’hôpital de jour lorsque nous avons évoqué cette déconvenue lors du déjeuner de midi ; chacun y allait de sa moquerie envers l’autre et aussi lui-même.
A travers cette « aventure », tous ont pris conscience de leur capacité à se contrôler dans une situation anxiogène ; car soignés comme soignants étions dans le même bateau et Alain (la capitaine) qui parlait très peu se lâchât petit à petit.
Dans ce cas de figure, les patients se sont « soignés » mutuellement lors d’une expérience positive. La prise de risque est indispensable pour obtenir des résultats significatifs, durables dans la revalorisation des patients, car cela leur a permis d’en apprendre un peu sur eux-mêmes, et beaucoup pour d’autres.
A propos d’apprendre, celles et ceux qui, après avoir obtenu un diplôme pour exercer un métier, quel qu’il soit, considèrent qu’ils savent tout, et de ce fait n’ont plus rien à apprendre sont indignes d’exercer leur profession ; nous apprenons tous les jours, jusqu’à la fin, tant sur le plan professionnel que personne,.
Il est très important que nous, les anciens puissions transmettre notre expérience à la génération qui arrive pour nous remplacer, sinon, nous n’aurons servir à rien, ce qui est très regrettable, surtout pour les patients qui risquent de régresser pour revenir à leur point de départ. Les plus fragiles sont toujours victimes. Un grand philosophe grec a répondit à la question « que savez-vous », tout ce que je sais, c’est que ne je ne sais rien.
L’histoire de monsieur N maintenant. Après une deuxième tentative de suicide en tentant de sauter du pont de Brotonne, il fut sauvé grâce à l’intervention de trois membres des forces de l’ordre. Après une courte hospitalisation, il fut pris en charge à l’hôpital de jour de Duclair.
Lors de la première consultation avec la psychiatre, cette dernière me le confiât, pour savoir s’il était possible de lui faire faire une ou deux activités thérapeutiques ; entre psychiatres et infirmiers nous travaillons en symbiose, en équipe.
Suite à l’entretien infirmier avec ce monsieur, nous avons convenu de venir deux jours par semaine pour participer à des activités choisies en commun ; ces activités étaient toujours adaptées au patient, il était hors de question de leur imposer quelque chose à laquelle ils n’adhèrent pas.
Nous commencions par un groupe de parole, prenant soin qu’il soit homogène ; le groupe revue de presse leur permettait d’avoir un pied dans la réalité, eux qui avaient longtemps été séparés de cette réalité. Monsieur N a participé à quelques sorties et s’intégrait au groupe de patients présents et attentionnés à son égard. Un jour il n’était pas présent au réfectoire et pendant le repas de midi, une personne qui sortait de sa consultation avec le psychologue, nous a signifié que « quelqu’un n’allait pas bien à l’étage » ; en fait Mr N était assis sur le rebord de la fenêtre ouverte, prêt à sauter dans le vide qui faisait environ 5 mètre de hauteur ; une chute eut peut être fatale. A cet instant, il était impératif d’agir tout de suite, sans discuter et sans attendre, j’ai pris le risque de l’écarter « Manu militari » de la fenêtre, puis la refermer le plus vite possible , geste réflexe de ma part.
Bien sûr il y avait le risque d’être entraîné dans sa chute, après une lutte âpre, la situation était sous contrôle ; Mr N s’est mis à pleurer et m’a raconté les raison de son mal être. Il s’est assis en haut de l’escalier et m’a dit : « Ce matin, mon fils (âgé de 7 ans) m’a dit papa, pourquoi tu ne travailler pas ? » ; puis Mr N s’effondra, en larmes.
A cet instant, j’ai compris l’ampleur de sa douleur, sans porteur pas contrôler ses pulsions et était toujours prisonnier de ses hallucinations. Monsieur N, accueilli chaleureusement par les autres patients, lors des activités auxquelles il participait lui étaient bénéfiques, et changea de comportement. Même s’il ne venait plus aux activités de façon régulière, il savait qu’il pouvait venir à l’hôpital de jour quand il en avait besoin, pour parler et nous étions là pour l’écouter.
Il lui arrivait de venir nous voir alors que ce n’était pas prévu, car ma collègue Nathalie et moi avions des activités programmées avec d’autres patients. Autour d’un café, nous étions toujours prêts à écouter ses confidences et une fois soulagé, il acceptait de rentrer chez lui, afin d’assurer nos ateliers avec les patients.
Une visite à domicile m’a permis de recevoir sa parole plus facilement parce qu’il était chez lui, rassuré, et il m’a fait des confidences à propos de ses hallucinations. Il voyait sa femme telle un monstre qu’il lui fallait éliminer, comme pour mettre fin à sa souffrance. Ce type d’hallucination, il les vivait réellement et en souffre d’autant plus qu’il passe à l’acte, regrette son agressif et se culpabilise. Il lui est arrivé de menacer sa femme avec un couteau dans un contexte hallucinatoire.
Nathalie « ma super collègue », comme tous les vendredis, animait l’activité cuisine avec environ huit patientes, affairés à éplucher, préparer la sauce mayonnaise, etc… Revenant d’une pause pipi, retour à la cuisine, et la mauvaise surprise, Mr N au milieu du groupe, maniant un couteau de cuisine !
Nathalie m’a lancé un regard inquiet et qui m’a suggéré d’intervenir car les patientes présentes étaient très angoissées par cette situation qui pouvait dégénérer. C’est d’abord pour protéger le groupe qu’il m’a fallu ravaler ma propre angoisse et rester calme, pas facile ; utilisant cette confiance, qu’il y avait entre Mr N et moi, je me suis lancé, sans trop savoir ce qui allait arriver.
Monsieur N tâtait la lame du couteau, comme pour vérifier le degré d’affûtage ; il semblait être dans cet était hallucinatoire, tel qu’il me l’avait décrit lors de la précédente visite à domicile. M’adressant à lui, calmement, je lui propose d’affûter ce couteau avec un petit appareil simple ; je lui tends l’outil, il essaye de l’utiliser, alors prétextant que ce n’était pas le bon geste, je lui propose de lui montrer de quelle façon s’en servir, puis il me donne le couteau et l’affûtoir à ce moment les patientes et Nathalie étaient rassurées et pouvaient poursuivre l’activité en tout sécurité.
De mon côté il fallait que je parle à Mr N dans le cadre d’un entretien infirmier, à la suite, il est rentré chez lui en toute quiétude. Après ce qui est devenu un incident déplaisant, l’ambiance conviviale et dynamique qui régnait d’habitude dans ce groupe reprenait ses droits ; la communication entre tous s’imposait, à travers des plaisanteries gentilles que Nathalie et moi distillons sans cesse et que les patients reprenaient entre eux, c’était des moments très agréables par tous.
Il est arrivé parfois que je sois obligé d’abandonner mes collègues pour des interventions extérieures, hors de mon pavillon ; comme ce dimanche matin lors duquel je ne fis acte de présence que pendant deux petites heures, le reste du temps je devais faire le tour des chambres d’isolement de tous les pavillons de l’hôpital et nous étions quatre dans le même cas !
Lors d’une nuit qui s’annonçait plutôt difficile dans la mesure où nous avions admis deux « patients », pour ma part c’était deux pervers, un jeune home et une jeune femme que nous avons surpris dans la salle de télévision en train de s’adonner à une fellation, ce devant deux autres patients qui ne regardaient pas l’écran ! Après les avoir raccompagné dans leurs chambres respectives, non sans mal ; appel en renfort d’urgence dans pavillon tout proche du notre, pour une admission plutôt musclée. C’était la nuit, cependant tout le monde pouvait voir les véhicules de police, de pompiers, les ambulances ;
Pendant près d’une heure, ma collègue était donc seule, jeune infirmière tout juste diplômée, ce fut pour elle une heure d’angoisse, tout comme pour moi. Le patient en question avait fait une tentative de suicide par pendaison, il était jeune et très fort ; A quatre infirmiers, il nous a fallut du temps pour le maîtriser, et ce fût très difficile, pour que les infirmières puissent lui injecter les médicaments par voie intramusculaire afin que la crise s’atténue. A quatre, nous avons attendu au moins une demi heure avant qu’il cesse de résister à la pression que nous maintenions sur lui, le tout sans aucune violence ou maltraitance d’aucune sorte.
Quand l’injection fût faite, nous sommes sortis de la chambre, pressés de retourner dans nos pavillons respectifs. Cependant l’effet du neuroleptique injecté n’avait pas encore agit, et avant de partir, après avoir jeté un coup d’œil par la lucarne de la porte de la chambre ; je vis qu’il tentait de se pendre avec un drap.
Nous sommes tous retournés à ses côtés et l’avons maintenu au sol, le temps que le traitement agisse enfin. Une heure après mon départ en renfort, me voilà de retour au pavillon en sueur en T-shirt et en plein hiver, blanc, tremblant ; heureusement que ma jeune collègue « Anne » avait très bien assuré le boulot pendant mon absence.
Ce manque cruel de soignants disponibles est mis en évidence à travers cet exemple ; le personnel est très mal formé à la psychiatrie, ils n’ont aucune expérience pratique, et incapables de masquer leur angoisse face à un patient. La conséquence c’est une lacune au niveau de leur temps de réaction face à une situation délicate, qui aboutit à une mise en danger d’eux-même et du patient.
Cette profession est exigeante, surtout pour le personnel masculin, nous devons être disponibles à tout moment ; comme pour faire le transfert d’un détenu suicidaire de la prison à l’hôpital psychiatrique. Normalement nous devons être quatre infirmiers, selon le règlement intérieur de l’hôpital ; la plupart du temps nous ne sommes que trois (1 infirmier et 2 aides soignants).
Lors du transfert nous cherchons toujours à créer un lien, un rapport de confiance en lui expliquant que nous sommes là pour l’aider. Très souvent, le détenu se confie à nous très facilement puis se détend l’arrivée au pavillon se passe très bien pour tout le monde et la mise en chambre d’isolement me pause aucun problème.
Dans toutes les prisons de France, 1/3 des détenus sont des malades mentaux !
Force est de constater qu’aucun malade ne ressemble à un autre, même s’ils présentent la même pathologie psychiatrique ; comme tous les êtres humains, ils ont leur propre histoire, chaque cas est différent. Les protocoles qu’il nous faut suivre doivent donc être nuancés en fonction de la personnalité de chacun ; il nous faut faire montre de beaucoup de souplesse et de réactivité dans ce genre d’intervention.
Dans les pavillons qui accueillent les patients arrivant pour la première fois en milieu psychiatrique et sont souvent amenés à revenir après un court séjour (c’est ce que l’on appelle des allés-retours entre leur domicile et l’hôpital) recherchent la protection auprès des soignants en qu’ils ont trouvé un peu de réconfort.
C’est souvent le début d’un relation fructueuse entre le soignant et le soigné ; lorsque l’on retrouve un patient ré hospitalisé et que l’on a connu dans un contexte aigu lors de sa première hospitalisation le lien ayant été établi, il devient plus facile de communiquer. Quand la confiance est installé, il se passe quelque chose dans la relation soignante avec le patient qui l’appel un « transfert » ; cependant c’est le malade qui choisit le soignant avec lequel peut se faire ce transfert.
Avec Mohamed, lors de sa deuxième hospitalisation, le courant est tout de suite passé entre nous, a tel point que lors d’une nuit qui s’annonçait plutôt calme, nous avons pris le temps de se parler dans le bureau, il était tard, mais Mohamed avait besoin de ce entretien, ses cauchemars l’empêchait de dormir. Et je voulais éviter d’avoir recours aux médicaments hypnotiques pourtant prescrits en cas d’insomnie, nous avons préférer prendre le temps de se parler, au fur et à mesure que nous échangions cela devenait enrichissant pour l’un et pour l’autre.
Vers 2 heures du matin, nous avons été interrompu par un appel d’urgence venant d’un autre pavillon dans l’hôpital ; personnellement je préférait poursuivre cet échange avec Mohamed. Le service dans lequel je travaillait était toujours appelé en premier pour ces renforts, alors que les autres services que possédaient aussi du personnel masculin restaient bien tranquille dans leur pavillon, et c’est moi, bonne poire qui faisait leur boulot.
Donc j’ai demandé à Mohamed de simuler une agitation, il a donné des coups de pieds dans le bureau tout en hurlant des insultes à mon égard… Par là même, il m’a permis de ne pas aller en renfort, et de poursuivre notre entretien au calme ; dans l’instant suivant l’appel, après avoir raccroché, Mohamed était mort de rire, nous étions dans la complicité car moi aussi j’étais hilaire.
Après une demi-heure, il est allé se coucher, il continuaient à rire même dans son lit ! Il a très bien dormi et sans médicaments.
Dans d’autres situations, comme pendant la première guerre du golfe contre l’Irak, il était très excité, perturbé, semblant avoir perdu le contrôle de lui et donc se mettait en danger, alors il venait vers moi, comme s’il cherchait un allié dans la guerre qu’il se faisait à lui-même.
Mohamed portait alors des vêtements kakis pour jouer le soldat combattant, comme s’il vivait la guerre pour de vrai, faisant des mouvements de sports de combat dans le couloir du pavillon, ce qui inquiétait tout le monde, patients et cadres infirmiers. Un jour, en fin d’après-midi, alors que je travaillait dans le pavillon d’à côté, Mohamed état le pavillon d’admission ; les deux collègues cadres infirmiers m’appellent afin de venir pour mettre Mohamed en chambre d’isolement avec le traitement injectable prescrit en cas d’agitation.
Aussitôt sur place, il me paraissait clair que Mohamed était dans un état d’angoisse important, il tait potentiellement agressifs, il n’était plus dans la réalité mais dans son délire, dans son univers de fou, se sentant agressé de toutes parts.
Si mes collègues cadres m’avaient appelé au secours, c’est qu’ils savaient que ma relation privilégiée avec Mohamed pouvait permettre de régler cette situation conflictuelle en douceur, ce que fut fait avec du dialogue et beaucoup de patience.
Demandant aux deux cadres de rester en retrait, je m’adresse à Mohamed en étant calme et souriant de la façon suivante :
« Alors Mohamed, tu m’as l’air troublé ? Dis moi ce qui ne va pas ; tu me reconnais n’est-ce pas. » Momo « C’est ces enc…s d'amerloques qui foutent la merde avec leur guerre du golf, pour du pétrole, qu’ils crèvent tous ! »
Phil- « As-tu confiance en moi Mohamed, »
Momo- « Oui, je sais que tu ne me veux pas de mal ».
Phil- « Voilà, je te trouve angoissé et je pense que tu devrais passer la nuit en chambre d’isolement où tu seras en sécurité, avec un traitement efficace pour t’apaiser ; es-tu d’accord ?! »
Momo- « OK, mais tu estes avec moi, j’ai besoin de parler avec toi. »
Phil – « Bien sûr, en plus, demain matin je serai là pour t’apporter ton petit déjeuner, et te faire sortir de cette chambre, qu’en dis-tu ? »
Momo- « Ça me va Phil, je sais que tu n’as qu’une parole. »
Phil- « Acceptes-tu l’injection pour te permettre de passer une nuit tranquille ? »
Momo- « OK Phil ! »
Pendant que mes collègues préparaient l’injection, Mohamed se mit en pyjama en ma présence, et pendant qu’à ses côtés, une mains sur l’épaule, je lui demandais de respirer lentement et profondément, afin qu’il puise supporter la douleur.
Comme promis, je suis resté seul avec lui pendant un bon quart d’heure ; nous avons parlé le temps que le médicament produise son effet ; puis je lui ai donné rendez-vous pour le petit déjeuner du matin, le lendemain. Rassuré, il s’endormit, et du travail m’attendait dans mon pavillon.
Le lendemain matin ma collègue et moi, pour assurer le réveil de Mohamed et lui servir son petit déjeuner, plus médicaments si affinité, avons constaté qu’il était apaisé. Alors je pris la responsabilité, en accord avec mes collègues, de le sortir de cette chambre d’isolement. Ce fut un moment de grande émotion, dés lors, il savait qu’il pourrait toujours compter sur nous, les soignants.
Après 25 années de rapports privilégiés avec Mohamed, notre complicité dépassait la relation soignant, soigné, comme une forme de fraternité, de bienveillance mutuelle que je ne peux expliciter. Il y a d’autres exemples qui me viennent à l’esprit pour décrire cette complicité entre nous, malgré le temps qui passe, mais ce serait trop long à raconter.
à suivre.....Philippe Stefan avec la collaboration de Christian Descamps
Une vidéo Rare sur l'histoire du CHSR de sotteville-lès-rouen
Enquêtes sur la mémoire infirmière dans un hôpital psychiatrique de Rouen
Bio psycho sociologie
denieres découvertes :La spyrale dynamique
2.Description approfondie de la SD
37 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON