Et vos enfants ne sauront pas lire… ni compter !
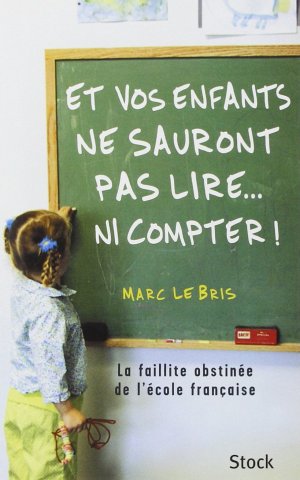
Je ne suis pas dans le premier degré. J’ignore si la méthode syllabique et le calcul mental, la dictée, le « par cœur » ont refait leur apparition. Du moins, je doute d’un retour officiel. Pourtant je suis persuadé que ces pratiques existent toujours, incognito, à l’ombre des circulaires officielles et des inspections académiques. Je salue ici celles et ceux qui, hier comme demain, continuent la résistance.
Cet article est une note de lecture de Et vos enfants ne sauront pas lire... ni compter ! écrit Marc Le Bris, publié en 2004 chez Stock. Lorsqu’il publie ce texte, l’auteur est instituteur et directeur d’Ecole. Dans un style clair et limpide, il mêle anecdotes, réflexions personnelles et ouvertures théoriques. Le propos est argumenté et reste mesuré, même s’il sait parfois faire preuve d’une verve revigorante. Bien qu’il ait quelque un peu perdu de sa brûlante actualité, ce dernier permet de nourrir la réflexion sur l’Ecole contemporaine. Les problèmes ne datent pas d’aujourd’hui, ni d’hier, mais d’avant hier.
La fin du syllabage
Jadis, les instituteurs employaient la méthode dite syllabique : identifier les lettres présentes dans un mot, afin de pouvoir les combiner en syllabes. L’auteur évoque avec nostalgie la célèbre Méthode Boscher utilisée pendant des décennies sur les bancs des Ecoles de France.
« On dit à l’enfant le son que fait (habituellement) chaque lettre, on le lui fait retenir (il l’apprend !), puis il utilise ces sons pour arriver à les associer en syllabes. On l’entraîne alors systématiquement à combiner ces syllabes élémentaires : b et a font ba. On lui montre très vite les associations qui ne sont que des conventions pures (o et u, a et n…) et on lui fait apprendre de telle façon qu’il n’hésitera plus une seconde devant un oui ou devant un ou. »
Depuis lors, les experts en science de l’éducation ont accouché d’une nouvelle méthode appelée globale. L’auteur affilie celle-ci à un courant à la mode au sein des sciences humaines du début de XXème siècle, la Gesltaltheorie (ou Psychologie de la Forme). A l’instar du phénomène perceptif qui partirait du monde perçu globalement comme Forme, pour n’être analysé qu’après coup en atomes de sensations abstraites, le rapport naturel au langage devrait aller « du tout vers l’élément ».
« On donne des textes aux enfants, ils cherchent des indices du sens du texte dans les illustrations. Puis du sens deviné du texte, ils déduiront le bruit que font les lettres. »
Dans cette optique, la combinatoire syllabique devient anti-naturelle, et est donc supprimée. La frénésie du nouveau conduit à la détestation fanatique de toutes les méthodes d’autrefois : syllaber un texte à l’oral, apprendre par cœur et réciter devant la classe, maîtriser la dictée. On a relayé aux oubliettes des méthodes ancestrales, construite patiemment au cours d’un siècle d’instruction publique, fruits d’échanges et d’intelligence collective.
« C’est devenu la science des ânes car il faut apprendre et répéter, ânonner et chanter ; c’est scolastique. »
Le mythe de l’enfant démiurge
L’auteur rattache la méthode globale à ce qu’il nomme le « mythe de l’enfant créateur de son savoir ». La fameuse « analyse autonome, du tout vers l’élément » suppose de l’enfant d’être un véritable démiurge. A titre d’exemple, il cite le pédagogue moderniste O. Decroly : les enfants sont des « créateurs de cosmogonies » capables de « faire sortir l’ordre du chaos ». Ces délires poétiques des années 1920 s’incarneront concrètement dans la loi d’orientation de 1989 plaçant « l’élève au centre du système éducatif ».
Tandis que l’Ecole traditionnelle fonctionnait sur le modèle de la transmission (un maître qui sait (qui maîtrise) à un élève qui apprend (qui s’élève)), l’Ecole contemporaine fonctionne sur la logique de l’accompagnement (d’un enfant « acteur de ses apprentissages » par un « enseignant » réduit au rôle d’encadrement). Non sans sarcasme, l’auteur rappelle comment, durant ses années de formation à l’IUFM, les pédagogues faisaient l’éloge des l’inénarrables « situation-problème autocorrective » et des « conflits socio-affectifs » (débats animés par un enseignant, travail par petits groupes d’élèves).
Ce mythe de l’élève redécouvrant tout par lui-même nie l’histoire de l’Humanité. « Il a fallu trois mille ans à l’humanité pour qu’elle parvienne à décomposer les mots en leurs éléments ultimes, les lettres. Et on demande aux petits CP de déduire eux-mêmes, à six ans, et en six mois, ce génial travail de conception. ».
La musculation des neurones
Le leitmotiv constant de l’auteur est : « pour qu’il y ait qualité, il faut la quantité ». Sa défense des méthodes traditionnelles part du constat que l’intelligence de l’enfant ne peut se développer qu’à partir (et après seulement) d’une « musculation » de la mémoire. Il faut que l’enfant apprenne, et apprenne beaucoup. Par la quantité, il organise, il structure, littéralement il com-prend. Seulement après, il affine les distinctions, précise son vocabulaire et renforce son raisonnement. Bien sûr il y a des élèves plus ou moins doués, mais en ce qui concerne l’apprentissage élémentaire de la langue, il n’est pas question de don mais de mémoire.
« C’est à l’Ecole primaire que reviennent les travaux systématiques, les entraînement d’haltérophile, la musculation des neurones, l’entraînement de la mémoire. »
Le cas des mathématiques
L’auteur établit un parallèle entre les réformes de l’enseignement du français et des mathématiques.
« Les « maths modernes à l’école » sont la méthode globale appliqué au calcul et la méthode globale ressemble bien à une sorte de « maths modernes » pour la lecture. »
L’auteur rappelle les courtes réformes bourbakistes des années 60–70, imposant une mathématique axiomatique et ensembliste. « On a enlevé les éléments les plus outrageusement impossibles, on a enlevé les bases exotiques, les ensembles, mais on a gardé l’abstraction des nombres, la défiance contre le calcul mental, le rejet de l’arithmétique, la volonté de retarder les techniques opératoires dans les programmes. »
On retrouve la même idéologie de l’enfant créateur de son savoir. Par miracle, il réaliserait seul ce « saut direct dans l’abstraction ». Par un constructivisme benêt, on croit que l’enfant peut arriver à son savoir de façon autonome (c’est-à-dire, en réalité, hasardeuse et imprécise). Pourtant, à l’instar de la très lente invention des écritures alphabétiques, « il a fallu plusieurs siècles aux Égyptiens pour arriver à l’abstraction du nombre pur ».
Au nom de la spontanéité créatrice de l’enfant, on rejette tout entraînement systématique. Pourtant, comme pour la lecture, le calcul est affaire de pratique et de mémorisation. C’est en pratiquant le calcul mental, partout, tout le temps, que peut émerger la notion abstraite de nombre. C’est en apprenant par cœur les tables de multiplication jusqu’à 15, que le sens de la double distributivité peut se manifester.
Un aveuglement sectaire
Le constat de Marc Le Bris est sans appel : la méthode moderne a développé un nouvel illettrisme. A l’époque, d’aucuns arguaient que l’enfant qui lit par « photographie globale » gagnerait en vitesse de lecture ! Pourtant l’auteur rappelle qu’on s’est mis à redoubler, plus que de raison, la classe de CP, pour cause de lacunes en lecture. On a observé une lecture défaillante et un usage imprécis du vocabulaire. Les ravages se sont fait sentir au collège lors du passage à l’abstraction et au raisonnement.
Qu’ont fait les sectateurs zélées de la méthode moderne ? Ils ont expliqué à qui voulait bien l’entendre que la méthode n’avait pas porté ses fruits par manque d’application systématique. C’est bien connu, un corps empoisonné guérira si on lui inocule du poison supplémentaire ! Jamais de remise en question. Jamais. Au contraire, la fuite en avant s’accélère.
« La pédagogie moderne est une religion, et ses cadres sont une secte (…)
— j’hésite entre le fonctionnement des sectes religieuses et celui des cohortes staliniennes — »
On rétorquera qu’on observe aujourd’hui une quasi-disparition des redoublements en CP. Certes, mais c’est qu’une solution miracle fut trouvée, avec l’introduction des cycles tri-annuels. On dit aux parents : ne vous inquiétez pas, votre enfant apprendra à lire à son rythme, en trois ans, au cous du « cycle 2 » : CP-CE1-CE2. En réalité, ce qui n’est pas acquis à un temps t, a peu de chance, surtout si on ne change pas la méthode, d’être acquis aux temps t+1 ou t+2.
En mathématiques, on observe les mêmes travers. Vocabulaire imprécis, difficultés à raisonner et à calculer « de tête ». Les élèves témoignent souvent des mêmes difficultés à respecter des règles grammaticales que des règles opératoires, des règles de conjugaison que des règles de priorités de calculs. Mêmes causes, mêmes effets.
« Imaginez une loi d’orientation de la médecine qui imposerait de tout soigner par homéopathie. La loi Jospin de 1989, c’est ça. »
ERRATUM :
Cette note de lecture se propose de résumer les thèses de l’auteur concernant l’apprentissage de la lecture et du calcul. Elle n’épuise évidemment pas un ouvrage qui mérite d’être lu pour lui-même. On y trouve notamment des réflexions sur la formation des enseignants (la description des études à l’IUFM est croustillante), les programmes, l’inspection académique ou encore la question de l’autorité (la venue du gendarme en classe est un moment d’anthologie).
POUR ALLER PLUS LOIN :
Sur les différentes méthodes d’apprentissage de la lecture :
Sur la loi d’orientation de 1989 :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/LISTE_TEXTES_MSP_2014/93/7/MSP60_1_302937.pdf
Sur l’organisation en cycles :
https://eduscol.education.fr/cid101628/cycles-et-horaires.html
34 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










