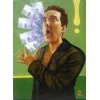In-justification première. Travailler plus, pour gagner plus…
L’autre jour, à un souper d’amis, on me disait qu’il était normal et juste qu’un entrepreneur ou un patron gagne plus qu’un simple employé. Sur le moment, je dois l’avouer, je ne sus répondre tellement la sentence avait l’air logique et correcte. Cependant, il y a quelque chose qui sonnait faux et qui allait engager chez moi, dès mon retour, une réflexion. Une réflexion que je veux partager avec vous, parce qu’elle a trait à une des justifications centrales de la politique des inégalités.
C’est vrai, il est normal et juste qu’une personne qui travaille plus pour la collectivité perçoive une reconnaissance qui soit au niveau de l’effort qu’elle a fourni. Cela dit, outre le fait que cela ne soit pas toujours actuellement le cas, ce qu’il faut dire c’est que le type de reconnaissance que l’on perçoit, à l’intérieur de notre environnement socioéconomique, fait écho à une logique totalisante que l’on ne maîtrise pas et que l’on peut résumer ici en usant le simple mot : « argent ». En fait, on peut dire à ce propos que le monopole de l’argent et des échanges monnayés – en dépit d’autres formes de reconnaissance comme, par exemple, l’échange de service, le remerciement ou le regard empli de gratitude – a pris une importance considérable dans les relations humaines et sociales. Or, que l’argent soit le moyen générique qui a été choisi par l’humain pour ses échanges n’est pas un problème en soi. En revanche, cela serait une erreur de ne voir en l’argent qu’un moyen ou une finalité, car il est surtout, en dernière analyse, un pouvoir. Un pouvoir de faire travailler l’autre pour moi. Dès lors, on comprend que le « gagner plus » n’est pas neutre socialement. Il fait référence à une certaine hiérarchie économique, mais surtout et, à l’inverse d’autres moyens d’échange qui font référence à un lien social qu’il faut renouveler, l’argent crée cette distance qui fausse les relations, qui corrompt les sentiments. Par ailleurs, on peut dire que si le pouvoir de l’argent bouge sans cesse – participant ainsi à l’illusion démocratique –, il nous détourne du fait que le pouvoir des positions et l’idéologie des possédants au-dessus des moins-possédants ne bougent pas. Il faut absolument maintenir le consommateur dans la croyance en sa souveraineté pour effacer sa position d’employé subalterne, pour effacer sa domestication économique.
Par conséquent, le reproche que j’avais envie de faire à cette personne c’est que nul n’a demandé à l’entrepreneur ou à quiconque de travailler plus, sinon la dynamique marchande et son conditionnement ! Certes, l’entrepreneur en a le droit en tant que sujet libre, mais il ne peut pas – sur une motivation qui est tout de même la sienne – exiger de l’autre une reconnaissance qui, comme je l’ai expliqué, dépossèdera celui-ci d’un pouvoir qui devrait être partagé et collectif ; d’un pouvoir qui, s’il n’existait pas, pourrait être l’« organisation mutuelle des citoyens polyvalents et responsables ».
À côté de cela, il y a quelque chose que j’ai oublié dans mon reproche. Je pense à ceux qui travaillent plus, parce qu’ils sont dans une situation précaire qui les y oblige. Sur ce point, il est évident qu’il y a un problème ; pensons seulement à ces employés des professions dites « manuelles » qui gagnent moins, alors que nous sommes tous d’accord pour dire que ces métiers sont les plus utiles, les plus difficiles et les plus essentiels à l’existence humaine. C’est sûr, eux, ils ne peuvent pas trop se poser de questions. Certainement, ils auront une famille, et cette famille il faut la nourrir, la loger. Ils n’ont tout simplement pas le choix ; du reste, il faut également le dire d’un point de vue de la logique dominante, c’est une « bonne stratégie » puisque l’on parvient ainsi à faire travailler des gens sur des travaux que personne ne voudrait faire. Or, cette constatation nous permet de mettre en lumière la fonction centrale et donc la nécessité de la pauvreté dans un système hiérarchisé autour de l’argent. En effet, sans pauvreté, il n’y aurait pas de riches puisque le travail serait partagé de manière organisée et équitable. Dans ce cas, la richesse serait vite perçue comme une maladie sociale à fuir.
À ce stade de la réflexion, il n’est peut-être pas inutile d’inviter le lecteur à songer à ce qui est nécessaire pour l’homme à sa survie. C’est vrai : pourquoi devrions-nous travailler plus, alors que tout semble indiquer – que cela soit écologiquement (les ressources), socialement (le chômage) ou même subjectivement (le sens) – qu’il serait préférable, au contraire, que l’on travaille moins et que l’on dédie, par conséquent, plus de temps à l’organisation mutuelle ?
Quant à la question de la responsabilité, j’aurais envie de dire la même chose de ce que je disais en début d’article, soit : « il est normal et juste qu’une personne qui a plus de responsabilités... » En même temps, je demande : pourquoi devrait-elle avoir plus de responsabilités qu’une autre personne du même âge et de capacité égale ? La question semble étrange, pourtant réfléchissons-y... La première réponse qui nous viendra certainement à l’esprit consiste à mettre en avant des compétences acquises, mais alors cela signifie que notre système institutionnel a pour fonction non pas de renforcer le lien social mais, au contraire, de favoriser les différences, de renforcer la hiérarchie et la concurrence. Alors, sommes-nous prêts à reconnaître que notre système institutionnel est plus économique que social ? Si oui, il y a alors une énorme hypocrisie qui n’est pas acceptable pour des nations civilisées dites « avancées » qui se permettent de donner des leçons aux autres sur la démocratie à avoir.
Bref, nous parlions de responsabilité et à ce propos, il est fondamental qu’on laisse de côté les petites et moyennes entreprises (PME) – quand bien même il serait tout à fait pertinent d’aller sur le terrain et d’y prendre une situation concrète pour ensuite interroger la raison et les enjeux de la responsabilité. Certainement, nous verrions que l’on retombe devant des impératifs économiques et sociaux qui sont en lien direct avec le contexte juridique et économique dans lequel on se trouve et qui, finalement, ne nous laisse que peu de choix. Autrement dit, on se retrouve devant la situation de précarité qu’on vient de mentionner. Dès lors, je voudrais dire que justifier les hauts revenus par l’argument de la responsabilité ne revient pas à se défendre soi-même, mais bien à défendre ce système qu’il faudrait, au contraire, renverser au nom de la dignité et de la justice. L’entreprise, l’institution sont des choses communes qu’il faudrait partager en tant que telles. Ainsi, la responsabilité serait une délégation collective non pas dans le but de gagner plus, mais dans le but de bien « vivre ensemble ».
À la suite de cela, une dernière remarque pourra m’être faite. Elle concerne le cas de celui qui a investi toute sa fortune ou une partie de celle-ci et qui attend, par conséquent, que cet investissement lui rapporte une plus-value. À ce propos et outre le fait que l’autre participe toujours à la richesse de l’un, il faut bien comprendre que l’investissement que l’on fait dans l’esprit de s’enrichir répond non pas à un sens existentiel, mais bien à un certain environnement, à un certain état d’esprit que l’on croit être libre et nôtre, mais qui est en fait la réponse économiquement cohérente à cette prise d’otage que représente la nécessité d’avoir constamment de l’argent pour, simplement, pouvoir être quelqu’un parmi les autres.
Finalement, derrière cette volonté de s’enrichir, il faut pouvoir y voir un profond désir de revanche face au mépris que nous subissons tous, chaque jour. Il faut pouvoir y voir un besoin naturel et humain de reconnaissance. À côté de cette remarque, je m’en rends compte : s’il n’y a pas de plus-value, on n’investit pas et sans investissement on ne travaille pas. On entre alors dans le cœur de la logique, dans le cœur de la « matrix ». On se trouve comme devant une impasse qui nous oblige à soutenir ceux qui possèdent l’argent, à soutenir ceux qui nous font travailler. Or, c’est cette situation de dépendance qui devrait nous faire réagir, nous éveiller.
© Luca V. Bagiella *
Doctorant en philosophie politique et sciences sociales
* À paraître en fin d’année : Narcissisme-critique aux éditions Hélice Hélas.
22 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON