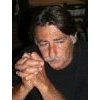4. L’identité des trafiquants : les labos de nos quartiers
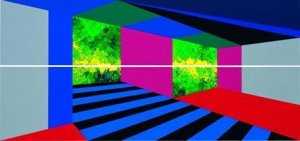
Initialement, la recherche d’analgésiques de synthèse se développe surtout en Allemagne. Il s’agit à la fois de trouver des médicaments ayant les mêmes effets que la morphine mais n’entraînant pas de dépendance et d’assurer l’approvisionnement de l’armée sans être péthidine (1939), puis la méthadone. Cette dernière, baptisée en l’honneur d’Adolf Hitler, ne sera finalement pas donnée aux soldats du Reich car jugée trop toxique. L’industrie pharmaceutique se penche aussi sur les stimulants. A Tokyo, à la fin du XIXe siècle, l’éphédrine avait été extraite de l’Ephedra vulgaris, une plante déjà utilisée par les Chinois il y a 5 000 ans. L’amphétamine naît de cette découverte, également exploitée aux Etats-Unis et en Allemagne. Ces trois pays en feront un usage intensif pendant la seconde Guerre mondiale pour doper leurs combattants.
En Occident, les psychotropes s’installent à la fin des années 50. L’industrie pharmaceutique inonde le marché. Le public américain consomme, en toute légalité, de milliards de comprimés d’amphétamine, de méthamphétamine et de tranquillisants. En ces années de performances économiques, les gangs de motards (comme au Canada, en Grande-Bretagne et en Australie) joueront un rôle actif dans l’approvisionnement d’un marché clandestin qui recrute majoritairement dans les classes moyennes de l’Amérique profonde. Dans le Midwest, la méthamphétamine est encore aujourd’hui appelée redneck cocaine : « la cocaïne du plouc ». L’amphétamine gagne la Scandinavie dans les années soixante, sous forme d’ampoules à injecter. Stockholm compte, en 1965, 4 000. Aujourd’hui, un abus à grande échelle d’amphétamine reste la marque du nord de l’Europe : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Danemark, Suède. En Espagne, ou la méthamphétamine fut longuement consommée par les combattants de la guerre civile, ce stimulant est entré dans les mœurs au point que, dans une étude réalisée en 1969, 66% des étudiants reconnaissent en avoir consommé à l’occasion d’examens ou de fêtes.
En 1965, aux Etats-Unis, les Drug Abuse Control Amendments réduisent drastiquement la production et la distribution licites des psychotropes. Le marché clandestin trouvera la parade en produisant ses propres drogues. Le développement de la recherche psychiatrique (souvent sous l’impulsion de l’armée) et la quête de sensations nouvelles qui marquent les années 60 offrent des débouchés aux drogues synthétiques sur les campus américains. Un universitaire de renom, Timothy Leary, vante les propriétés hallucinogènes du LSD, « découvert » en 1943 par le Suisse Albert Hofmann, chercheur des laboratoires Sandoz. La réputation de l’« acide » atteint vite l’Europe. A la fin des années 70, les deux tiers de la production mondiale de LSD viennent de laboratoires clandestins de la région de Londres et du Pays-de-Galles. En Californie, la ville de Hayward devient la capitale mondiale d’un autre hallucinogène, : le PCP, ou « poussière d’ange ».
A partir de la fin des années 1980, une forme cristalline fumable de méthamphétamine, surnommée ice ou shabu, sera introduite aux Etats-Unis depuis le sud-est asiatique, via Hawaï et la côte Ouest.
A la fin des années 60, les Californiens avaient découvert un autre dérivé amphétaminique, la MDA, baptisée « pilule de l’amour ». Le produit avait été oublié pendant des décennies : la firme pharmaceutique allemande Merck l’avait identifié dès 1910, ainsi qu’un « cousin » aux propriétés voisines, la MDMA (1913). Cette dernière, « découverte » en 1965 par un biochimiste américain, Alexander Shulgin, n’arrive dans la rue qu’au début des années 80, sous le nom d’Adam. En 1985, date de son interdiction outre-Atlantique, elle jouit d’une grande popularité chez les étudiants qui l’appellent ecstasy. Cette interdiction fait l’objet d’un débat passionné. Forte de sa réputation de produit convivial, l’ecstasy franchit l’Atlantique pour atterrir dans les discothèques d’Ibiza, rebaptisée « XTC Island ». Associée à la musique de danse, la MDMA submerge l’Angleterre pendant l’été 1988. Elle fait rapidement figure d’emblème de la sous-culture des rave parties, devenue dominante chez la jeunesse d’Europe occidentale du milieu des années 90.
Aujourd’hui, les trois drogues les plus consommées outre-Manche sont, dans l’ordre, les dérivés du cannabis, l’amphétamine et l’ecstasy. Celle-ci fait aussi fureur en Espagne et en Allemagne. En Italie, où les quantités saisies ont augmenté de 5 000 % entre 1990 et 1994, les autorités signalaient récemment des achats massifs par les mafias de drogues synthétiques achetées en Europe de l’Est et payés en faux dollars. Les Pays-Bas produisent 80% de l’amphétamine et la quasi-totalité de l’ecstasy saisis en Europe. Toujours à partir de laboratoires néerlandais, le LSD fait également un retour spectaculaire.
Outre-Atlantique, ce phénomène est amplifié. Des drogues oubliées resurgissent depuis le début des années 90. Le PCP connaît un regain d’intérêt au Canada (des laboratoires clandestins en Ontario s’en sont fait une spécialité) et dans les ghettos de la côte Ouest des Etats-Unis, où il est produit et commercialisé avec le crack par les gangs de Los Angeles. Les dérivés du fentanyl, dits « héroïne synthétique », bénéficient du reflux généralisé de l’épidémie de crack, tout comme la méthamphétamine. Celle-ci, depuis la mise en œuvre de la législation fédérale sur les précurseurs chimiques (1989), est de plus en plus produite au Mexique pour être distribuée dans tout l’Ouest et le Sud-Ouest américains par des gangs hispaniques affiliés aux grands cartels mexicains. Leur bastion est San Diego, en Californie.
On l’a vu, pour les trafiquants, les drogues synthétiques présentent le double avantage de pouvoir être produites à proximité des lieux de consommation, d’être aisément dissimulables et, compte tenu du prix des ingrédients de base et de la très forte concentration des doses, de permettre des profits colossaux. Robert K. Sager, patron du laboratoire de la DEA, estimait déjà en 1986 que, pour un investissement de 150 dollars un chimiste peut produire en quatre jours 500 grammes d’« héroïne synthétique » (3-méthylfentanyl), soit 50 millions de doses, pour un bénéfice avoisinant 500 millions de dollars.
Depuis le début des années 80, le marché des drogues voit sans cesse surgir de nouveaux composés : les designer drugs. Au lieu de se contenter de détourner les substances pharmaceutiques ou de les reproduire dans leurs laboratoires clandestins, des chimistes modifient à l’envi les formules de base pour créer une infinité de molécules inconnues qui, tant qu’elles ne sont pas formellement identifiées, échappent à la loi. Auparavant, tous les psychotropes faisant l’objet d’un trafic étaient le fruit de la recherche pharmaceutique, que le résultat en soit commercialisé ou non. L’industrie connaissait bien la pratique qui permet de contourner le brevet déposé par un concurrent en modifiant légèrement son produit (les anglo-saxons parlent de « me-too drugs »). Mais, avec les designer drugs, ou « drogues à la carte » - pour reprendre l’expression du Dr Istvan Bayer, expert hongrois auprès des Nations Unies -, l’utilisateur sert directement de cobaye à la nouvelle molécule.
Le phénomène est apparu aux Etats-Unis : la première drogue totalement originale issue de la production clandestine fut l’alpha-méthylfentanyl (un dérivé du fentanyl, deux fois plus puissant), vendu dans les rues californiennes en 1979. Dans ce domaine, les combinaisons sont infinies : Alexander Shulgin, l’« inventeur » de l’ecstasy, a décrit la synthèse et les effets de 179 phényléthylamines, analogues de la mescaline et de l’amphétamine. Encore ne s’agissait-il là que de quelques-uns des centaines de cousins possibles de la MDMA…
Les instances de contrôle reconnaissent volontiers que le raz-de-marée des produits de synthèse n’est retardé que par l’inefficacité de la lutte contre les drogues naturelles : le consommateur occidental préfère encore l’original à un « ersatz », même mille fois plus puissant. Mais pour combien de temps ? Jusqu’à présent, l’attrait pour les drogues était à la fois lié au rituel de l’usage et au dépassement d’un interdit. Dans cet esprit, les composés chimiques prêts à consommer étaient plus perçus comme des médicaments que comme de vraies drogues. C’est ainsi que l’amphétamine et les calmants ont séduit les classes moyennes aux Etats-Unis et en Europe, populations pourtant farouchement hostiles aux drogues illicites. Ces mêmes populations ont remplacé le caoutchouc par le plastique, le coton par le nylon et le bois par le formica. Cette acculturation des sociétés occidentales, pour reprendre le terme des sociologues, affecte inévitablement la connotation quasi-mystique des drogues « classiques ». Et les drogues synthétiques illicites tendent à rejoindre les préoccupations de plus en plus utilitaristes de leurs consommateurs. Les pilules pour danser, pour faire l’amour ou pour travailler, les cachets pour briller en société tiennent, dans l’esprit des jeunes générations, la même place que les somnifères ou les stimulants chez leurs parents.
L’entrée en force des pays de l’ex-bloc soviétique sur le marché des drogues, depuis le début des années 90, pourrait être le détonateur. Les organisations criminelles locales peuvent aussi bien choisir de développer les cultures de plantes à drogues, que de reconvertir une industrie chimique à l’abandon dans la production massive de drogues de synthèses. Cette dernière solution est favorisée par plusieurs facteurs : les produits chimiques de base ne sont soumis à aucun contrôle sérieux ; les chimistes très qualifiés et sous-payés sont légion ; les consommateurs de drogues de ces pays ont peu l’habitude des drogues naturelles (du moins dans les zones urbaines) et n’ont donc aucune prévention contre leurs succédanés. Or, ces dernières années, les signes de la mise en place de productions à grande échelle à l’Est se sont multipliés.
La police allemande estime que 20 à 25% de l’amphétamine saisie sur son territoire en 1994 vient de Pologne. Les autorités de Varsovie jugent, pour leur part, que la production nationale couvre 10% du marché européen. Des laboratoires universitaires sont soupçonnés et l’on ne compte plus les passeurs arrêtés aux frontières allemande et suédoise. La République tchèque dispute aux Polonais le titre de deuxième producteur européen de psychotropes, après les Pays-Bas. La méthamphétamine, sous forme liquide injectable, y supplante les drogues naturelles. La firme Rostoki, dans la banlieue de Prague, est le plus gros fabriquant d’éphédrine (le principal précurseur de la méthamphétamine) synthétique d’Europe centrale. En 1994, les Nations Unies ont dénoncé l’expédition de 50 tonnes d’éphédrine tchèque à des laboratoires clandestins mexicains, via la Suisse. Des chimistes tchèques sont employés par des laboratoires implantés en Saxe (Allemagne) voisine. Différentes affaires, survenues depuis 1992, ont prouvé que la Lettonie et la Hongrie sont les terres d’élection d’investisseurs, notamment scandinaves et néerlandais, qui financent la production d’ecstasy destinée à l’Union européenne. En 1993, enfin, l’Organe international de contrôle des stupéfiants s’inquiétait de l’existence, en Bulgarie, d’entreprises d’État fabriquant des phényléthylamines exportées sans autorisation sous la marque Captagon vers l’Afrique (Nigéria) et la péninsule arabique, via la Turquie.
L’ex-URSS est en passe de dépasser ces performances. L’Azerbaïdjan s’est spécialisé dans la production d’opiacés de synthèse (méthadone, normorphine , 3-méthylfentanyl) et de méthamphétamine à Guiandja et Bakou. En CEI, l’éphédrine synthétique est extraite de préparations pharmaceutiques et transformée en éphédrone (un dérivé amphétaminique connu aux Etats-Unis sous le nom de methcathinone), produite en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, dans les États baltes et au Kazakhstan. L’Ephedra vulgaris, cultivée en Azerbaïdjan, pousse à l’état sauvage au Kirghizistan et au Kazakhstan, dans la région d’Almaty.
La Chine, elle aussi, tire parti de ses ressources en Ephedra. Les laboratoires clandestins de méthamphétamine, alimentés par de l’éphédrine détournée de l’industrie pharmaceutique, se multiplient dans les régions de Guangdong et de Fujian, pour l’instant à destination quasi-exclusive des marchés du sud-est asiastique et de la CEI. L’initiative de cette production revient souvent aux triades taïwanaises, originaires de Chine du Sud.
La Corée du Nord, la Birmanie (qui a vu dans ces drogue un substitut bien accommodant pour échapper aux pressions de la communauté internationale qui l’accusait d’être le premier producteur mondial d’héroïne), l’Afrique du sud (qui a un lourd passé d’intoxication des rebelles de l’ANC par des psychotropes) fait aussi partie du club. Mais, l’essentiel de leurs productions visent un marché régional. (pour plus d’infos : Atlas Mondial des Drogues, PUF ed.)
17 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON