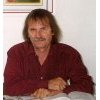La grande tradition bismarckienne à la rescousse du Code civil
À l’évidence, c’est toute l’analyse politique de Charles Benoist, futur précepteur de ce comte de Paris qui figure comme l’ombre permanente de Charles de Gaulle - depuis l’assassinat de Darlan en 1942 jusqu’au temps de la Cinquième République -, qu’on retrouve dans le Rapport rédigé en 1905 au nom de la Commission du travail chargée d’examiner les projets de loi portant codification des lois ouvrières.
Or, au-delà de la situation française et de l’impact qu’a eu sur elle la révolution de février 1848, un autre phénomène a vivement marqué Charles Benoist, comme il marquera Charles de Gaulle : il s’agit de la politique intérieure de Bismarck. Peut-être ferais-je bien de signaler ici que l’aide de camp qui accompagnait De Gaulle lorsque celui-ci a quitté Bordeaux pour Londres à la veille du 18 juin 1940, Geoffroy Chodron de Courcel - cousin de Bernadette Chirac - avait consacré son doctorat en droit à… Bismarck.
Dans la Crise de l’État moderne (tome I, 1905), Charles Benoist nous reconduit à la conférence de Berlin qui avait eu lieu du 15 au 29 mars 1890. Il cite le rescrit signé par l’empereur Guillaume II le 4 février 1890 et adressé aux ambassadeurs des pays participants, avec une lettre d’accompagnement rédigée par Bismarck. La voilà bien, l’Europe sociale façon prussienne et impérialiste :
« Vu la concurrence internationale sur le marché du monde, et vu la communauté des intérêts qui en provient, les institutions pour l’amélioration du sort des ouvriers ne sauraient être réalisées par un seul État, sans lui rendre la concurrence impossible vis-à-vis des autres. Des mesures dans ce sens ne peuvent donc être prises que sur une base établie d’une manière conforme par tous les États intéressés. » (page 136)
Au temps d’un Bismarck unificateur du IIème Reich, les pays intéressés sont bien sûr ceux de la sphère d’influence de l’Allemagne d’avant la défaite de 1918. Ainsi, après avoir rallié, à la cause d’une Prusse qui avait su se saisir de l’Alsace-Lorraine par la force de son armée, une classe ouvrière plus ou moins éblouie par une batterie de mesures sociales toutes plus surprenantes les unes que les autres, Bismarck pensait-il rencontrer, dans les classes dirigeantes des pays environnants, des personnages aussi avertis que lui.
Y compris dans les syndicats ouvriers… puisque le rescrit poursuit ainsi :
« Les classes ouvrières des différents pays se rendant compte de cet état de choses, ont établi des rapports internationaux qui visent à l’amélioration de leur situation. Des efforts dans ce sens ne sauraient aboutir que si les Gouvernements cherchaient à arriver par voie de conférences internationales à une entente sur les questions les plus importantes pour les intérêts des classes ouvrières. » (page 137)
Une fois la conférence de Berlin terminée, on pourrait entendre Guillaume II déclarer, à l’ouverture de la session du Parlement impérial - et c’est encore Charles Benoist qui nous le signale :
« À mesure que la population se rendra compte des efforts de l’Empire pour améliorer sa condition, elle prendra une conscience plus claire des maux qu’attirerait sur elle la revendication de réformes excessives et irréalisables. » (page 146)
Quittons le livre de Charles Benoist, et revenons à son Rapport… qui reprend maintenant les propos du professeur Thaller déjà présents dans le tome 25 de la Revue des Deux Mondes (1905) :
« Ce qu’il faut, c’est un Code du travail, à l’instar de la Gewerbeordnung allemande, coordonnant les dispositions protectrices du personnel de fabrique ou de domesticité, complétant ces dispositions à mesure que l’expérience en établira l’insuffisance. Ce code doit être indépendant. » (Plon-Nourrit, 1911, page 168)
La Gewerbeordnung était le Code de commerce qui, extérieur au droit civil, établissait et organisait la liberté du commerce en Allemagne.
Qu’à son tour le code du travail soit indépendant…, cela voulait dire : du code civil. Pour quelle raison, une telle indépendance ? Pour éviter, affirmait le professeur Thaller, que le premier ne vienne corrompre le second. En effet, écrivait-il :
« Submergé sous la législation du travail, le Code civil souffrirait d’un véritable étouffement. Il n’aurait plus de place pour légiférer sur la famille, sur les successions, sur les contrats. Voit-on les grèves, le contrat collectif, l’arbitrage, les assurances de retraites ou d’accidents, les règlements d’atelier encombrer le Code civil, sans que ses cadres éclatent par là même ? » (page 168)
Imagine-t-on le travail partant à l’assaut de la propriété en transvasant sa force du Code du travail au Code Civil… par le biais de lois élaborées par le suffrage universel ? Ce qu’à Dieu ne plaise !
9 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON