La pensée libertarienne (4) : Critique de la conception libertarienne de la société (1ère partie)
Après la question du travail, nous nous penchons sur l'idée libertarienne de société, c'est-à-dire sa structure générale, ses institutions, ses règles ou encore sa façon de les appliquer. Puisque c'est sur ces questions que libéraux et libertariens, ou même les libertariens entre eux, s'entendent le moins, nous exposons, dans l'article suivant, les trois logiques principales : libérale, minarchiste et anarcho-capitaliste. D'évidence, cela allonge remarquablement le texte, et nous l'avons donc séparé en deux. Le premier s'occupe du droit naturel, et de sa modernisation libérale. Le second - que nous publierons dans quelques jours - du pouvoir proprement dit, et donc de ce que l'on appelle les fonctions régaliennes.
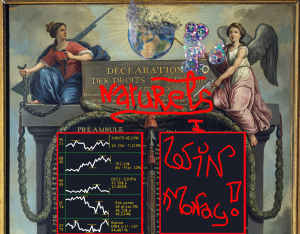
Droit naturel, pragmatisme et utopie
À partir du dix-septième siècle, le droit occupe une, sinon la place centrale des philosophies politiques d’Occident, à quelques exceptions près, comme chez Marx. Les sociétés de l’Antiquité et de la période médiévale se reposaient davantage sur la notion d’ordre. À partir d’une définition théorique, abstraite, autrement dit un concept d’ordre, on en déduisait une société idéale auquel les penseurs estimaient que la politique devait se conformer. Dit plus trivialement, on a d’abord conçu la méthode de philosophie politique selon la pratique binaire du modèle abstrait parfait et de son imitation (royaume des cieux, royaume terrestre).
Les évolutions qui surgissent dès le début de la période moderne vont progressivement rendre ce système désuet. Le religieux perd en intensité, on comprend peu à peu la Terre dans sa globalité, les sciences progressent, et l’on voit bien que l’ordre garanti par les États, les rois et les reines, les empereurs et les Papes n’y est pour rien, et ne fait que ralentir cette effervescence. On s’étonnait déjà, auparavant, que les hommes soient incapables de s’accorder sur la définition de l’ordre, alors que, finalement, les sociétés s’en sortaient bien chacune selon son modèle, tant qu’une autre ne venait pas la déstabiliser.
La naissance des États-Unis toujours, mais aussi les Lumières européennes éclipsent progressivement la pensée de l’ordre pour une pensée du droit : peu importent les modèles conventionnels des États, du moment que ceux-ci garantissent le droit des individus. L’ordre politique ne se construit pas à partir d’une idée abstraite, imaginée par une poignée de philosophes, de théocrates, et de chevaliers lettrés, mais des individus eux-mêmes, lorsque ceux-ci sont libres de mener leurs vies comme ils l’entendent. Au-delà même du principe légal essentiel, à l’origine du huitième article de la Déclaration des droits de l’homme, qui proclame que toute chose qui n’est pas interdite est autorisée, l’idée que chacun puisse choisir sa vie et son parcours se propage. La liberté de l’individu est mise au cœur de la réflexion politique.
Nous l’avons dit, les premiers libéraux se sont reconnus sur la notion de droit naturel. Les libertariens, qui n’émergent qu’au milieu du vingtième siècle, reprochent aux libéraux de leur temps une dérive positiviste, et préconisent un retour aux fondamentaux du droit naturel, quitte, peut-être à les réformer un peu. Nous devons dire un mot sur l’histoire de ce concept.
Si l’idée que le système politique doive s’accorder avec la nature est certainement aussi vieux que la politique elle-même, la notion de droit naturel, qui constate qu’il y a un certaine universalité dans les aspirations essentielles des individus, est généralement d’abord rattachée aux travaux du hollandais Hugo de Groot, dit Grotius, publiés dans la première moitié du dix-septième siècle, puis aux problèmes posés par les différentes versions de l’état de nature, chez Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau principalement, et enfin, surtout, à la tradition empiriste anglaise, représentée notamment par John Locke. Au plus large, on délimite la querelle historique de Thomas d’Aquin, qui utilise la notion mais n’en fait pas un concept à part entière, jusqu’à Emmanuel Kant, qui enterre définitivement le problème.
Dès le début, les penseurs distinguent deux catégories au sein même de la notion de droit naturel, que l’on saisit intuitivement. On sent bien qu’il existe une différence entre les phénomènes qui correspondent à mes désirs, à ce que j’estime être autorisé à obtenir, entre ce que l’on appelle "mes droits" et ce à quoi on l’oppose, que l’on appelle un peu rapidement "le devoir", qui désigne ce qui est interdit et obligatoire, et permet que les gens ne se nuisent pas dans leurs désirs et volitions.
Grotius établit deux principes, deux lois essentielles rattachées à la nature humaine : la conservation de soi, et le besoin de société. Tout le monde, dit-il, cherche à la fois à survivre le mieux possible, et en même temps à être en contact sympathique avec ses semblables, pour vivre avec eux une vie paisible. Les deux sont des pulsions naturelles, communes à tout individu, à partir desquelles le droit découle.
C’est finalement en voulant exposer plus clairement les phénomènes propres à la nature essentielle de l’homme qu’émerge l’hypothèse fictive de l’état de nature, reprise par un certain nombre de penseurs. Hobbes, dans le Léviathan, et Rousseau, dans Le contrat social et l’Émile, sont, bien sûr, ceux qui ont le plus approfondi la notion, mais Locke aussi y consacre quelques alinéas de son Traité du gouvernement civil. L’opposition entre Hobbes et Rousseau est particulièrement connue, et nous ne la résumons ici qu’en quelques phrases.
Tandis que pour Hobbes, l’état de nature désigne la guerre de tous contre tous, dans laquelle on ne s’allie que dans notre intérêt le plus égoïste, donc de façon très éphémère, et en attente de zigouiller ses alliés à la fin, Rousseau pense que l’homme est naturellement bon, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’intérêt naturel de nuire à autrui, mais au contraire, vit seul et isolé. Ils différent donc à propos de l’ambiance de l’état de nature, instable et destructrice pour Hobbes, calme et paisible pour Rousseau, mais ils s’accordent finalement sur la solitude naturelle de l’homme. La sortie de cette solitude est, par définition, celle aussi de l’état de nature : pour Hobbes, elle est relative au désir de sécurité, pour Rousseau, elle vaut pour elle-même puisqu’elle correspond au désir naturel de société (comparable au principe de Grotius). Cela, pensent-ils, justifie conceptuellement le contrat social.
Hobbes désigne comme loi naturelle : la loi de conservation, indépendamment de la société. C’est l’instinct de survie qui ne se soucie guère des autres, la loi du plus fort. La sortie de l’état de nature vient casser ce droit pour y instaurer ce que l’on appelle aujourd’hui un droit positif, une norme dont on assume qu’elle est une construction au moins en partie arbitraire, car humaine. On sacrifie notre droit naturel de conservation à l’État en échange de la sécurité en son sens le plus large.
Il est connu que Rousseau a changé sa conception avec le temps, et notamment après la publication d’un article de l’Encyclopédie de Diderot. On considère habituellement qu’il ne désigne par droit naturel que l’expression de la volonté générale, donc finalement le produit fini du processus législatif, voire politique. Autrement dit, Rousseau n’est pas non plus un naturaliste du droit, quand bien même il diffère de Hobbes.
Locke, qui écrit entre les deux, apparaît davantage comme un successeur de Grotius. Pour Locke, l’état de nature n’est ni la guerre, ni la solitude, mais plutôt une communauté d’êtres libres et parfaitement égaux. Les lois naturelles incitent les individus à la survie, mais cela ne les oppose pas particulièrement, ni ne les sépare. Tant que l’on reste à l’état de nature, ces lois demeurent implicites. La question de la répartition des biens, donc de la propriété, en tant que chose matérielle et davantage tangible que les notions de liberté et d’égalité, fait émerger la nécessité du droit et amène à la sortie de l’état de nature. C’est donc le souci de sa propriété qui sort l’homme de l’état de nature et le conduit au droit. Simplement, ce droit est naturel, puisqu’il est un processus naturel, dont la fonction est d’exprimer les lois naturelles.
Tous les trois sont des théoriciens du contrat social, des contractualistes. Ils diffèrent, certes, sur leurs définitions, mais ils aboutissent finalement à des choses assez semblables. Hobbes et Rousseau considère que le contrat marque une rupture et nécessite que le souverain, pour Hobbes, ou le peuple, pour Rousseau, pense, déduise et construise rationnellement des règles communes. Locke, au contraire, veut que le contrat soit dans la continuité de l’état de nature, mais il n’empêche que le droit est construit rationnellement par les individus.
La tension initiale entre la pulsion subjective personnelle et la nécessité rationnelle de la réflexion commune se déplace de concepts en concepts mais ne se résout jamais complètement. Le régime du droit positif, tout rationnel que soit celui-ci, conserve un fond irréductible de subjectivité dont on se sert comme prémisses alors qu’il ne peut prétendre à être tout à fait rationnel. Et sous le régime du droit naturel, force est de constater que les subjectivités diffèrent bien trop souvent quant à savoir ce qu’est celui-ci, et qu’il est nécessaire de s’accorder rationnellement et en commun pour le définir un minimum.
Néanmoins, l’histoire des démocraties modernes exprime un net déclin de la notion de droit naturel.
Avec le temps, la question des désirs premiers de l’homme a peu à peu disparu du champ de la politique pour, sous l’impulsion des philosophies de Nietzsche et de Schopenhauer, devenir l’objet des sciences psychologiques. Pour lui-même, le droit s’est ainsi dépouillé de ses caractères naturalistes pour glisser dans un régime plus positiviste.
Aujourd’hui, il n’existe quasiment plus de théoriciens du droit ou de philosophie politique, à l’exception notable des libertariens, qui considèrent le concept de droit naturel comme pertinent, ou même efficace. Sur le plan empirique, nos codes civils et pénaux sont des manuels très complexes qui nécessitent une assiduité et une rigueur de plusieurs années d’études, et même : si nul n’est sensé ignoré la loi, personne ne la connaît complètement. Il est indéniable que notre régime a une vision davantage positiviste que naturaliste du droit.
En France, la chose n’est pas très surprenante, au vu de ce que nous avons dit sur Rousseau. Au bout du compte, les régimes successifs de la première à la cinquième république, en passant par les trois du milieu, les deux Empires, les deux restaurations, et la monarchie de juillet, on a considéré que la volonté générale était une expression de la nature, et que l’augmentation du droit positif n’allait pas à son encontre, bien au contraire.
Aux États-Unis, en revanche, patrie du libéralisme, le rejet, ou du moins, la méfiance de l’État est un pilier irréductible de l’identité américaine, ne serait-ce qu’en raison de l’histoire de son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni qui, faut-il le rappeler, est avant tout une histoire de taxes. La progression du régime positiviste n’a pu se faire que dans un recul de cette méfiance, et une certaine désillusion quant au droit naturel.
Comme nous l’avons dit dans notre chronologie, le dix-neuvième siècle est une période de capitalisme sauvage où l’État, certes, progresse, mais ne régule pas grand-chose, et où se succèdent des crises économiques assez spectaculaires. Nous invitons le lecteur à regarder par lui-même la nature des Paniques successives de 1837, de 1857, de 1873, de 1893 et surtout de 1907, de la Grande Dépression, et leurs conséquences sur les populations. Nos crises d’aujourd’hui n’envoient jamais tant les gens à la mort. L’interventionnisme résulte de cette période, même s’il ne prend son essor qu’à partir des années trente. On a ainsi progressivement considéré que l’État devait prévenir ces crises et garder pour lui la possibilité d’intervenir économiquement.
L’étude en détail de ces points est l’affaire d’un long travail, et concerne davantage notre essai. Sa pertinence, pour notre thème général, émane du fait que les analyses de ces crises divergent selon libertariens et libéraux, et qu’elles indiquent, par cela, les prémisses de leur séparation, qui ne débute que dans les années trente. Ici, nous voulons seulement dire un mot sur la conséquence majeure de la crise de 1907 : la création de la Banque fédérale américaine, dite Fed, que les libertariens d’aujourd’hui ont en horreur.
L’histoire est aujourd’hui connue et admise par tous : le projet de loi, adoptée en 1913 a été essentiellement rédigé dans le plus grand secret, trois ans plus tôt, en 1910, par les plus grands capitalistes (ou leurs émissaires) de l’époque, de Rockfeller à J. P. Morgan, sur Jekyll Island (Georgia, US), au cours d’une réunion digne des plus grands fantasmes complotistes. Ces mêmes capitalistes avaient, en 1907, injecté, par milliards, de leurs propres liquidités pour sauver le système bancaire, et entendaient éviter que cela se reproduise en créant donc à cet effet, une Institution publique de relance monétaire.
Ce sont les libéraux eux-mêmes qui ont renforcé l’État américain, pour éviter que le système ne s’écroule. Par pragmatisme. On le comprend, les libertariens d’aujourd’hui s’intéressent tout particulièrement aux crises du dix-neuvième siècle, et n’ont pas du tout la même interprétation que les libéraux de l’époque. Aux causes différentes qu’ils dégagent, ils en déduisent d’autres solutions, sans intervention de l’État, comme par exemple la libéralisation de la création monétaire. Et puis, dans la mesure où les solutions que l’Histoire a développé étaient étatistes, et donc fondées sur une idée d’ordre, les libertariens les dénoncent comme utopistes. À l’opposé, les libéraux devenant keynésiens par pragmatisme au milieu du vingtième siècle, ils ont rompu avec ce qu’ils estimaient eux aussi être des utopistes. Ainsi se sont-ils renvoyés la balle.
Le déclin de la pensée keynésienne n’a pas entamé le rejet libertarien des libéraux. En revanche, comme nous l’avons dit, ce n’est plus trop réciproque, et les libéraux s’inspirent principalement de leurs frères plus radicaux. Simplement, c’est toujours par pragmatisme, par esprit pratique qu’ils pensent l’État, car ils y ont davantage accès et peuvent ainsi le modifier de l’intérieur.
Nous nous éloignons de la notion de droit naturel, mais ainsi que nous l’avons indiqué, elle est considérée, par le plus grand nombre, comme dépassée et aujourd’hui archaïque. Seulement, on peut se demander comment, dans cette perspective, les libertariens ont pu adapter cette notion au vu des impasses dans lesquelles elle nous a menés. Il est bien gentil de vouloir être naturel, mais comme personne n’est d’accord, on sait pas ce que ça veut dire, et il faut bien qu’on en cause, et qu’on mette les choses au clair.
Pour comprendre la position libertarienne, il faut comprendre que la notion de droit naturel est intégrée dans un système logique que l’on appelle la praxéologie, et qui n’a plus grand-chose avoir avec les théories classiques du dix-huitième siècle.
Praxéologie et marché
Nous l’avons dit, la revendication du pragmatisme est la chose la plus répandue parmi les hommes d’État. Dans la mesure où le désaccord est la règle première des relations inter-partisanes, il n’y a rien de surprenant à ce que l’on trouve aujourd’hui que ce mot ne signifie plus grand-chose. Si chacun se veut pragmatique mais que l’on ne sait pas s’accorder sur ce que cela signifie, le mot n’a plus de sens. Les accusations mutuelles d’utopisme entre libéraux et libertariens sont particulièrement symptomatiques de cette vidange de sens. Assez étrangement, il est très rarement rappelé que les économistes libéraux utilisent pourtant le mot pragmatique dans le contexte particulier de la praxéologie, c’est-à-dire une science, un système scientifique dont l’objet est l’action humaine, ou la praxis, pratique directe d’une théorie.
Initiée par des économistes de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, puis abandonnée peu à peu par manque d’efficacité, la praxéologie a été, depuis, entièrement refondée par Ludwig Van Mises, le père du minarchisme, dans son œuvre essentielle L’Action Humaine, Traité d’économie, publié en 1949, et prolongée ensuite par les libertariens et ce que l’on appelle l’école néo-libérale, c’est-à-dire les libéraux post-keynésiens. Au risque de paraître provocateur, nous tenons à dire que, de même qu’on ne peut comprendre le marxisme sans avoir au préalable appris, un peu du moins, la logique du matérialisme historique, nul ne peut prétendre saisir le sens complet de la pensée libérale contemporaine sans savoir ce qu’est la praxéologie. On peut, bien sûr, s’en faire une idée intuitive assez poussée avec, par exemple, les éléments que nous avons donnés en définition, mais, puisque, comme la plupart des systèmes de pensée, le libéralisme a su fonder sa propre méthode logique, son système scientifique de référence complet qui permet de dépasser le stade intuitif, il est nécessaire de la développer dans ce contexte qui est le sien.
1-La méthode praxéologique
Mises distingue tout d’abord les réflexes automatiques de l’action humaine, qui est, au contraire, intentionnelle.1 Cligner des yeux lorsqu’un objet s’en approche trop, tendre la jambe à la suite d’un coup sur le genou, ou même respirer, tous ces mouvements ne sont pas des actions, puisque l’on ne peut que difficilement dire qu’ils sont la résultante d’une intention. Cela exclut, certes, un certain nombre d’événements, mais cela n’englobe pas pour autant les actions issues des erreurs de jugement, ni même toutes les actions qui résultent de l’inconscient. On peut certes provoquer un événement sans l’avoir voulu, mais la plupart du temps, c’est tout de même un dispositif intentionnel qui l’a déclenché, même s’il n’était pas adéquat à la situation : on voulait quelque chose, mais c’est une autre qui est arrivée, on n’a pas fait exprès.
Pour Mises, la plupart de nos mouvements sont des actions que l’on peut qualifier de rationnelles dans la mesure où elles répondent logiquement à une intention, un désir, une envie, ou même une pulsion que l’on peut nommer, identifier, décrire, si nécessaire avec l’aide de la psychanalyse2. Quelque soit le jugement que l’on peut attribuer à une intention, par exemple négativement quand il s’agit de tuer son voisin simplement parce qu’il fait trop de bruit, l’action en elle-même n’est pas irrationnelle, puisqu’elle entre dans un système logique : agacement du bruit, analyse de la situation, jugement qu’il y a davantage d’intérêt à tuer l’auteur du bruit que toute autre action, et passage à l’acte.
Chaque action signifie une décision, une prise de position, donc un certain jugement. Or, il n’y a pas de jugement sans référence – on ne juge pas sans qualifier – et cette relation du jugement à la décision se nomme, sous la plume de Mises, l’intérêt. Dans la lignée des empiristes anglais, ou de Rousseau, Mises considère que l’intérêt est toujours d’abord dirigé vers l’ego. Nous pouvons, bien sûr, souhaiter le bien de nos proches, mais c’est toujours dans notre intérêt. Même le sacrifice de soi, qui est tout de même rare, ne se fait jamais sans un intérêt propre : un parent est prêt à mourir pour son enfant, puisqu’il n’est pas dans son intérêt de vivre avec une lourde culpabilité, une effroyable honte, ou même le regard des gens, etc.
Parallèlement à cette définition préalable nécessaire, il faut noter que Mises explique, dès l’introduction de son livre, que la praxéologie a été rendue possible par l’émergence progressive du marché, c’est-à-dire de la cartographie des échanges économiques3. Sans la possibilité d’une vue globale sur les mouvements économiques, la science de l’action, telle que définie par Mises, manque de matière stable et ne peut, en quelque sorte que s’en tenir à un traité de la nature humaine, à la manière de David Hume. Sur ce point, nous renvoyons le lecteur aux remarques méthodologiques de Hume dans son introduction du Traité de la Nature Humaine, livre incontournable (et particulièrement plaisant à lire) : une science de l’homme ne peut se satisfaire du protocole expérimental des sciences de la nature, puisque l’on ne peut reproduire deux fois la même expérience, et que le simple fait pour un humain d’être sujet d’une expérience trouble la spontanéité des intentions.
En s’accordant sur Mises, le marché résout ce problème, puisqu’il instaure un poste d’observation semblable à celui des dispositifs expérimentaux, sans établir pour autant de protocole troublant, puisqu’il a pour objet le réel, l’actualité, et l’histoire, et non une situation créée artificiellement. L’évolution du marché exprime, en fin de compte, l’histoire des actions, l’histoire des intérêts humains.
On voudrait objecter ici que le marché ne s’occupe que des échanges économiques, et que ceux-ci n’englobent guère tout le champ de l’action humaine. Mais, il faut déjà observer qu’au delà-des échanges, le marché prend aussi en compte, ne serait-ce qu’indirectement, la consommation des richesses. Il ne dit certes rien de la consommation privée, mais il en rend compte dans la mesure où la richesse disparaît alors de la carte des échanges. Sous ces auspices, le champ des phénomènes qui influencent le marché s’élargit considérablement.
Par ailleurs, Mises précise bien que le marché ne couvre pas toutes les actions humaines, en tant que telles. Face à la sphère explicite de marché, il existe une sphère que l’on peut qualifier de privée, et qui comporte un certain nombre d’événements qui ne concernent que très indirectement l’ébullition des échanges mondiaux. L’exemple le plus parlant est sans doute l’affection (gratuite bien sûr) que se portent les êtres vivants par l’intermédiaire des câlins de toutes sortes. Il paraît presque surréaliste de vouloir intégrer ces échanges dans le système de la Bourse. La praxéologie de Mises ne nie pas cela. Au-delà, même, l’économiste autrichien précise qu’il existe de la valeur affective, que nous attribuons aux choses, comme par exemple à un monument historique, et qu’elle ne peut être représentée sur le marché.
Ce qui ne peut faire l’objet d’une évaluation objective ne peut s’intégrer au marché, et reste du domaine privé. La valeur affective du monument historique, que l’on dit pourtant publique, se réfère aux subjectivités des individus, et quand bien même il suscite des débats municipaux, ceux-ci ne porteront que sur les valeurs économiques : son entretien, son ouverture au tourisme, sa publicité. S’il s’agit d’en faire un pur éloge affectif, même sur la place du village, cela ne concerne plus que les subjectivités pour elles-mêmes.
Simplement, l’économique encercle ces valeurs et ces échanges d’affection, et même les conditionne, la plupart du temps. La santé, par exemple, n’a pas de prix, puisqu’elle signifie la vie d’un homme, valeur irréductible et sacrée aux yeux – au moins – des libéraux, mais tout ce qui permet de la maintenir et de la rétablir lorsqu’elle s’use, comme le travail du médecin, la production des outils dont il se sert, ou encore la recherche fondamentale qui le fait progresser, possède une valeur économique qui conditionne l’échange4. La valeur affective est donc, en quelque sorte, supportée par les valeurs économiques.
Concrètement, la praxéologie s’établit en reprenant les catégories du marché. Avant tout, on pose l’existence des agents économiques, comme les particuliers, les entreprises, les institutions, les associations, etc. Ce sont eux les auteurs des actions. Précisons ici tout de suite que Mises pose l’individualisme comme axiome méthodologique nécessaire5 : il faut considérer qu’un agent est un atome irréductible. Il peut, bien sûr, s’agir d’un groupement de personnes, comme l’entreprise, mais celle-ci parle d’une seule voix, d’une part, et, d’autre part, elle est répartie en proportions clairement définies entre des individus propriétaires et responsables, comme nous l’avons déjà longuement rappelé à l’article précédent. Il est, a contrario, impossible de compter sur un agent composé d’une multiplicité indéfinie, dont on ne peut établir clairement les intentions ou les intérêts, même avec l’aide de la psychologie.
Ensuite, on pose l’existence des richesses, biens ou services, et on les définit, non par leur nature, mais selon leur statut : consommable (et éphémère comme la nourriture, ou persistant comme les outils), transformable (en vue d’être vendu ou consommé), ou échangeable. Ces catégories, bien sûr ne sont pas exclusives, et bien des richesses sont à la fois transformables, échangeables et consommables, mais il semble, pour autant, qu’il n’y en ait pas une qui échappe à ce classement. Les richesses s’accompagnent, sur le marché, d’une valeur monétaire, établie, nous l’avons dit, par l’équilibre entre offres et demandes.
Enfin, ces catégories permettent de représenter les actions humaines les plus importantes pour l’analyse sociétale : produire, transformer et mélanger (création de richesses), acheter et vendre (échange), détruire et consommer. Il faut d’évidence inclure les services dans la production : un chauffeur poids lourds ou une femme de ménage ne produisent, certes, pas d’objet, mais ils rendent un riche service à la société, service qui s’évalue, comme toujours, entre sa nécessité et l’offre proposée, et se vend comme n’importe quelle autre richesse.
2-Implications politiques
Intuitivement, on sent bien que la plupart des événements, et des actions humaines peuvent se représenter sur le marché, et que ce qui lui échappe n’a de toutes façons pas vocation à être un sujet de société, ou du moins de politique, d’organisation. Plus encore, les points de définitions exposés par Mises sur l’action humaine prennent davantage de sens. Nos actions, qui expriment nos intérêts, côtoient et se mêlent à une foule d’autres actions, et le marché, qui les répertorie et les rend lisibles dans leur globalité, permet finalement de les optimiser. Si le marché raconte l’Histoire des intérêts personnels, la praxéologie en est la science. Elle établit des théorèmes à partir des phénomènes historiques du marché. Pour comprendre un événement particulier, elle remonte les fils de sa causalité jusqu’à définir des règles. Bien sûr, dans le cadre de phénomènes jugés négatifs, elle sait aussi estimer ce que les intérêts désignent alors comme meilleure situation et propose, à cet effet, des solutions pratiques précises.
Dès lors, il semble que cela soit dans l’intérêt de chacun que le marché englobe un maximum d’informations, et parvienne à convertir dans son langage tout ce qu’il peut traduire. Une valeur économique qui n’est pas incluse dans le système du marché peut faire l’objet d’une estimation intuitive très pertinente, mais n’aura jamais la précision et la rectitude que peut lui apporter l’intégration au système général des échanges. En intégrant une valeur au marché, non seulement on la rend objective, mais en plus, on permet au marché d’être plus riche et plus précis dans sa cartographie de la société. Plus il y a de richesses et d’agents sur le marché, plus celui-ci est proche de la vérité, plus les agents peuvent optimiser leurs décisions, puis donc augmenter la création de richesses, et enfin la prospérité générale de la société – admettons-le c’est séduisant. Les valeurs affectives elles-mêmes ne s’en verront qu’optimisées. Si tout ce qui conditionne leur bon déroulement est sans cesse amélioré, les richesses subjectives le sont également. « C’est parce qu’il y a certaines choses qui ne s’achètent pas que tout le reste s’achète avec » une carte de crédit – publicité connue.
Si tout ce qui peut être intégré au marché y est introduit, alors ce dernier devient l’agora moderne, le lieu des grandes décisions. Pour nombre de libertariens, le marché est, en fin de compte la place de la politique, et de la démocratie naturelle : toute personne qui prend une initiative et se donne les moyens de la mener à bien apparaît sur le marché, l’influence alors, et participe à la vie de la société. Plutôt que les grands projets soient le monopole d’une caste politique, ils sont soumis, dans une société libertarienne, à la libre initiative des entrepreneurs, et aucune règle ne vient entraver la manière dont ceux-ci veulent les introduire sur le marché. Seules les règles naturelles de l’offre et de la demande, de la concurrence, et, toujours, de non coercition, structurent l’émergence des grands projets.
A fortiori, les libertariens proposent d’abandonner la politique des idées et des valeurs communes pour laisser aux seuls individus l’initiative de produire, partager, diffuser, défendre, et surtout réaliser des projets pour soutenir ces idées et ces valeurs à une échelle où les autres peuvent en profiter. Alors que les gouvernements modernes, sensés représenter tout le peuple, sont obligés d’agir aux noms d’idéaux dont l’universalité reste supposée, et dont on est finalement certain qu’elle est inexistante, les entrepreneurs de la société libertarienne n’ont pas à se conformer à des idéologies prétendument universelles, et n’ont qu’à se concentrer que sur le projet qui leur tient à cœur.
De cette façon, on résout également ce problème, insupportable aux yeux des libertariens (mais aussi des anarchistes classiques), du décalage entre les représentants et tous les individus qui composent la société. Avant même le folklore justificatif qu’invoquent les femmes et hommes d’État pour justifier leurs projets et leurs pratiques, la méthode même du scrutin électoral, du vote des représentants ne permet qu’une estimation peu précise des aspirations des individus, et amènent donc nécessairement à un décalage entre la prétendue volonté du peuple et la réalité objective. La mise à l’écart des représentants sur les questions des grands projets annule complètement ce décalage, et rend aux vrais réalisateurs des projets, c’est-à-dire les entrepreneurs, tous les moyens de leurs décisions.
En résumé, nous devons avant tout garder à l’esprit que la praxéologie, bien que peu citée par les politiques est une constante de tous les livres libéraux d’économies, et qu’elle porte une valeur naturaliste comparable à celle exprimée dans les textes classiques, tout en l’ayant radicalement modernisée. Le droit naturel de Grotius, celui de prospérer et de mener une vie paisible, qui a mué, après les transformations successives de l’Histoire de la pensée, en volonté de puissance chez Nietzsche, puis qui, déposé sur le bureau des psychanalystes, s’est vu traduit en pulsions d’eros et de thanatos, revient sur le terrain normatif, par le biais de la praxéologie, sous la forme de l’individualisme méthodologique : chacun va à son intérêt personnel.
C’est finalement dans l’établissement de cette science, dans l’intérêt des informations qu’elle délivre, et dans son efficacité que le libéralisme fonde la légitimité du droit naturel, et en contrepartie, qu’elle démontre l’illégitimité de l’interventionnisme de l’État. La praxéologie, l’étude des actions humaines n’a plus besoin de formuler l’expression du droit naturel, et s’inspire avant tout d’une logique psychanalytique. Nul besoin de donner le contenu de ce que les individus recherchent, celui-ci représente toujours l’intérêt personnel que se fait cet individu. Voilà ce qu’il y a de naturel : l’activité, l’ensemble des actions humaines, des décisions prises par intérêts, des échanges économiques et de leurs conséquences.
À l’opposé, les interventions étatistes sur le marché, comme la limitation des prix, les taxes, les monopoles font office de limitations artificielles au sein du mouvement auto-généré par le marché. Ce sont des obstacles comme un rocher sur la route, que l’instinct humain pousse à contourner, ou détruire. Elles apparaissent un peu comme ex nihilo sur le marché, elles n’ont rien de naturelles, et pour cause, elles ne représentent pas des intérêts personnels, mais une estimation de l’intérêt collectif, donc fausse, et forcément à l’encontre des intérêts individuels. Pire, elles brisent la neutralité du marché et lui donnent une coloration idéologique.
3-Critiques
C’est justement sur ce point, la neutralité du marché, que nous voulons entamer notre critique. Par neutre, il faut comprendre que la cartographie des échanges, dans la mesure où elle est exacte, ne peut être l’objet d’un jugement moral, ni émettre elle-même un jugement moral, une discrimination. C’est pourquoi, ainsi que Mises le souligne, on ne peut pas faire de reproches au marché. Ce ne sont pas les cartes qui font les colonisations violentes, mais les méchants explorateurs qui les utilisent. Prenons garde ici : la métaphore de la carte ne va pas plus loin, puisque le marché est en perpétuelle évolution sous l’action des individus, et que c’est là sa finalité, tandis que la carte n’a pas cette vocation.
La neutralité du marché émane surtout du fait qu’il dit la vérité, dit ce qu’il se passe, et qu’il n’émet pas de jugement moral comme par exemple lorsqu’un échange est déséquilibré. Si, d’ailleurs, celui-ci est issu d’un chantage, le marché ne peut le dire, et, comme nous verrons dans le paragraphe suivant, il est nécessaire d’exercer une vigilance extérieure à ce marché pour prévenir et réprimer les actions violentes.
Plus encore, la neutralité du marché se vérifie de façon empirique. Nous invitons le lecteur qui ne connaît rien à la Bourse à s’inscrire gratuitement sur un site de simulation boursière en ligne, un jour d’ennui. Il y verra avec quelle indifférence les plus grandes entreprises de la santé, de l’informatique, de l’alimentation, ou du loisir sont entassées, par ordre alphabétique, et présentées seulement en fonction de leur rentabilité. On ne sait ce que vendent la plupart de ces entreprises, mais l’on peut jouer avec elles autant que l’on veut. Autrement dit, le marché est, pour lui-même indifférent à ce qu’il représente, et ceux qui l’utilisent sans s’informer par des sources extérieures peuvent y spéculer sans jamais savoir à quoi leurs investissements correspondent.
En outre, même les libertariens sont contraints de constater l’existence de phénomènes propres au marché, que l’on qualifie souvent d’effets secondaires, comme par exemple la bulle spéculative. Sa structure est connue : une spéculation enthousiaste sur une valeur attire une plus forte spéculation, et s’auto-référence à l’excès, jusqu’à ce que le cours atteigne une valeur absurdement élevée, et que tout le monde vende en panique de telle sorte que cela se répercute violemment sur tout un secteur de l’économie.
Conformément à leur empirisme, les libertariens considèrent que les bulles spéculatives sont avant tout causées par les risques excessifs que prennent les spéculateurs, et qu’ils ne prendraient pas s’ils n’étaient pas certains que l’État viendrait les sauver par la suite. S’il y a probablement du vrai dans cette assertion, elle n’a qu’une efficacité très relative puisqu’elle se fonde sur une supposition qu’elle ne peut vérifier (« s’il n’y avait pas d’État pour les sauver » – on note au passage la proximité avec la structure de l’état de nature), et sur laquelle on peut donc dire n’importe quoi.
Surtout, le problème n’est pas là, mais dans le fait que le marché, bien qu’il ne soit pas la cause intentionnelle des bulles spéculatives et de leur explosion, en est néanmoins une cause matérielle. Sans le marché, il n’y a pas d’auto-référencement possible, ni de hausse spéculative excessive. De même, le détachement entre la valeur folle et la réalité n’est rendu possible que par la neutralité du marché : on ne spécule pas sur l’objet de la valeur mais sur la valeur elle-même jusqu’à en oublier l’objet.
Comprenons : le marché est si neutre qu’il neutralise. D’évidence, cela porte une influence cruciale à la valeur affective que Mises isolait pourtant volontiers. Rien n’empêche qu’il y ait comme un engouement excessif et éphémère sur l’économie, par exemple, de la santé, que la bulle éclate et qu’il en résulte des prix monstrueux de telle sorte que beaucoup de gens ne puisse plus se payer de soins. Si cela ne condamne pas pour autant le marché, cela suppose néanmoins qu’il faille pallier à ce type de phénomènes, et donc qu’on ne peut le laisser totalement libre.
Surtout, on peut se demander comment la valeur affective peut avoir un statut juridique dans un système libertarien. Par définition, elle n’apparaît pas sur le marché, elle n’a pas de valeur économique correspondante, bien qu’elle soit, dans certains cas, considérée comme une propriété. Dans le cadre de l’amour entre individus, la question juridique n’a certes pas d’importance, mais on peut s’interroger pour les autres exemples donnés par Mises.
Pour la santé, nous savons bien que le système libéral, tel qu’il est en place aux États-Unis, estime qu’une personne qui ne peut pas payer n’a pas être soigné, et qu’on laisse les pauvres mourir dans les ambulances quand on se rend compte qu’ils n’ont pas de sécurité sociale. Autrement dit, le serment d’Hippocrate n’existe pas dans une société libertarienne, et l’attachement particulier à la valeur affective de la vie que Mises et les libertariens revendiquent sans cesse apparaît comme incohérent et même hypocrite. S’ils qualifient la vie d’un individu de valeur d’exception, ils ne proposent aucun moyen exceptionnel pour la conserver. La qualification est donc purement théorique, vide de sens et de signification, et la valeur de la vie demeure comme toutes les autres valeurs qui n’ont pas d’estimation financière : elle est négligeable.
Pour le monument historique, il est curieux que Mises ne s’attarde pas dessus et élude la question en même temps qu’il la pose6, mais, s’il y a litige quant à savoir si l’on doit ou non détruire un monument historique pour y installer une canalisation, et que les opposants à la destruction sont minoritaire, il ne fait guère de doute que Mises ne les considérerait pas légitimes. Peut-être Mises voit dans le vote une solution, mais il ne le dit pas. Rien, dans la praxéologie libérale, ne vient fonder une valeur juridique à ce que Mises appelle la valeur affective, et qui puisse contrebalancer les valeurs économiques admises sur le marché en cas de litige.
Au bout du compte, la remarque de Mises sur la valeur affective n’a pas de pertinence tant qu’elle n’est pas soutenue par un effort financier. Un seul amoureux d’un monument historique riche suffit, par un simple acte d’achat, à stopper tout processus de destruction, tandis qu’un million sans argent restent impuisants. Sans le fric, l’affect relève du privé, et reste une valeur triviale, négligeable sur le marché, et donc complètement soumis à ses mouvements.
Globalement, on perçoit bien que la démarche libertarienne est de congédier tout ce qui paraît idéaliste de la structure de la société : les interventions verticales sur le marché des échanges et l’entrepreneuriat, dites étatistes, qui ont besoin de justifications idéologiques, tout comme les valeurs affectives, qui ne peuvent prétendre à l’objectivité qu’en invoquant de prétendues valeurs universelles, tout aussi « idéologiques ». Simplement, cette démarche est vaine puisqu’elle s’appuie elle-même sur un certain nombre d’idées abstraites qu’elle estime, sans preuve aucune, universelles, et des hiérarchies arbitraires de valeurs et de désirs.
En conférant à la praxéologie le statut de science de l’action, puis en lui attribuant le marché comme objet premier, la logique libertarienne crée déjà une hiérarchie entre ce qui se trouve sur le marché et ce qui ne s’y trouve pas. Or, toutes les actions représentées sur le marché n’ont pour cause que le désir de capitaliser de l’argent, et tous les désirs périphériques y sont entièrement soumis. Si le marché ne veut pas nier l’existence des échanges non-économiques, l’exhortation libertarienne à le laisser plus libre que le reste a pour conséquence que ces échanges et ces valeurs périphériques, souvent affectifs, soient totalement conditionnés par l’économie. Autrement dit, la pensée libertarienne sous entend que le désir de gagner de l’argent doit soumettre les autres désirs, ou encore que toute décision qui vise à gagner de l’argent vaut mieux que toute autre décision.
Cela, les libertariens ne veulent pas le reconnaître, parce que, évidemment, c’est présenté comme une idéologie, et c’est très difficilement défendable. Ayn Rand, notamment, met un point d’honneur à critiquer ceux qui considèrent l’argent comme une fin plus que comme un moyen. Mais c’est soutenir l’absurde, puisque c’est là la définition même du capitalisme, dont se revendiquent toutes les familles libérales.
1Pour tout l’article, nous nous référons à l’exemplaire de L’Action Humaine, de L.V. Mises paru aux éditions de l’Institut Coppet, traduit par Raoul Audouin. Pour la note, la référence est I,I,1 p23-25.
2AH LVM, I,1,4 p32
3A.H., LVM, Introduction,1, p 11-13
4Sur ce point, Marx dit des choses similaires
5A.H., LVM, I,2,4 p58
6A.H., LVM, ib. cit., III,12, 2 p 260-261. C’est frappant comment le problème n’est pas résolu.
7 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










