Le culot ! Edwy Plenel, sur Radio Suisse Romande, fait des journalistes les « dépositaires d’un droit de savoir des citoyens » !
Que dirait-on d’un individu qu’on entendrait répéter en battant des bras et en sautillant sur place : « J’échappe à la pesanteur, j’échappe à la pesanteur ! » ? On n’a pu s’empêcher d’y penser en écoutant, lundi 24 novembre 2008, sur Radio Suisse Romande, Edwy Plenel, ancien directeur de la rédaction du Monde et actuel directeur du site Médiapart. Il était interviewé à propos d’un livre sur lui (1) par Martine Galland et Alain Maillard qui animent chaque matin de 9h30 à 10h une émission appelée « Médialogues », un joli jeu de mots qui mériterait de passer dans la langue (2).
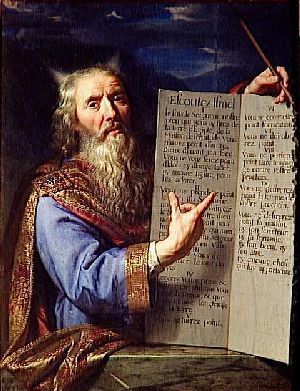
I - Une profession de foi utile mais insuffisante
E. Plenel a prononcé pas moins de sept fois en quelques cinq minutes les mots « indépendance » et « indépendant ». Dans une période où les médias traditionnels sont accusés d’être inféodés aux pouvoirs de toute nature et ne s’en cachent pas, on comprend que dans une brève interview, le journaliste insiste sur la règle première qui doit fonder son crédit : « Je défends, a-t-il martelé , une liberté radicale, une indépendance radicale de ce métier. »
Le journaliste s’est dit en conséquence attaché aux « règles déontologiques » de la profession qui en découlent, « (ses) règles de précaution, (ses) règles de vérification ». : « Il faut faire très attention à l’information fausse, à l’information inexacte et à ses ravages », a-t-il averti en mesurant la lourde responsabilité qu’une telle conception du métier implique. Le mot « responsabilité » est, lui, revenu par quatre fois.
Quel lecteur se plaindrait de cette profession de foi ? Elle n’est pas surprenante. C’est son contraire qui le serait. C’est bien le moins qu’un journaliste affirme son indépendance et assume la responsabilité qui lui incombe. Mais cela suffit-il à garantir la qualité de l’information du point de vue du récepteur ? Un code normatif, qu’il soit civil, pénal ou déontologique, peut bien être solennellement proclamé. Est-il pour autant toujours respecté par ceux qui s’en réclament ? L’erreur est humaine.
II- Une théorie de l’information fondée sur des erreurs
En revanche, cette promesse de liberté, d’indépendance et de responsabilité serait plus crédible si elle ne s’accompagnait pas d’une représentation erronée de "la relation d’information" : on reconnaît celle que diffuse inlassablement la vieille théorie de l’information chère aux médias, sans se soucier de l’expérimentation qui la contredit. E. Plenel ne devrait-il pas commencer par appliquer à cette théorie ses « règles de précaution et de vérification », s’il veut être pris au sérieux ? Au lieu de cela, il en épouse hardiment les erreurs.
1- La prétention à saisir « un fait » et non « la représentation d’un fait »
Il qualifie par exemple de « plus factuel, distant, indépendant » le livre qui lui est consacré, pour l’opposer à celui de Pierre Péant et de Philippe Cohen, « La face cachée du Monde », qu’il juge « à charge ». L’ennui est que l’adjectif « factuel » prête à confusion : car il prétend renvoyer, comme toujours, selon le dogme de la théorie, à une saisie directe d’ « un fait » quand seule « une représentation de ce fait » est accessible, de même qu’on n’accède jamais au « terrain » mais seulement à une « carte » du terrain.
Cette représentation erronée de "la relation d’information" est confirmée par un autre engagement de M. Plenel : « Notre responsabilité est à l’égard de la vérité », décrète-t-il. Or, le mot « vérité » est un mot trop moralement chargé pour ne pas égarer les esprits. Comme l’adjectif « factuel », c’est un mot qui entretient l’ illusion selon laquelle la réalité est saisissable dans son intégralité sans médias déformants interposés : et pourtant, si discrets soient-ils au point qu’on les oublie, c’est bien par les cinq sens, les mots et les images que les informations sont perçues et exprimées. Et elles le sont tout autant par les visages, les postures et les silences.
2- Le silence gardé sur les critères de sélection des informations
Or, M. Plenel croit pouvoir rassurer son lecteur, on l’a dit plus haut, en lui promettant d’observer des « règles de précaution », des « règles de vérification » : « Il faut faire très attention, prévient-il, à l’information fausse, inexacte et à ses ravages ». Très bien ! Nul n’en disconviendra surtout quand on garde en mémoire les bobards invraisemblables répandus par les journaux pendant la guerre de 14-18. On en a traité dans un article récent (3).
Mais est-ce bien le seul problème qui se pose ? Est-ce même le premier par ordre chronologique ? En dehors de la vérification rigoureuse prescrite, qui va de soi, ne convient-il pas de décider d’abord si une information peut être diffusée ou non ? Sur quel critère prendre cette décision, sinon l’intérêt de l’émetteur qui ne saurait livrer volontairement une information susceptible de lui nuire ? On prête à Churchill une formulation différente du même "principe de la relation d’information" : « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu’elle devrait toujours être protégée par un rempart de mensonges ». On l’a bien compris : la survie d’un individu ou d’une nation fait du « mensonge » - négatif sur le plan moral - une information positive puisqu’elle permet de protéger la vie. Or n’éprouverait-on pas le besoin de se protéger en temps de paix ?
3- La prétention à vivre en apesanteur
Sous cet angle, on comprend mal cette autre croyance de M. Plénel qui heurte de plein fouet ce "principe fondamental de la relation d’information". Se définissant comme « un journaliste indépendant plutôt de gauche », il tente de résoudre ainsi le paradoxe : « L’indépendance, explique-t-il, suppose que s’il y a des affaires qui dérangent la gauche, il faut les sortir, il faut les publier (…) Il faut penser contre soi-même, c’est notre devoir, notre responsabilité d’aller jusqu’au bout de cette indépendance. Je l’ai montré, ajoute-t-il, sous Mitterrand, Chirac, Sarkozy, sous tous nos princes, nos monarques républicains ».
- L’expression « penser contre soi-même » a certes du panache. Mais peut-on se livrer à l’exercice qu’elle suppose, en dehors de son cabinet de lecture personnel ? N’est-ce pas prétendre se délivrer comme par enchantement de la loi de la pesanteur en battant des bras que de croire pouvoir affranchir l’information des contraintes d’airain qui pèsent sur elles, qu’il s’agisse des contraintes exercées par 1- les motivations de l’émetteur, 2- les moyens de diffusion, en particulier financiers, et 3- les propriétés du récepteur.
- On peut très bien vouloir « penser contre soi-même », c’est-à-dire contre ses intérêts, mais ne pas avoir les moyens de passer à l’acte sauf à s’autodétruire. Comment critiquer par exemple dans un journal un annonceur publicitaire qui le fait vivre ? Quant aux exemples personnels que M. Plenel offre pour preuve, ils méritent un examen plus attentif. Choisir par exemple, comme il l’a fait, quand on est un « journaliste plutôt de gauche », de montrer que le commandant Beau dans « l’affaire des Irlandais de Vincennes » a été une victime, présentée injustement et cyniquement par les membres de la cellule antiterroriste de l’Élysée comme le responsable des faits, nuit manifestement au président Mitterrand. Mais n’est-ce pas défendre un principe de justice supérieur que viole ce gouvernement de gauche ? En quoi est-ce "penser contre soi-même", surtout quand ce gouvernement d’union de la gauche est composé de plusieurs familles politiques, dont il est légitime de préférer et d’avantager l’une plutôt que l’autre.
N’est-il pas d’ailleurs arrivé à M. Plenel, sauf erreur, en mars 2008, de choisir de passer sous silence la parution d’un livre sur son site Médiapart, comme celui du même Jean-Michel Beau qui s’interrogeait précisément sur sa conduite lors du procès des « écoutes téléphoniques de l’Élysée », le 26 janvier 2005 ? Ce faisant, M. Plenel n’a-t-il pas fort normalement obéi au "principe de la relation d’information" selon lequel nul ne livre volontairement une information susceptible de lui nuire ? (4)
Cette théorie de l’information erronée, défendue par E. Plenel, postule que les journalistes exercent un magistère alors qu’ils ne peuvent y prétendre. Il ose même soutenir, dans cette interview, qu’ils sont les « dépositaires d’un droit de savoir des citoyens » ! Par grâce divine ? Par autopromotion ? Il est vrai qu’à la faveur de déclarations solennelles des droits de l’homme, européenne ou universelle, le droit à l’information est inscrit dans le marbre. Mais comme tout droit, à l’instar de la maxime paradoxale du Canard enchaîné , selon laquelle « la liberté de la presse ne s’use que si l’on ne s’en sert pas », « la liberté de recevoir ou de communiquer des informations » (5) ne peut exister que si le citoyen en use. Mais les journalistes ne sont pas pour autant « dépositaires de ce droit de savoir ». Tout au plus peuvent-ils aider à l’exercer. Mais pour ce faire, il faudrait qu’ils commencent par cesser de répandre, comme le fait E Plenel, les sempiternelles erreurs de leur théorie promotionnelle de l’information qui désorientent leurs concitoyens. Paul Villach
(1) Laurent Huberson, « Enquête sur Edwy Plenel – de la légende noire du complot trotskyste au chevalier blanc de l’investigation » (Éditions Cherche-Midi).
(2) RADIO SUISSE ROMANDE, émission « Médialogues » , « Enquête sur l’enquêteur : Edwy Plenel, directeur de MédiaPart et ancien rédacteur en chef du Monde, évoque l’ "Enquête sur Edwy Plenel" de Laurent Huberson. » Lien : http://www.rsr.ch/la-1ere/medialogues.
(3) Paul Villach, « Tous ces bobards dans les journaux, pendant la guerre de 14-18 : un cas d’école », AGORAVOX, 18 novembre 2008.
(4) Jean-Michel Beau, « L’affaire des Irlandais de Vincennes – l’honneur d’un gendarme – 1982/2008 » (Éditions Fayard).
La question était de savoir si l’ex-capitaine Barril était à l’origine de la divulgation des premières transcriptions d’écoutes téléphoniques de l’Élysée au journal Libération. J.-M. Beau raconte qu’en mars 1993, au moment du verdict du procès en diffamation que Barril a intenté à É. Plénel et au journal Le Monde, il est à ses côtés dans la salle d’audience, quand ils assistent tous deux à un échange de documents entre l’ex-capitaine Barril et un journaliste de Libération. Or, deux jours plus tard, le journal publie les premières écoutes. Il n’est donc pas impossible que l’échange dont ils ont été témoins, avait trait aux écoutes.
Or, à sa grande surprise, au cours du procès des « écoutes », Jean-Michel Beau entend, le 26 janvier 2005, É. Plénel répondre au tribunal que, s’il a bien assisté à un échange de documents entre Barril et un journaliste de Libération, il ne peut affirmer qu’il s’agissait d’écoutes téléphoniques. « Au terme de l’audience, écrit Jean-Michel Beau, je m’explique assez sévèrement avec Edwy Plenel auquel j’indique que je ne comprends pas sa volte-face. Depuis quand lit-il à travers les enveloppes ? Comment aurait-il pu voir, lui, ce que contenait ce pli (…) Il préfère partir vite… car il a un rendez-vous ! » (p. 534). Devant la cour d’appel en décembre 2006, E. Plenel viendra à nouveau au secours de l’ex-capitaine Barril en confirmant ses propos de 2005 devant le tribunal : « C’est ma conscience qui me dicte de vous délivrer ces précisions ; (…) Je ne voudrais pas qu’il arrive à M. Barril ce qui est arrivé à Jean-Michel Beau. » (p. 547) L’ex-capitaine Barril n’en sera pas moins condamné.
(5) Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
17 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










