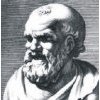Le populisme sarkozien, maladie infantile du libéralisme
Les politiques libérales sont exsangues car incapables de créer des emplois, cela malgré l’argent public dilapidé en « baisses de charges » et en subventions ; leur discrédit est apparu au grand jour lors du référendum sur le projet constitutionnel. D’où, derrière Sarkozy, cette fuite en avant des ultralibéraux dans un projet « populiste. » Le populisme a pour effet principal d’ensevelir la question politique (c’est-à-dire le « que faire ? ») sous la problématique des « valeurs » (quelles sont les « vraies » valeurs ?). Il exploite l’angoisse de déclassement, appelle à la préservation de certains privilèges et dissimule l’égoïsme de classe en le drapant de « valeurs éternelles ».
Le « rationnel » et « l’irrationnel » en politique.
Si le « que faire ? » est au centre de l’action politique, la politique devient une sorte de « travail », c’est-à-dire une activité rationnelle qui ajuste des objectifs et des moyens (par exemple, pour relancer la croissance, il faut se déterminer entre une politique de l’offre, une politique de la demande ou un mélange des deux). Quand le politique devient cet « analogon » du travail, la question des « valeurs morales », sans être négligeable, devient secondaire. Dans le monde du travail, la compétence prime sur les valeurs, ce que chacun de nous sait fort bien, puisque chacun de nous travaille quotidiennement, et sans encombre particulière, avec des collègues de travail qui sont loin de partager nos valeurs. Les valeurs qui priment sont celles qui favorisent le travail collectif (écoute, négociation, discipline librement consentie, etc.), tandis que les valeurs strictement "morales" deviennent très secondaire (êtes-vous pour ou contre le voile islamique, le string, l’avortement, l’uniforme à l’école, etc.) L’objectif collectif (le travail) permet de transcender les éventuels clivages liés aux diverses « valeurs » de chacun.
L’idéologie populiste est extérieure à la culture du monde du travail. Elle s’enracine dans le monde domestique et patriarcal : « Je veux leur dire que la France dont je rêve est une France qui ne laisse tomber personne, une France qui est comme une famille où le plus faible, le plus vulnérable, le plus fragile a droit a autant d’amour, autant de respect, autant d’attention que le plus fort, une France où même, dans celui qui n’a plus de force, on reconnaît la dignité de l’homme et du citoyen. » déclare Sarkozy lors du discours du premier tour. Le populisme survalorise les valeurs auxquelles les individus se doivent d’adhérer pour manifester leur appartenance au groupe. Malgré la cynique invocation d’une solidarité naturelle à la famille, en réalité, ce type de discours induit un partage entre ceux qui font partie de la « famille »... et les « autres », c’est-à-dire ceux qui n’honorent pas convenablement le nom du père et qui sont la cause de tout le mal.
Le populisme, participation électorale et choix « en négatif »
Pour une part, la participation massive à l’élection reflète une anxiété générée par la menace d’exclusion sous-jacente à l’idéologie populiste. Cette participation est saine, mais elle ne contient pas d’éléments « positifs », en ce sens qu’elle ne manifeste pas d’adhésion à un projet (c’est-à-dire à l’équivalent d’un « objectif de travail » qui mobiliserait la société civile). Pour certains, voter, sans savoir pour qui et pourquoi, a été le moyen de manifester leur inscription dans la communauté et pour eux un moyen de conjurer l’angoisse d’exclusion. Pour d’autres, le vote a exprimé une « négativité » : les uns votant « Mme Royal », contre les « valeurs de Sarko qui mènent au fascisme », les autres votants « M. Sarkozy », contre les « valeurs soixante-huitardes qui mènent la France au déclin », et d’autres encore « M. Bayrou », contre les « archaïsmes de la droite et de la gauche qui paralysent le pays » Cette réaction participative est traversée par la peur d’être, soi-même, « exclu » au motif qu’on n’ a pas les « bonnes valeurs », les « bons signes d’adhésion » à la « tribu » des Français.
Le populiste, c’est le rejet de l’altérité (le rejet de ceux qui n’ont pas les mêmes « valeurs ») et, au bout de ce délire qui vide la politique de tout contenu, il y a l’électeur, sommé de choisir entre la « mâlitude sarkozienne » et la « féminitude ségolienne », il y a le rejet de l’altérité première, celle du sexe.
Une « tri-partition » chaotique du champ politique
Mais ce choix « en négatif », introduit quelque chose de neuf : une rupture avec l’approche « consumériste » de la politique, où l’électeur est censé choisir le « meilleur » candidat, comme on choisit la « meilleure » lessive. L’électeur indique moins un choix pour un « projet salutaire » et un « homme providentiel » - auquel nul ne croit plus -, mais marque les contours des alliances qu’il juge ou non possibles.
Nous assistons à l’éclatement de la « partition » politique « gauche-droite » au profit d’une « tri-partition » entre un « pôle progressiste », un « pôle libéral » et un « pôle national ». Autrement dit nous en sommes revenus à la troisième république, qui était animée par ces trois forces politiques. Nous sommes définitivement sortis du « consensus de la résistance » qui avait banni le « pôle national » (en raison de la collaboration) du champ politique institutionnel. Avril 2002, puis l’intégration des « valeurs » et d’éléments du programme FN au projet de Sarkozy ont consacré ce retour des « nationalistes » dans l’espace politique institutionnel. En tout cas, cette élection met au jour qu’il y a trois « pôles » et que chacun d’eux est en mal de réunir seul une majorité d’électeurs.
Pour sauver l’ultralibéralisme, le populisme sarkozien propose l’alliance d’une fraction des « libéraux » et avec des « nationalistes. » Mais cette alliance est fragile en raison des tendances « protectionnistes » et « anti-européennes » des nationalistes, tendances qui sont contraires au noyau dur du projet ultralibéral de M. Sarkozy.
En face, la coalition qui pourrait tenir tête, réunissant une fraction des « progressistes » et des « libéraux démocrates » n’est pas, non plus, clairement dessinée (mise en minorité de Strauss-Kahn au sein du PS ; Bayrou non qualifié pour le second tour ; un groupe parlementaire UDF dépendant de l’UMP, qui n’a pas la stature pour jouer le rôle de « parti charnière » qu’avaient les « radicaux » de la IIIe République).
Le caractère hypothétique des alliances conduit à une tentation autoritaire, pleinement assumée par M. Sarkozy.
L’indétermination institutionnelle de la Ve République « quinquennale »
L’autoritarisme est un aventurisme politique lourd de menace. Aucune réforme n’est durable sans consensus. Le (la) président(e) qui voudrait gouverner sans majorité claire ne peut d’ailleurs pas compter sur la « solidité » des institutions. Nul ne sait si la « Ve République quinquennale » est porteuse du présidentialisme (une majorité contrainte à suivre un président) ou d’un retour au parlementarisme (du fait de la coïncidence des mandats, le président ne peut plus efficacement menacer de dissoudre la Chambre). L’expérience chiraquienne laisse interrogatif : Chirac détenait tous les pouvoirs, et pourtant, un Sarkozy, soutenu d’abord par une majorité du groupe parlementaire, puis, devenu chef de l’UMP, a pu, en toute impunité, avilir la fonction présidentielle. Si Sarkozy a pu déstabiliser Chirac, un autre, demain, affolé des conséquences électorales d’une politique de réforme autoritaire (municipales, cantonales, etc.), saura aussi bien organiser la fronde parlementaire.
Terroriser les faibles (« il faut étrangler les poulets pour faire peur aux grands singes » comme dit le proverbe chinois) et « brûler ses vaisseaux » sera nécessaire à Sarkozy, s’il veut une majorité parlementaire servile qui approuve des réformes qui ne bénéficieraient pas d’un minimum de consensus social. Les réformes non soutenues échouent nécessairement et bientôt on prendra conscience des perspectives quasi révolutionnaires qu’ouvre une telle politique. Car les révolutions se font contre les « tyrans » qui échouent, et jamais contre les parlements (à qui l’on ne peut reprocher que leur éventuelle impuissance). Et quand je parle de révolution, je n’évoque pas une baroque révolution avec des drapeaux rouges et des couteaux entre les dents. Je parle des « révolutions » comme on en voit dans les pays de l’Est, en Argentine et ailleurs, de mouvements collectifs de refus généralisé. Ces pays, plus fragiles, nous montrent un devenir possible pour notre société.
Comment réformer ?
Bon nombre de réformes profondes de la société française résultent d’un compromis passé entre, d’une part, une majorité politique qui unissait des progressistes et des libéraux (le front populaire qui unissait la SFIO et les radicaux ; le gouvernement de la Libération) et, d’autre part, une pression populaire (la grève de 36 et la pression organisée par les résistants de base).
C’est autour de ce contour politique unissant les progressistes, les libéraux démocrates et la pression populaire que se noue l’espace de dialogue où des compromis peuvent être passés durablement. Les compromis, en France, émergent de la tension. La France s’est jusqu’ici révélée incapable, sinon en usant de la voie référendaire (élection du président au suffrage universel, Maastricht), d’organiser l’espace de dialogue pacifié entre le peuple et ses gouvernants. La question de la « participation » devient, donc, aujourd’hui essentielle. Mais il faut avoir le courage de l’envisager comme un approfondissement et une rationalisation de la politique de décentralisation de telle sorte qu’elle rapproche élus et citoyens et non sous la forme d’un « gadget » politique. C’est là un chantier immense. La question des réformes passe donc, d’une part, par la clarification d’un projet (quelle relance de l’économie ?) et, d’autre part, par la définition des conditions d’établissement d’un dialogue régulé entre le peuple et ses gouvernants.
Il existe dans le « pacte présidentiel » de Mme Royal des éléments d’un projet rassembleur. Mais ce pacte manque encore de lisibilité. Espérons que les quinze jours à venir nous permettront d’y voir plus clair. Il faut éviter aussi deux écueils : d’abord de verser dans la haine de « Sarko », car cet homme, comme Le Pen, jouit et se nourrit de la haine qu’on lui voue. Il faut regarder M. Sarkozy moins comme un ennemi que comme le « symptôme » d’une crise politique et sociale profonde ; son délire populiste et son rejet de l’altérité symbolisant l’absolu manque de confiance d’un corps social qui peine à trouver un projet collectif et rationnel. L’autre tentation est celle de « passer son tour » et de laisser M. Sarkozy gouverner et échouer pour profiter ensuite de l’inéluctable vague de mécontentement. Mais la politique du pire n’est pas une politique. On ne réforme pas efficacement un pays effondré par des divisions.
12 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON