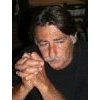Messieurs les commentateurs, que faites-vous de votre liberté ?

On dit que les universitaires vivent accrochés à leurs statuts et leurs privilèges, et que la pensée en pâtit. Sentence exagérée sans doute, mais qui se calque à la perfection aux mandarins du journalisme. Tandis que l’on peut aisément concevoir que l’élite de la finance défende un modèle indéfendable, que les patrons non élus de l’UE en fassent de même, on ne voit pas pourquoi l’élite journalistique considère comme gravé dans le marbre cette obsession qui n’a de comparable que le fanatisme religieux d’un autre âge.
Prompte à critiquer la presse anglo-saxonne, elle reste aveugle au fait que de l’autre côté de la Manche, on n’hésite pas, même chez les convertis au libéralisme dérégulateur, à se référer à tous ceux qui le critiquent, quand elle ne le critique pas elle-même de la manière la plus virulente. Pourquoi donc personne en France ne parle de tous ces prix Nobel, tous les économistes de renom, tous les banquiers ou administrateurs de renom du FMI et de la Banque Mondiale qui critiquent, à la manière de Hollande et même de Mélenchon, l’attitude de la BCE ou de la Commission sur l’essentiel (inflation, croissance, financiarisation de l’économie) ? Pourquoi les journalistes eux-mêmes « évitent » de se référer à toute voix dissonante de la doxa financière ? Pourquoi ils évitent de souligner les aspects franchement immoraux (la loi du plus fort), et d’insister sur « la réalité ambiante », tandis qu’elle est mise en cause aussi bien par les faits que par des professionnels qui ont le mérite d’avoir prévu la crise et ses métamorphoses ? Pourquoi ils ne commentent pas la propension des riches de choisir l’exil fiscal, laissant aux classes moyennes tout le poids de la fiscalité ? Pourquoi ajouter des adjectifs déplaisants à volonté dès lors qu’un homme politique essaie d’introduire plus de moralité dans la jungle financière ? Pourquoi ils prennent pour argent comptant les déclarations du président de la République quand ce dernier déclare que les paradis fiscaux, c’est fini ou que la crise est derrière nous ? Pourquoi ils évitent de parler de l’expérience islandaise qui se déroule sous nos yeux depuis bientôt trois ans ? Pourquoi ils ne disent rien sur les impasses politiques en Grèce, résultat concret de la politique d’austérité imposé à ce pays ? Pourquoi il n’existe pas de réflexion sur le fait que la démocratie est malmenée en Italie et en Grèce par des formules de représentation qui n’ont rien à voir avec la démocratie ? Pourquoi les résultats des élections espagnoles ne sont jamais traitées comme une irruption de la finance dans le processus démocratique ? Pourquoi il n’y a pas une seule critique sur le fait qu’en Grèce et en France, le marché se dit prêt à déclarer la guerre si les résultats ne sont pas ceux qu’il désire ? Que le FMI et l’UE cachent mal leurs préférences et même essaient d’influencer les scrutins ? Est-il interdit à un journaliste de la télé ou un éditorialiste de se prononcer négativement sur ces procédés ?
Le Financial Times a une explication, simpliste et crue : …Comme le journalisme français a atteint la classe moyenne supérieure, il s’est glissé encore plus près du pouvoir. Les ministres et les journalistes chevronnés d’aujourd’hui ont souvent étudié ensemble à Sciences-Po, vivent dans les mêmes quartiers de Paris, mangent ensemble et parfois couchent ensemble. Le FT ne se prive pas, par ailleurs et dans le même article, de souligner que la quasi totalité de la presse française est entre les mains de trois-quatre milliardaires, tous copains du président. Et que leur objectif n’est pas de gagner de l’argent mais d’influencer le citoyen français. C’est donc normal que le président français « n’aime pas ce journal » mais, bien sûr, pas pour les raisons qu’il met en avant.
Mais ces raisons sont-elles suffisantes ? Sans doute pas. Il existe une paresse intellectuelle, un laisser-aller jouisseur dans les arcanes des plateaux et des directions de rédaction, une logorrhée autosuffisante bien payée, qui ne cherche plus rien, ne se questionne sur rien, se contentant, comme dans les précieuses ridicules à commenter le superficiel et surtout à ne pas contester la fatalité, une partie des journalistes s’étant, TV oblige, transformé en amuseurs publics. Quant à la presse, écrite ou sur le Web qui continue à faire son travail normalement, elle est tout simplement ostracisée par la cour des commentateurs des petites phrases et la jouissance éphémère qu’elles procurent. Si au moins ces phrases étaient judicieuses, spirituelles, corrosives et policées à la fois, comme celles d’un Paul Morand (je choisis exprès un commentateur de la vie profondément conservateur) ils nous offriraient un petit quelque chose, une réflexion sur l’insignifiance.
Ce n’est même pas le cas.
Si enfin, je devais trouver un symbole à la couverture médiatique de cette campagne, je choisirais, sans hésitation, le voyage imaginaire du président au Japon. Le mensonge banalisé, qui fait tout au plus sourire, comme si le premier des français était un petit garçon voulant tremper son doigt dans un pot de confiture interdit. Le mensonge occulté, comme si mentir sur Fukushima, indisposer le Japon, juste pour un bon mot, valait la peine. Le mensonge éphémère, qui se perd dans les limbes des commentaires en quelques heures. Le mensonge utilitaire, assumé, compris comme tel et donc non critiqué. Le mensonge tout court, qui devrait générer des commentaires et des rapprochements sur toute autre affirmation, sur le sérieux, la crédibilité, la parole tenue d’un candidat et qui pourtant ne soulève aucun commentaire.
36 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON