Mmes Dati, Yade et Amara : de la « diversité » comme masque de l’uniformité
La présidence de M. Sarkozy aura tenu à exhiber dans la composition de son premier gouvernement ce qu’il est politiquement correct de nommer aujourd’hui « la diversité ». Ce délicieux euphémisme, sans couleur ni saveur, conforme à la reconfiguration de la réalité familière aux stratèges en communication, désigne tout ce qui n’est ni "blanc" ni "Français de longue date" et qui, par opposition, constituerait « l’uniformité » : on évite ainsi les appellations historiquement marquées de « gens de couleur », de « noirs », de « beurs », de « Français issus de l’immigration ». Trois personnes, et, qui plus est, trois femmes, ont été chargées dans le gouvernement d’en être les symboles : Mmes Dati, Yade et Amara. Que restera-t-il de l’expérience ?
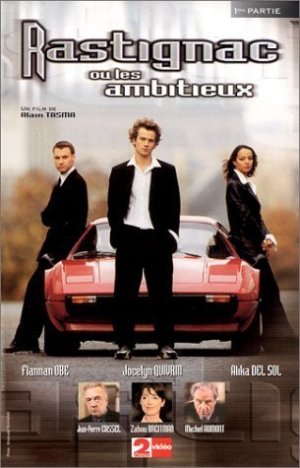
Des exemples dans le passé
Sans doute existe-t-il des exemples passés où un poste ministériel a été occupé par un ressortissant issu de l’immigration ou des anciennes colonies françaises : on songe à M. Kofi Yamgnane, nommé en 1991 Secrétaire d’État aux affaires sociales et à l’intégration dans le gouvernement de Mme Cresson, et plus récemment à M. Azzouz Begag, ministre chargé de la promotion de l’égalité des chances, dans le gouvernement de M. de Villepin.
Mais il faut remonter à la Quatrième République et au début de la Cinquième pour en voir un figurer à un poste de responsabilités important, comme Mme Dati, propulsée à celui de ministre de la justice. M. Félix Houphouët-Boigny, de Côte-d’Ivoire, était ministre dans le gouvernement de M. Guy Mollet en 1956. M. Léopold Sédar Senghor, du Sénégal, a lui aussi occupé des fonctions ministérielles dans les gouvernements de M. Edgar Faure et de M. Debré. Surtout, M. Gaston Monnerville, originaire de la Guyane, a été Président du Conseil de la République devenu Sénat à partir de 1958, et ce, sans discontinuer, pendant 21 ans, de 1947 à 1968.
Une instrumentalisation par bon plaisir du prince
Mmes Dati, Yade et Amara laisseront-elles le même souvenir ? À la différence de leurs prédécesseurs, ces trois dames ont commencé par où ils ont terminé, du moins en France, car deux d’entre eux ont été longtemps à la tête de leur pays après la décolonisation de 1960. Quoiqu’on puisse penser de la suite de leur carrière, ces personnalités s’imposaient par leurs qualités personnelles et n’étaient pas dépourvues de compétences. Peut-on en dire autant du trio sarkozyste chargé de promouvoir « la diversité » ? Ne sont-elles pas au contraire des figures ordinaires de l’uniformité ? À quoi ont-elles dû leur promotion ministérielle ? À leur expérience, à l’autorité acquise dans des fonctions précédentes ? À cet âge, la trentaine et le début de la quarantaine, a-t-on eu le temps de faire ses preuves, quand on n’est ni Rimbaud, ni Mozart, ni Schubert ?
Elles n’ont dû leur place qu’au bon plaisir du prince et au rôle que sa stratégie leur a assigné ! Dans un article du 3 mars 2008 sur Agoravox, intitulé « Le cas Dati : intrigues et ambitions », Olivier Bailly prétend que M. Minc aurait convaincu M. Sarkozy en ces termes : « Pour faire avaler aux magistrats une réforme de la justice aussi dure, la « beurette de Chalon » sera parfaite. Ils ne pourront pas l’attaquer sans être soupçonnés de racisme » ! Et on pourrait ajouter que pour faire face à la crise des banlieues et au renforcement de la répression judiciaire, trois dames issues de « la diversité » étaient les plus désignées pour être envoyées au front. Rien ne vaut que d’opposer à un groupe pour le discipliner qu’un individu issu de ce groupe. C’est tout le drame de ces dames, non pour elles, mais pour l’image qu’elles auront donnée de cet accès à de hautes fonctions ministérielles comme symboles de « la diversité ».
Une stratégie du recrutement pour incompétence
Il est, en outre, une règle qui n’est pas propre aux origines ethniques, mais aux origines sociales qu’un certain angélisme refoule et occulte pour ne pas désespérer. Moins on est qualifié pour un poste pour lequel on est néanmoins recruté, plus on a l’âme courtisane : on est tellement reconnaissant à son autorité d’avoir été distingué. On l’observe à tous niveaux, y compris à celui du simple professeur aux études plus que modestes engagé comme contractuel, ou du professeur médiocre aspirant à devenir chef d’établissement ou inspecteur. Pour ces gens, c’est évidemment un sommet inespéré auquel ils ne peuvent prétendre. Avec un si maigre bagage, comment parvenir à s’y hisser au mérite ?
Seulement, pour une clique de hiérarques, c’est le plus sûr moyen de disposer d’hommes et de femmes dociles que de les coopter dans une claque de courtisans, qu’ils portent tailleur, redingote ou complet-gilet-veston avec oignon au gousset. Quelle revanche ! Les compétences n’ont rien à voir avec leur ascension sociale. Nul n’en a cure ! Ce qu’il faut, ce sont des femmes ou des hommes liges prêts à tout exécuter, si nécessaire au prix de leur dignité. En échange, un modeste pouvoir leur est gracieusement conféré. Et, comme le disait déjà Chamfort au 18ème siècle, dans une société française où l’autorité est adulée et la loi méprisée, cette parcelle de pouvoir leur donne gratuitement la reconnaissance sociale tant convoitée à laquelle ils n’avaient aucune chance d’accéder par leur seule médiocrité.
Deux exemples
On a, dans un article précédent, fait état d’une expérience personnelle en Guadeloupe entre 1973 et 1976 qui aide à comprendre ce qui se passe plus de trente ans plus tard, puisque rien n’a changé (1). C’est dire comme la méthode est efficace ! Les postes de responsabilités administratifs, politiques et juridictionnels pouvaient bien être confiés à des antillais, les violations de la loi n’en étaient pas moins assurées au détriment de leurs compatriotes conformément au désordre établi.
On garde le souvenir d’un autre exemple, cette fois, à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Le juge du tribunal de police appartenait à « la diversité » et ça n’a pas changé grand chose. Il lui était soumis, le 11 octobre 1995, le cas d’un inspecteur de l’Éducation nationale qui avait rédigé un rapport jugé calomnieux à son encontre par un instituteur : « Le directeur de l’École indique, avait écrit l’inspecteur, que Monsieur S. assure convenablement son service et a un contact en apparence normal avec les enfants. Le directeur émet cependant des réserves sur les relations avec les collègues de l’école, perturbées, dit-il, par les attaques répétées de Monsieur S. contre la hiérarchie de l’administration de l’Éducation nationale ».
Or, dans une lettre du 19 juin 1995, le directeur avait soutenu qu’il n’avait jamais dit ça ! L’inspecteur l’avait alors convoqué, le 10 août 1995, dans son bureau et lui avait demandé de mettre sa signature au bas d’une lettre prérédigée démentant son démenti ! La preuve de cette subornation de témoin avait été apportée à l’audience d’une main de maître par l’avocat : un régal de descente aux enfers marche par marche et à reculons d’un pauvre directeur, pantin entre les mains de son inspecteur ! Le malheureux avait dû admettre qu’il n’avait même pas de machine à écrire correspondant à la police de caractères employés dans la lettre.
Le juge n’en avait pas moins débouté l’instituteur. Le jugement du 8 novembre 1995 est un morceau d’anthologie donnant lieu à une lecture des diverses acceptions du mot « apparence » pour écarter d’autorité et sans démonstration la calomnie par insinuation que l’allégation de l’inspecteur comportait. Pourtant, quand on écrit qu’un instituteur « a un contact en apparence normal avec les enfants », ne laisse-t-on pas entendre qu’au-delà de « l’apparence », il y a « une réalité » bien différente ? Et dans ce cas particulier, n’insinue-t-on pas une relation « anormale », malsaine avec des enfants ? Et laquelle ? La subornation de témoin n’avait pas davantage été retenue par le juge qui n’y avait vu qu’un libre et spontané changement d’avis du témoin !!! C’est vrai, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis !
Un conseiller en arrivisme : "Le neveu de Rameau"
L’illusion est de croire que, quand il accède à une fonction d’autorité, l’opprimé d’hier ne pourra qu’être respectueux de la loi pour avoir souffert lui-même de ses violations. Diderot, dans « Le Neveu de Rameau » a pourtant prévenu : « À tout, il n’y a que le coup d’oeil qu’il faut avoir juste, » assure le Neveu, jurant que si d’aventure, il accédait à une place, il ferait « comme tous les gueux revêtus ; (il serait) le plus insolent maroufle qu’on eût encore vu. » Il rendrait « les avanies » qu’on lui a fait subir. « Faire sa cour, morbleu ! faire sa cour, conseille-t-il ; voir les grands ; étudier leurs goûts ; se prêter à leurs fantaisies ; servir leurs vices ; approuver leurs injustices. Voilà le secret. (…) La vie que je mènerais à leur place, avoue le Neveu, est exactement la leur. » Est-on si loin de ce qu’on sait de Mme Dati, interrogée dans le reportage d’Antoine Vitkine et Taly Jaoui, intitulé « « Dati, l’ambitieuse », diffusé sur Arte, mardi 3 mars ?
Il faut s’y résigner, l’ouvrier qui devient patron n’offre aucune assurance de se montrer plus respectueux des personnes et de la loi. Au contraire, serait-on tenté de dire, surtout s’il ne doit pas son ascension sociale à ses seuls mérites. « La diversité » dans ce cas finit par n’être que le masque de « l’uniformité de l’arrivisme ». Car avec les arrivistes, on en voit de toutes les couleurs ! Paul Villach
(1) Paul Villach, « La Guadeloupe aujourd’hui... comme il y a trente ans ! « L’ire de l’édile » et l’île de délire », AGORAVOX, 19 février 2009.
51 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 Dati et Yade, c’est Pipo et Dimbo, l’histoire ne retiendra rien d’elles.
Dati et Yade, c’est Pipo et Dimbo, l’histoire ne retiendra rien d’elles.

