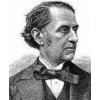Qui sont les prêteurs finaux ?
Après "otages" et "blocage de la circulation", une nouvelle contribution sur le sens des mots : leurs emplois, leurs employeurs, et le galvaudage organisé.
On serait tenté de dire que ce sont « les marchés », terme mystérieux pour désigner la « main invisible ». On serait corrigé et invité à choisir un terme plus précis comme « les investisseurs ». Et les investisseurs, c’est vous et moi, tous ceux et toutes celles qui ont un peu d’argent placé, de côté, une assurance vie…Et on est invité à chanter : « Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette » (même les femmes). Nous serions tous prêteurs, comme agents économiques, et tous emprunteurs, comme assurés sociaux.
On n’est pas forcé d’adopter ce point de vue qui, pour paraître modéré, n’en est pas moins un peu totalitaire. On peut apporter un peu de contradiction, de polémique et de passion. On peut dire que les prêteurs sont les possédants ; et que les emprunteurs sont les possédés (dans les deux sens du terme) et bientôt les dépossédés. Mais ces termes qui fleurent la lutte des classes peuvent faire mal en entrant dans certaines oreilles qui n’entendent que la modération.
On peut aussi pour élucider ce mystère des prêteurs finaux évoquer quelques points de vue, question de changer de perspective tout simplement. Nous en avons sélectionné deux : l’un sur la dette mondiale, l’autre sur l’Etat social.
La dette mondiale et les dettes nationales, publiques et privées.
« De son propre aveu, Yves Simon, professeur à Dauphine, reconnaît qu’il est difficile de faire la part entre les opérations sur produits dérivés ayant pour objet de couvrir des risques de l’économie réelle et celles ne répondant qu’à des stratégies de spéculation. A la vérité, cet aveu ne lui coûte pas cher, cette ignorance est même des plus opportunes. Elle évite notamment de voir ce que tout le monde pressent aisément, à commencer par les opérateurs de ces marchés : l’écrasante part des transactions spéculatives par rapport aux opérations de couverture « réelle, et dont on peut avoir une intuition à simplement mettre en regard les 43 trillions (milliers de milliards) de dollars du PIB mondial et les 676 trillions d’encours de produits dérivés. »
Frédéric Lordon qui signait ces lignes en 2008[1] n’est pas vraiment un économiste consensuel. On peut le trouver cependant sur le net.[2] Le « professeur à Dauphine » avec qui il se montre insolent ferait autorité sur la question des produits dérivés[3].
Notons seulement le rapport entre le PIB mondial et les encours des produits dérivés : de 15 à 16. Il suffit à jeter un regard différent sur les dettes, leurs taux, ceux qui en détiennent les créances, ceux qui doivent rembourser et ce qu’ils doivent rembourser.
L’état social et la mondialisation
C’est le titre d’un article de Jean Fabien SPITZ publié par La vie des idées[4] le 2 novembre 2010.
Il y analyse une idée fort répandue : « La seule solution serait donc de couper dans les dépenses sociales, de réduire les déficits publics qu’elles entraînent, et de restaurer par ces moyens douloureux mais indispensables la compétitivité de notre pays sur le marché mondial. Ce raisonnement est simple et les dirigeants de la droite française ne comprennent pas qu’il y ait encore des égarés pour ne pas en admettre la pertinence et pour défendre des « acquis sociaux » dont le coût entraîne sans cesse plus notre pays vers le bas. »
Cette idée est fondée sur le constat suivant : « au milieu des années 1970, la répartition de la richesse produite entre le capital et le travail s’était considérablement modifiée au bénéfice du second. Progressivement, et non sans pleurs et grincements de dents, on revient à une situation « normale » et les pays qui sauront le plus rapidement et le plus énergiquement tailler dans leurs dépenses sociales sont ceux qui retrouveront le plus vite le chemin de la compétitivité et donc de la prospérité. »
Mais, au sujet de cette « normalité », il remarque que « toute structure de la répartition de la richesse – celle qui résulte prétendument du seul jeu des initiatives privées comme celle qui existe lorsque l’État social est en place – sont le produit d’un système institutionnel, d’un ensemble de dispositions législatives et juridiques qui sont un choix politique et qui ont pour effet de dire quelles sont les capacités des différents acteurs économiques et sociaux à attirer à eux une part plus ou moins importante des richesses produites. »
Et que « la répartition des ressources est un effet de la législation, et il n’existe pas de société sans institutions, pas de société qui ne serait rien d’autre qu’une série d’accords privés sans règle collective contraignante qui en impose le respect. La position par défaut n’existe pas : si les dividendes des actionnaires sont indemnes de toute taxation, cette situation n’est pas plus normale ni plus « naturelle » que la situation inverse dans laquelle les bénéfices sont taxés de manière à financer l’état social. »
Il enfonce même le clou en écrivant : « personne n’est le maître de quoi que ce soit sans le secours d’une règle qui le lui attribue, donc sans une décision collective qui statue que telle personne possède un droit exclusif sur tel élément de la richesse produite, et qu’il peut exiger que les autres se soumettent aux conditions qu’il aura lui-même choisies pour leur permettre d’y avoir accès. »
Et en rappelant que les « biens n’appartiennent pas « naturellement » à ceux qui les ont en mains indépendamment d’une sanction sociale sans laquelle la notion même de propriété n’aurait aucun sens. »
Ce ne sont là que des banalités de base exprimées en leur temps par Adam Smith et Karl Marx (appropriation des biens, lutte de classes, instauration d’un droit sanctionnant une domination, etc…). Mais en ces temps de confusion, notamment intellectuelle, il était bon de les rappeler.
Même si, dira-t-on, ce sont là de vieilles lunes. Face à elles, il y a l’innovation, qui fait marcher le monde et qui fait du monde un grand marché. On distingue l’innovation technologique et l’innovation financière, entre autres. Mais on n’a pas assez souligné l’innovation sémantique. Ainsi spéculation : ce mot du XIV ème siècle était relatif à l’étude, à la recherche abstraite, à la philosophie. Depuis le XVIII ème siècle, il est entré dans le domaine du commerce et de la finance. Ce mot qui avait le sens de perdre son temps en futilités a pris aujourd’hui celui de gagner beaucoup d’argent en un instant. Etonnant, non ?
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON