Sarkozy, Royal et le règne des bouffons
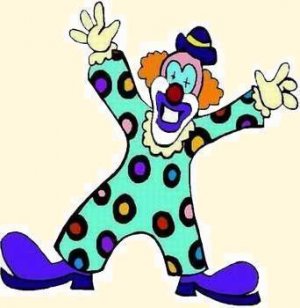
Un pays, la France, une scène, les médias, une pièce de théâtre, la politique. Et une vedette principale, Nicolas Sarkozy, qui occupe la scène selon un scénario écrit au fil du déroulement de l’action alors que quelques plans séquences sont déjà dans les tiroirs du jeu politiciens, notamment avec les institutions. Le théâtre politique joué sur la scène médiatique a été marqué par un emploi très intense du premier rôle qu’est le président. Les analystes ont compté à peu près 130 heures en un trimestre sur les six chaînes hertziennes. C’est ce qu’on appelle une stratégie d’occupation, ou plutôt une tactique puisqu’il est question d’être positionné à un moment donné à une place. Mais quel est cet espace qui est occupé ? Ne serait-ce point, dans une certaine mesure, le vide, ou du moins du presque vide. Comme si la gent médiatique avait délaissé un certain horizon intellectuel, un contenu de sens, pour laisser place à l’apparition, l’épiphanie, mais pas en tant que support du religieux, une épiphanie censée jouer sur les émotions et conquérir les âmes du public en mobilisant leurs affects.
Autre moment théâtral, celui de la campagne participative de Ségolène Royal qui, hier soir face à Arlette Chabot, évoqua quelques anecdotes et notamment le fait que les gens n’aient pas applaudi quand elle proposa les 1 500 euros net pour le Smic d’ici à cinq ans. Et de gloser sur le pourquoi de cette absence d’adhésion. Voilà une conception bien étrange de la politique. On teste la nécessité d’une proposition de gouvernement en mesurant l’intensité des applaudissements. Là encore, le jeu des affects. Et cette interrogation sur le vide jouant ici en sens inverse. Dans une certaine mesure, on se demandera si dans cette campagne politique, Ségolène Royal n’a pas canalisé en quelque sorte le vide. Tout simplement parce que quand la pensée et le concept se « désubstantialisent », il ne reste plus rien à capter sauf un pseudo vide recueilli à partir des émotions citoyennes. Ce n’est pas rien puisque c’est une chaleur toute humaine mais la thermodynamique politique n’a pas encore trouvé son Carnot capable de trouver l’équation permettant de produire du concept à partir de ce phlogistique émotionnel. Et c’est pareil dans le domaine des colères étudiantes récentes. On ne peut pas en faire un concept politique en les canalisant.
Ces deux courtes évocations illustrent cette idée de la politique du vide et du vide politique présent à notre époque. Attention, il ne s’agit pas d’un vrai vide car on assiste plutôt à un débordement émotionnel. Ce n’est que du vide selon les critères modernes concevant la politique sur des bases plus intellectuelles, le concept, la raison, le conflit dialectique, le débat démocratique, la confrontation d’idées... Bref, une ère que Debray nomme graphosphérique, qui va grosso modo de Hegel à Habermas, et dont la dernière grande figure fut sans doute Mitterrand.
Si on convient que notre ère du spectacle se présente comme un théâtre, alors l’évolution politique contemporaine devrait se réfléchir et s’analyser dans la philosophie du théâtre. Et justement, un livre tout récent de Florence Dupont offre un miroir interprétatif d’une transformation contemporaine du théâtre politique. Attention à ce qui suit, il est question du théâtre comme art où sens, texte, jeu et mise en scène sont au service d’une intention mêlant l’esthétique, l’émotionnel et le sens. Dans son livre intitulé Aristote ou le vampire du théâtre occidental, (Flammarion) Florence Dupont dénonce l’hégémonie du texte et du récit face à une exécution plus dynamique, joyeuse, émotionnelle, participative (je pose un clin d’œil à qui on sait) impliquant le public. Bref, c’est l’intellectualisme d’Aristote qui est dénoncé, et de ce fait un schème très occidental où l’intellect domine. Or, il existe une autre tradition théâtrale, faisant appel notamment à la musique, et qui place le public non pas comme un élève à la recherche d’un sens délivré par les acteurs, mais fait de ce public une authentique assemblée participant au spectacle, autrement dit un chœur vibrant avec les acteurs, sorte de pendant profane de la communion des saints. Voici un extrait de la recension du livre par Denis Guénoun, à lire plus bas***, et ma conclusion personnelle sur le devenir bouffon du politique en ces temps de morosité.
La charge de Guénoun est édifiante et vaudrait aussi contre le théâtre politique, ce dont il est question dans cet article. L’insurrection des bouffons contre les professeurs, voilà une formule nette et carrée qui indique bien l’évolution d’une mise en scène politique qui auparavant, accordait une place importante au sens, aux concept, aux formules et analyses intellectuelles, non sans qu’on déplore quelques froideurs ainsi que quelques dérives idéologiques problématiques. Mais, au moins, le politique était une chose qui se pensait et qui ouvrait le citoyen vers du sens. « Il faut arracher le théâtre à la philosophie, à la politique, à l’élan de regarder le monde et de le questionner » (Guénoun). Oui, la charge contre le sens implique d’arracher le théâtre au politique et au philosophique. Mais pour revenir à notre sujet, la politique actuelle, en se théâtralisant, s’est arrachée du philosophique et du concept. Et le citoyen d’être convoqué par cet appel à la joie participative et émotionnelle mis en scène dans un grand spectacle festif. Il y a un peu de Jerry Lewis dans Sarkozy et de Mary Poppins chez Mme Royal.
***
« Car la question du sens est centrale. Florence Dupont se désole que la quête du sens ait pris le pas sur le plaisir du spectacle, et impute à l’aristotélisme cet asservissement de la réalité scénique à l’interprétation. Elle en appelle à une insurrection des bouffons contre les professeurs. Non que l’ouvrage soit tissé d’allégresse : l’apologie du rire y est menée de façon grave, méticuleuse, professorale pour tout dire, et l’on ne sourit pas une fois. C’est un monachisme, un apostolat de la bouffonnerie. L’ambition est de s’en prendre au récit (« l’impérialisme du récit », dont Ricœur serait le dernier fourrier), à la fable (dont Brecht chanterait la dictature), au drame, à la fiction, et surtout au texte, dont Aristote aurait imposé la supériorité littéraire. La charge procède par rabattement : du drame sur le récit, et du récit sur l’écrit. Aristote est le nom donné à cette vampirisation du théâtre par le sens. C’est le tourment du sens qu’il importe de bannir, pour accéder au plaisir du spectacle et de la fête. On pourrait croire que, depuis un siècle, beaucoup a été fait par les metteurs en scène, et quelques philosophes, pour soustraire les planches à l’hégémonie étroite d’une parole. Ou que le procès a été instruit, et jugé, des dérives intellectualistes d’un brechtisme de fin d’époque. Mais non : l’invention de la mise en scène n’est elle-même qu’une excroissance du littéraire, qui traite la scène comme un livre, et si le brechtisme est mort, nous sommes enfermés dans son cercueil. Le propos n’est donc pas de corriger des excès, ou d’en appeler à une meilleure prise en compte de la pratique scénique. Ce qui est mis en branle, c’est une opération générale de liquidation. Il faut en finir avec la quête du sens, le désir herméneutique, la flamme de comprendre. Il faut arracher le théâtre à la philosophie, à la politique, à l’élan de regarder le monde et de le questionner. Que le spectacle se confine à sa propre joie. Liquidation de tout ce qu’auront cherché de grands inspirateurs comme Vernant et Vidal-Naquet - on récuse la remontée aux mythes et à leur mise en question politique -, des brechtiens de haute intelligence comme Barthes, et tant d’interrogations spirituelles ou mystiques, d’inquiétudes de pensée. Jouissez, que diable, et qu’on en finisse. »
40 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON













