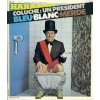Ségolène Royal vide son sac [Prada ?]
Une semaine après sa sortie en librairie, on a entendu tout et rien sur le livre de Ségolène Royal. En quelques lignes et en m’arrêtant sur ses mots, je vais essayer de vous en faire une présentation un peu plus approfondie que ce qu’on a pu lire ou entendre çà et là. La présidente du Poitou-Charentes nous présente, dans Ma plus belle histoire, c’est vous, un livre très personnel, mais aussi un témoignage précieux de cette campagne dont on a déjà oublié de nombreux éléments.
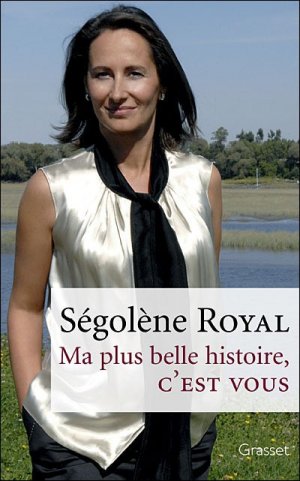
Le caractère éminemment personnel de ce livre se voit surtout à travers deux éléments : sa façon de s’adresser (à nouveau) directement aux Français et sa vision des femmes en politique.
Tout d’abord, on a beaucoup parlé des lettres majuscules utilisées pour le « c’est vous » dans le titre de cet ouvrage. Aucun doute, ceci reflète bien le contenu du livre. Les Français lui « ont tant donné. [Elle] les a tant aimés. [Elle] leur doit [sa] part de vérité. ». Dire la « vérité » aux « Français » est bien le but de ce livre puisque ces mots reviennent respectivement plus de 15 et plus de 25 fois dans cet ouvrage. Elle parle même de « vraie réalité ». C’est une sorte de lettre qu’elle adresse à ceux qui lui ont fait vivre « ce formidable instant démocratique » ou on a assisté à une « réhabilitation du débat ». Nous offrant une belle raffarinade, elle désigne les militants socialistes comme le « parti d’en bas » et ce à plusieurs reprises. A travers ces mots, on retrouve la griffe de Ségolène Royal qui s’adresse aux « vrais gens », elle affirme d’ailleurs qu’elle a été « mieux comprise par les Français que par tous ceux qui donnèrent des voix dans l’espoir de [la] décrédibiliser ». Mais, si Ségolène fait des emprunts à l’ancien Premier ministre, elle nous offre aussi dans cet ouvrage quelques exemples de son style indéfinissable. Ainsi, on peut trouver des expressions telles que : « Peuple de France comme je t’ai aimé pendant cette campagne » ou encore « Ayez confiance en vous ! », « Respecter l’autre, c’est aussi se respecter soi-même »...
En dehors de ce vocabulaire très « ségoliste », on note une autre implication très personnelle, celle de sa vision de la femme en politique. Si on me permettait de résumer schématiquement je dirais qu’il y a deux écoles pour les femmes en politique : les femmes qui prétendent faire de la politique différemment en mettant souvent en avant des arguments tels le charme ou l’instinct maternel, et les femmes qui font de la politique en adoptant les valeurs du champ politique traditionnel. C’est très schématique et polémique, mais on constate que souvent les femmes doivent choisir un des deux camps, c’est l’opposition Elisabeth Guigou - Maryse Lebranchu ou Rama Yade - MAM. Le mot qui apparaît le plus souvent dans ce texte, c’est le mot « femme ». J’en ai compté deux cent trente et une occurrences ! 77 pages allouées à sa vision du féminisme avec, à mon sentiment, des passages d’une nature assez dérangeante trop proche d’un cours magistral. A l’instar d’un passage similaire sur les sondages, je dois, en revanche, reconnaître que ces présentations sont d’une grande clarté et exhaustivité, je me demande juste pourquoi elle les aborde dans ce livre. Elle cite de grandes politologues spécialistes de ces questions (Mossuz-Lavau, Sineau) ainsi que de grands noms du féminisme (Olympe de Gouge, Louise Michel...) pour affirmer ce que Janine Mossuz-Lavau écrivait c’est-à-dire que les partis politiques sont des « cénacles masculins fonctionnant en cercle fermé ». Elle se présente comme victime de ce système en féminisant des expressions telles que « brebis noire ». Avec beaucoup d’humour, elle paraphrase Cookie Dingler pour nous dire « qu’être une femme politique c’est pas si facile ». Ségolène affirme qu’elle ne « croit pas que les femmes aient « par essence » ou « par nature » un rapport différent à la politique ». Pourtant, à la page suivante, elle écrit : « On nous prête souvent un sens plus aigu des choses concrètes. Je crois, pour ma part, que c’est généralement vrai ». Dans la foulée, elle écrit qu’il y a des « qualités communes et dissemblables aux hommes et aux femmes », qu’elle est « aussi une femme et une mère » et que ceci entre en compte dans sa façon de faire de la politique. Pour elle, une « femme à l’Elysée c’est une Révolution » qui « ouvre la politique à une ère nouvelle ». Beaucoup de termes qui font penser, bien qu’elle s’en défende, à une vision des femmes en politique proche de la première catégorie présentée. Elle ajoutera d’ailleurs cette phrase, qui semble être une phrase antagoniste avec les valeurs de femme indépendante qu’elle voudrait véhiculer : « Pour gagner la prochaine fois, il faudra le soutien (...) d’un compagnon amoureux, à fond avec la candidate ».
A travers ces exemples on voit que cet ouvrage est fortement imprégné de la personnalité de Ségolène Royal, de sa vision particulière du féminisme et de son amour pour la démocratie participative. Mais cet ouvrage n’est pas qu’un livre personnel, c’est aussi un témoignage de campagne précieux à ce titre. La candidate revient sur sa défaite assez longuement. On en a beaucoup entendu parler dans la presse, je vais faire court. Tout le monde connaît maintenant l’anecdote à propos de Bayrou, tout comme la plupart des autres éléments de ce domaine. Deux choses intéressantes sont à noter. D’une part, elle revient beaucoup sur sa soi-disant « incompétence ». Elle montre notamment que c’est lié à une vision que l’on a des femmes même si ce n’est pas la seule raison qu’elle avance. L’autre vraie raison est l’absence de soutien de son parti. Elle revient beaucoup sur chacun des ténors et la façon dont ils ont contribué à décrédibiliser sa candidature notamment dans la campagne interne au parti. Depuis les propos machistes de Laurent Fabius jusqu’au voyage de DSK au Canada à la fin de la campagne, elle présente en détails l’absence de soutien de son parti qu’elle oppose à la machine de guerre UMP. Une expression m’a marqué : c’est lorsqu’elle écrit qu’elle attendait des éléphants du PS qu’ils fassent « comme dans un vrai parti ». C’est-à-dire qu’il s’aligne sur la candidate choisie par les militants. Elle écrit qu’une de ses rares fautes aura été de ne pas avoir réussi à fédérer les ténors du parti derrière elle. « La victoire n’était pas possible sans l’union. » Elle répond au passage à Jospin qui a écrit dans L’Impasse que Ségolène était « la moins capable de gagner », qu’elle était un « outsider » « démagogique » et « peu responsable », en le qualifiant d’ « homme du déni majeur ». Selon elle, le PS « aurait pu contrer l’adversaire si tous les ténors étaient entrés dans la bataille ». Sans ça, l’UMP n’a eu qu’à reprendre les critiques faites en interne à la candidate. C’est ainsi qu’ils ont essayé de véhiculer une image de Ségolène sérial gaffeuse (on se souvient de cette affiche de l’UNI, « non à Ségo la gaffe »). Elle s’en explique et montre que Nicolas Sarkozy s’est illustré point de vue gaffes : il a annoncé que la moitié de la population touchait le Smic (17 %), que le baril de pétrole était à 90 $ (il avait un peu d’avance), il a parlé d’ « héritation » qui n’est un terme pas plus français que « bravitude » et a appelé les habitants de Dakar « chers compatriotes qui vivez loin de la métropole » !
Selon elle, si elle est passée pour une sérial gaffeuse c’est parce que son adversaire maîtrisait les médias. A deux reprises, elle parle de méthodes « mussolino-berlusconiennes » puisque Nicolas Sarkozy dominait le « feu sacré médiatique ». Sa propre société de production fournissait des images parfaites pour le 20 heures, on le savait, mais elle montre une « liaison dangereuse entre le pouvoir politique et les médias » (Le Matin, quotidien suisse). Elle présente les liens entre Sarkozy et les grands patrons de presse. Quelques exemples : le candidat de l’UMP aurait auparavant nommé Pierre Louette à l’AFP et Michel Boyon au CSA, tous deux ayant déjà travaillé pour des gouvernements de droite. Elle relate, de plus, comment un sondage qui la présentait comme la candidate la plus crédible sur les questions économiques a pu disparaître de la une de La Tribune pour finir dans un papillon quelques pages plus loin. Beaucoup d’exemples comme ceux-ci l’amènent à dire que « quand la frontière entre communication et information se brouille c’est la propagande qui gagne du terrain ». Elle montre aussi que Nicolas Sarkozy pouvait s’appuyer sur Opinion way, un nouveau venu sur le marché des sondages politiques. Opinion way rémunère les personnes répondant aux questionnaires par internet, ils n’hésitent pas à présenter des sondages dont les questions influençaient beaucoup les réponses. Elle conclut en posant la question suivante : « censure et propagande seraient-elles les mamelles du régime ? ».
En conclusion,
ce livre est à l’image de la campagne de Ségolène Royal, ainsi il sera facile
de le trouver sympathique pour ceux qui ont voté pour elle avec entrain, tout
comme il est aisé de le trouver très mauvais si on l’a détestée. En ce qui me
concerne, je regrette la nature un peu étrange de ce livre qui est à la fois comme
je l’ai dit un récit factuel et personnel flirtant dans d’autres passages avec
le cours magistral. Je trouve, cependant, qu’il ne manque pas d’humour, notamment
dans la façon dont Ségolène Royal attaque son adversaire. Notons qu’elle le
nomme souvent Sarkozy, alors qu’elle appelle tous les autres hommes politiques
par leur nom et leur prénom, qu’elle le qualifie d’ « éradicateur » et de « précarisateur »,
de personnage « manipulant
l’Histoire avec cynisme », faisant « allégeance
au bushisme », et étant un « fin
connaisseur en matière de populisme ». Mais ce qui est une véritable preuve
d’humour, à mon avis, c’est quand elle relate ce jeu vidéo où nains sadiques et
nains rampants s’affrontent et qu’elle ajoute que « toute ressemblance avec des personnages existants serait
naturellement fortuite ».
30 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON